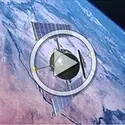- 1. Évolution générale
- 2. Préhistoire et archéologie
- 3. L'Âge du bronze
- 4. Orfèvrerie
- 5. Jade
- 6. Ivoire
- 7. Architecture
- 8. Jardins
- 9. Mobilier
- 10. Sculpture
- 11. Calligraphie et peinture
- 12. Estampes et gravures
- 13. Estampage
- 14. Céramique
- 15. Émaux
- 16. Arts populaires
- 17. Le connaisseur chinois
- 18. L'art contemporain
- 19. Bibliographie
CHINOISE CIVILISATION Les arts
Article modifié le
Calligraphie et peinture
L'écriture utilisée à des fins purement plastiques
La création calligraphique et picturale occupe en Chine une place privilégiée ; elle constitue non pas un métier spécialisé, mais une discipline spirituelle pratiquée par l'élite intellectuelle et sociale des lettrés. Ceux-ci trouvent dans cette double activité le moyen d'expression et d'accomplissement d'une expérience intérieure dont le but ultime est le perfectionnement du moi et la réalisation d'une communion avec l'univers par la mise en harmonie de l'activité créatrice de l'artiste avec le principe créateur du cosmos.
Mais peinture et calligraphie n'ont pas acquis d'emblée ce caractère exceptionnel et ce n'est qu'au terme d'une longue évolution historique qu'elles participeront d'une commune esthétique. Les plus anciennes traditions chinoises prêtent à l'écriture un pouvoir magique : l'écriture est une prise de possession de l'univers dont elle sonde et perce les secrets. Bien que ce caractère sacré se soit progressivement effacé dans les consciences, une appréciation complète du phénomène calligraphique devra cependant en tenir compte.
La calligraphie au sens étroit du mot – c'est-à-dire l'écriture envisagée moins comme le moyen de transmettre une information que comme une création plastique exprimant la sensibilité individuelle du calligraphe – a pris son essor vers la fin de l'époque Han. À partir de ce moment, elle devient une discipline spécifique, avec son histoire et ses maîtres, ses théoriciens, ses critiques et ses collectionneurs. Parmi tous les arts, la calligraphie occupe une position privilégiée avec laquelle seule peut rivaliser la peinture – qui, depuis la fin des Tang, lui est devenue étroitement tributaire.
Technique et support
La calligraphie est tracée à l'encre, sur soie ou sur papier, au moyen d'un pinceau. Le pinceau est une création typique du génie chinois, alliant la simplicité de structure à une souplesse illimitée d'applications ; mais le corollaire de sa prodigieuse sensibilité est l'extrême difficulté de son contrôle ; pour être manié proprement, il requiert du calligraphe une intense concentration à la fois physique et spirituelle qui ne se conquiert qu'au terme de longues années d'exercice ininterrompu. L'encre, loin d'être d'une consistance stable ou d'une inerte monochromie, recèle d'inépuisables ressources ; onctueuse ou fluide selon qu'on l'additionne de plus ou moins d'eau, elle présente toute une gamme de valeurs : suivant qu'on l'emploie avec largesse, au pinceau saturé et en touches grasses, ou parcimonieusement, en laissant le pinceau à demi sec pour faire transparaître l'ossature du trait, elle permet d'obtenir les effets les plus divers. Le support – papier ou soie – est choisi pour sa qualité absorbante ; il se comporte un peu à la manière d'un buvard : au lieu de subir passivement l'attaque du pinceau et l'imprégnation de l'encre, il s'en empare aussitôt de manière active et indélébile. Ainsi, le calligraphe travaille véritablement avec des instruments vivants, dotés chacun d'une sensibilité subtile et mouvante ; en même temps, ces intermédiaires matériels sont réduits au strict minimum et amenuisent ainsi la distance qui sépare la vision intérieure de son incarnation dans les formes : pour le calligraphe, il s'agit en effet de se projeter de la manière la plus totale et la plus immédiate possible dans son œuvre, qui doit constituer « une empreinte de son cœur ».
Rythme et composition
Une pièce de calligraphie est formée d'une succession de caractères d'écriture ; chaque caractère constitue une unité plastique, combinant un assemblage plus ou moins complexe de traits qui s'inscrivent invariablement dans un carré imaginaire. Pour meubler harmonieusement chacun de ces carrés, l'agencement des traits pose pour chaque caractère un nouveau problème plastique qui doit recevoir sa solution individuelle : il s'agit essentiellement d'obtenir un équilibre dynamique par un jeu d'asymétries complémentaires, d'établir un système de tensions intérieures et d'atteindre la stabilité à travers une combinaison de forces en mouvement. Une fois assurée la composition du caractère isolé, il faut ensuite unifier la succession rythmique de toutes ces solutions individuelles, puis organiser la succession des rangées pour que l'ensemble de l'œuvre forme une totalité organique.
Tandis que la peinture (du moins le rouleau vertical) se présente au spectateur comme une organisation globale et simultanée de l'espace, la calligraphie se double d'une dimension temporelle : elle prend possession de son espace en suivant une succession d'étapes. En effet, le spectateur peut, d'une part, embrasser de façon instantanée la totalité de l'œuvre achevée et, d'autre part, quand il procède à sa lecture, le mouvement par lequel le calligraphe a progressivement conquis l'espace de la page blanche se reconstitue sous son regard. Cette lecture peut être d'ailleurs simplement plastique. L'appréciation d'une calligraphie est pratiquement indépendante de la compréhension de son contenu écrit ; les cursives les plus audacieuses déforment souvent la graphie des caractères au point de les rendre méconnaissables à première vue et cela ne gêne nullement la contemplation de l'esthète.
Interprétation et création
Le caractère d'écriture s'impose au calligraphe comme un donné objectif dont il ne peut modifier la structure théorique ; non seulement le nombre et la forme des traits qui composent chaque caractère sont définitivement fixés, mais encore l'ordre successif dans lequel ces traits doivent être tracés et les divers mouvements du pinceau auxquels leurs formes correspondent sont rigoureusement prédéterminés. Aussi, en un sens, le calligraphe n'invente-t-il pas de formes, il les interprète. Pour prendre une comparaison musicale, il n'est pas compositeur mais exécutant. N'oublions pas cependant que toute interprétation est elle-même une création à un niveau second – et le propre de l'esthétique chinoise est précisément d'attacher un prix particulier à cette forme de création-là, la plus subtile peut-être. Alors que la peinture édifie un système de formes conventionnelles à partir de la réalité objective, le point de départ de la création calligraphique est déjà formel. Forme d'une forme, cet art quintessencié échappe cependant à la stérilité de l'abstraction gratuite : ce que l'esthète recherche avant tout dans une calligraphie, c'est, sous les divers mouvements du pinceau, le rythme d'un cœur qui communie au rythme de la création universelle et qui, par la vertu de cette participation, réussit à insuffler à chaque caractère cette énergie unique qui anime l'infinité des créatures.
Rayonnement de l'art calligraphique
Le système des examens mandarinaux ayant lié l'accès du pouvoir politique à la qualité de lettré, naissance et fortune durent toujours céder le pas devant le mérite qui s'attachait à la maîtrise de la chose écrite. Cela explique le prestige unique dont la calligraphie ne cessa de jouir à travers les siècles : sans être un calligraphe au moins passable, nul n'aurait pu faire figure d'honnête homme. Il en résulte que cet art, qui constitue l'une des expressions les plus hautes du génie chinois, fut aussi le plus universellement pratiqué et apprécié.
La calligraphie a exercé une emprise profonde sur les diverses expressions artistiques de la culture chinoise, mais c'est dans la peinture que son influence est la plus évidente : c'est ainsi que le lavis d'encre monochrome des peintres-lettrés, empruntant à la calligraphie ses instruments, sa technique et son esthétique, cherche à écrire le signe des choses plutôt qu'il n'en décrit les apparences.
La calligraphie rayonne sur toutes les manifestations de la vie chinoise, elle est partout présente : des stèles antiques aux affiches et panneaux de la rue commerçante, des autographes célèbres qui ornent le cabinet de l'esthète aux couplets de Nouvel An qui décorent le porche des plus humbles demeures paysannes ; plus encore peut-être qu'une jouissance esthétique, c'est une présence tutélaire : elle semble rappeler en permanence que c'est avec le verbe écrit que commença l'humanisation du monde – un très ancien récit mythologique ne nous rapporte-t-il pas que, lorsque Cang Jie eut inventé l'écriture, démons et dieux pleurèrent dans la nuit leur empire perdu ?
Écriture et calligraphie
Au sens strict, la calligraphie se distingue de l'écriture, en ceci qu'elle se sert de l'écriture indépendamment de ses fonctions normales de communication et d'information, et fait d'elle le support d'une création formelle, susceptible, par ses seuls rythmes plastiques, d'exprimer la sensibilité individuelle de son auteur. Néanmoins, bien avant l'apparition des démarches calligraphiques au sens étroit du mot, l'écriture chinoise présentait déjà d'évidentes qualités esthétiques, au point que les inscriptions archaïques, qui ne relevaient pourtant que d'impératifs fonctionnels, sont considérées par les calligraphes non seulement comme la source, mais aussi comme les modèles les plus accomplis de leur art. Aussi une histoire de la calligraphie chinoise se confond-elle dans une large mesure avec une histoire de l'écriture, et plutôt que d'établir une frontière stricte entre écriture et calligraphie, il serait plus exact de décrire le passage de l'une à l'autre comme la transition d'une démarche calligraphique de fait à sa pratique consciente et délibérée.
Naissance de l'écriture chinoise
Les témoignages les plus anciens que nous connaissions de l'écriture chinoise sont constitués par les inscriptions divinatoires (jia gu wen) gravées sur os il y a quelque trente-trois siècles par les devins de la dynastie Shang. Malgré l'apparence encore relativement primitive de leur graphie, ces caractères révèlent déjà une haute capacité d'abstraction et de systématisation ; aussi, plutôt qu'un point de départ, doivent-ils représenter le premier aboutissement d'une très longue période d'élaboration dont, sauf quelques allusions mythologiques, nous ignorons encore tout. Par la suite, ces caractères se sont multipliés, et leur forme graphique s'est profondément modifiée (au point qu'aujourd'hui leur identification et leur déchiffrement font l'objet d'une étude spécialisée), mais dès ces premiers témoins, la nature idéographique et les principes constitutifs de l'écriture chinoise apparaissent déjà définitivement fixés.
La seconde grande étape stylistique de l'écriture chinoise est illustrée par les inscriptions des bronzes rituels de la dynastie Zhou et de l'époque des Royaumes combattants. Ce type de graphie (da zhuan) connut de nombreuses variantes dans l'espace et le temps. Au début du iiie siècle avant J.-C., la dynastie Qin, dans le cadre de sa politique de centralisation et d'unification impériale, entreprit d'uniformiser l'écriture et imposa une graphie nouvelle (xiao zhuan), qui se présente essentiellement comme une codification méthodique des expériences antérieures.
La dynastie Han, reprenant dans une large mesure l'héritage politique des Qin, poussa à la centralisation administrative ; les besoins croissants de la bureaucratie impériale favorisèrent l'adoption et le développement d'un autre style d'écriture, né sous les Qin, le « style des chancelleries » (li shu), plus commode à manier et, surtout, mieux adapté aux ressources du pinceau. Dans une évolution qui, des inscriptions divinatoires à l'écriture moderne, ne présente fondamentalement aucune solution de continuité, le « style des chancelleries » marque le tournant décisif. Des expériences variées que les lettrés-fonctionnaires pratiquèrent à partir de ce style, dans une perspective qui n'était plus seulement fonctionnelle mais déjà esthétique, naquirent les trois formes d'écriture qui devaient rester en usage jusqu'à nos jours : le style régulier (kai shu, appelé aussi zheng shu), le style semi-cursif (xing shu) et le style cursif (cao shu). Dès les environs du ive siècle de notre ère, la graphie des caractères chinois s'est trouvée fondamentalement fixée et ne devait plus subir aucune modification notable jusqu'à la réforme de l'écriture entreprise en Chine populaire en 1956.
Une discipline spécifique
La calligraphie au sens étroit du mot, c'est-à-dire l'utilisation consciente et délibérée de l'écriture à des fins purement plastiques, affranchies des contraintes fonctionnelles (communication, lisibilité), a pris son essor vers la fin de l'époque Han. À partir de ce moment, elle devient une discipline spécifique, avec son histoire et ses maîtres, ses théoriciens, ses critiques et ses collectionneurs. Son développement fut encore favorisé par ce phénomène politico-social qui a caractérisé toute l'histoire de la Chine impériale : le gouvernement des lettrés. La Chine fut alors dirigée par des légions d'humanistes, fonctionnaires dont on peut véritablement dire qu'ils passaient leur vie entière le pinceau à la main. D'où ce prestige unique dont la calligraphie ne cessa de jouir à travers les siècles, et qu'elle conserve aujourd'hui encore (Mao Zedong lui-même ne dédaignait pas de faire étalage d'un talent de calligraphe qui, à défaut de formation profonde, ne révélait pas moins un brillant individualisme). Toute l'élite politique, intellectuelle et sociale de Chine – empereurs, hommes d'État, poètes, philosophes, moines – s'est donc adonnée sans relâche à cet art. Même si, pour beaucoup, il ne s'agissait là que d'une convention élégante, à toutes les périodes de l'histoire il se trouva aussi de grands créateurs pour qui la calligraphie constituait une haute et exclusive passion. Parmi eux, mentionnons quelques noms particulièrement marquants : à l'époque des Six Dynasties, Wang Xizhi (321-379) et son fils Wang Xianzhi (344-388) créent une calligraphie dont la grâce inspirée sera révérée par la postérité comme un modèle d'une perfection quasi surnaturelle. Sous les Tang, le style robuste et austère de Ouyang Xun (557-641), Yan Zhenqing (708-784) et Liu Gongquan (778-865) reflète bien la puissance majestueuse et la discipline d'un grand âge classique ; chez Chu Suiliang (596-658), la force intérieure et l'équilibre revêtent une plus grande recherche d'élégance, tandis que Sun Guoting et le moine Huaisu (725-785) s'abandonnent, hors des sentiers battus, aux ivresses d'une cursive qui tend à s'affranchir de toute convention graphique – et, ce faisant, devient d'ailleurs source de conventions nouvelles ! Chez les calligraphes Song – Su Dongpo (1036-1101), Mi Fu (1051-1107), Huang Tingjian (1045-1105) – l'élan lyrique et la fantaisie généreuse du tempérament s'appuient sur un art consommé dont l'aisance semble rejoindre la spontanéité de la nature. Avec l'empereur Huizong (1101-1126), l'art commence toutefois à prendre le pas sur le naturel, et aboutit à un curieux maniérisme, plus pictural que calligraphique.
À l'époque Yuan, certains lettrés, traumatisés par la défaite et l'occupation mongole, cherchent à renouer avec les sources antiques ; d'autres, comme Zhao Mengfu (1254-1322), cultivent en virtuoses un éclectisme qui frise parfois la facilité. Ce courant éclectique reste prépondérant sous les Ming, avec Wen Zhengming (1470-1559) et Dong Qichang (1555-1636). Durant la dynastie Qing, sous l'influence de la renaissance des études classiques et de l'engouement pour la philologie, l'épigraphie et l'archéologie, de nombreux calligraphes – tel Deng Shiru (1743-1805) – remettent en vogue les styles archaïques ; d'autre part, quelques individualistes – qui souvent sont également peintres, tel Zheng Banqiao (1693-1765) – rejettent toutes les règles établies pour se créer un style personnel d'une originalité agressive et savoureuse. Enfin, à l'époque contemporaine, plusieurs maîtres – parmi lesquels Yu Youren, mort en 1966, fut un des plus éminents – témoignent de la vitalité d'une tradition restée capable de métamorphoses neuves.
La peinture
Un métier artisanal jusqu'à la fin des Han
Quelques allusions des Classiques permettent de supposer que la Chine a possédé une peinture dès la plus haute antiquité. À partir de l'époque Han, les allusions littéraires plus fréquentes se doublent de quelques rares fragments d'œuvres (briques peintes en provenance de sépultures) et d'un nombre assez considérable de témoignages indirects empruntés aux autres arts plastiques (miroirs de bronze, pierres gravées, briques estampées). Tout ce que nous savons de la peinture depuis les origines de la civilisation chinoise jusqu'à la fin des Han se borne donc finalement à peu de chose : cette première peinture chinoise remplissait des fonctions magiques, religieuses, didactiques, historiographiques et décoratives ; elle était exécutée par des artisans spécialisés, dont la condition sociale se confondait avec le commun des corps de métiers ; son esthétique était avant tout commandée par un souci d'imitation et de ressemblance ; ses sujets principaux étaient constitués par les figures (humains, animaux), tandis que le paysage se trouvait encore réduit au rôle subalterne d'un décor assez schématique et embryonnaire. Sous les Six Dynasties, tandis que la calligraphie arrivait à un premier et brillant épanouissement en devenant l'occupation favorite d'une élite raffinée, la peinture reste pour l'essentiel un métier artisanal. Mais, dès cette époque, il faut remarquer qu'à côté des artisans certains hommes de qualité commencent eux aussi à pratiquer la peinture. Simultanément, dans les traités théoriques de peinture rédigés à ce moment s'affirme une exigence neuve : l'artiste doit exprimer la nature intérieure du sujet peint, et non seulement son apparence formelle. Les catalogues anciens ont conservé les noms d'un certain nombre d'artistes de cette période, mais leurs œuvres ont disparu ; il nous reste cependant une copie ancienne d'une peinture de Gu Kaizhi (seconde moitié du ive siècle), à partir de laquelle nous pouvons nous faire une certaine idée de l'art de cette époque : la figure humaine constitue encore le sujet principal de la peinture, le paysage reste réduit aux dimensions d'un décor symbolique, l'exécution purement linéaire n'a pas encore intégré ces modulations de pinceau dont la calligraphie, à cette même période, avait déjà découvert les ressources.
Fresque et paysage au lavis sous les Tang
La dynastie Tang, époque puissante, luxueuse et raffinée, a dû connaître un remarquable épanouissement de la peinture, d'abondants témoignages littéraires en font foi. Mais les œuvres qui subsistent encore aujourd'hui sont rarissimes, douteuses et contradictoires, de sorte que l'étude de la peinture Tang représente dans une large mesure une discussion dans le vide. La plus robuste expression de la peinture Tang est incontestablement fournie par le courant traditionnel des fresquistes, qui couvrent les murs des palais et des temples de grandes figures dessinées avec une souveraine autorité. Dans ce domaine, le meilleur témoignage – plus significatif que les fresques de Dunhuang qui reflètent un art provincial – est offert par les fresques de la tombe de la princesse Yongtai (tombe découverte au Shǎnxi en 1961). Mais, du plus célèbre fresquiste de l'époque Tang, Wu Daozi (viiie s.), plus aucune œuvre ne subsiste aujourd'hui. Si la fresque est ainsi le plus beau fleuron de la peinture Tang, le point culminant qu'elle atteint à cette époque est également dans une certaine mesure un point final ; on continuera certes à peindre à la fresque, mais sans y accorder la même importance. En fait, à la même époque, le phénomène le plus significatif pour l'avenir de la peinture est la naissance d'un art nouveau qui sera appelé à devenir la voie presque exclusive de la peinture chinoise : il s'agit du paysage au lavis d' encre monochrome, dont l'invention est attribuée au poète Wang Wei (699-759). Il nous est difficile de juger objectivement des réalisations picturales de Wang Wei (aucun original ne subsiste), mais, à partir de certaines copies et de divers commentaires critiques, nous pouvons supposer qu'il s'agissait d'une forme de peinture encore assez raide et rudimentaire. Quoi qu'il en soit, ses principes mêmes impliquaient plusieurs innovations décisives : en ce qui concerne le sujet, le paysage – lieu par excellence de cette communion de l'homme avec l'univers qui deviendra l'objet essentiel de la création artistique – se substitue aux figures. Les procédés techniques hérités des fresquistes – brosse dure, couleurs (la peinture chinoise archaïque usait de couleurs rutilantes, comme l'atteste son ancienne appellation de danqing « art des rouges et des verts ») – sont abandonnés au profit des instruments du calligraphe : pinceau doux, encre ; du même coup, la peinture va pouvoir s'annexer le prodigieux registre plastique qu'avait déjà exploré la calligraphie : la peinture s'apparentera désormais à la chose écrite, et acquiert ainsi une dignité nouvelle ; ayant cessé d'être un métier artisanal asservi à des fonctions narratives ou décoratives, elle devient l'apanage de l'élite et constitue une création spirituelle au même titre que la poésie (n'oublions pas que Wang Wei était un des plus grands poètes de son temps) : peinture et poésie seront les deux faces d'une même réalité intérieure, les deux moyens complémentaires à la disposition du lettré pour traduire, d'un même pinceau, les élans profonds de son cœur.
L'âge d'or du paysage : xe-xiie siècle
Cet art nouveau, qui avait germé à l'époque Tang, connaît son premier épanouissement au xe siècle (Cinq Dynasties et début des Song du Nord). Le grand paysage chinois s'affirme alors dans toute sa plénitude, avec une majesté, un équilibre et une profondeur spirituelle qui resteront inégalables. Alors que les artistes Tang se limitaient encore pour la plupart à des procédés purement linéaires, toutes les ressources du pinceau spnt désormais mises à contribution, le vocabulaire de formes (« rides », « points ») et les conventions plastiques qui serviront de base à toute la peinture se trouvent fondamentalement définis. Forme et technique ne font cependant pas l'objet d'une recherche gratuite : elles sont tout entières mises au service d'une vision mystique de la nature, et leur perfection est précisément de passer inaperçues. Cette peinture réalise un point d'équilibre rare entre la maîtrise des moyens plastiques –dont l'aisance ne dégénère jamais en virtuosité – et la qualité spirituelle de l'inspiration du peintre, qui cherche à embrasser la totalité de l'univers dans sa permanence sereine et objective. L'homme apparaît à peine dans ces vastes paysages : il est enfoui, infime, au cœur de leur immensité, mais sans que celle-ci l'écrase : il s'y trouve plutôt en harmonie, comme porté par un océan nourricier ; il n'est pas le témoin lyrique du spectacle de la nature, mais seulement l'un de ses humbles éléments, participant de cette entité organique, au même titre que les pierres ou les bambous. Ces peintures austères et impassibles sont pourtant chargées d'une émouvante force de vie, car leurs auteurs ont l'expérience la plus intime et la plus attentive de la nature ; ils connaissent la rugosité de chaque rocher, de chaque écorce, ils se sont mesurés avec les cimes, ils ont sondé l'impondérable montée des brumes au fond des vallées. Le peintre n'entend cependant pas faire œuvre « réaliste » – pour rendre sensibles les aspects les plus concrets du monde naturel, il se sert au contraire d'un répertoire de formes et de symboles plastiques étonnamment abstrait –, il ne s'agit pas pour lui d'enregistrer un document singulier, un moment ou un fragment d'une réalité donnée, mais de créer un univers complet dont la réalité soit parallèle à celle du monde extérieur, comme le microcosme l'est au macrocosme.
Les pionniers de cette peinture furent Jing Hao (première moitié du xe siècle) et son disciple Guan Tong, Dong Yuan (actif vers 930) et son disciple Juran. Dans la seconde moitié du xe siècle, Li Cheng et Fan Kuan (ce dernier était encore actif dans les premières années du xie siècle) portent cet art à son apogée.
Sous les Song du Nord, au xie siècle, plusieurs grands peintres, dont les plus illustres sont Xu Daoning et Guo Xi, restent fidèles à la vaste vision de leurs prédécesseurs, mais manifestent déjà une certaine tendance à rompre le classique équilibre entre la forme et le contenu, en faveur d'une certaine emphase plastique qui, chez Guo Xi en particulier, aboutit à un véritable baroquisme : les formes sont emportées dans un mouvement tourbillonnant d'une grande puissance, mais qui nous éloigne de l'intériorité plus austère du xe siècle. Cette tendance à la recherche plastique poursuivie pour elle-même va progressivement ramener la peinture dans la voie d'un certain professionnalisme. À la fin du xie siècle et au début du xiie, un paysagiste comme Li Tang illustre cette évolution de manière caractéristique. Sa technique est d'une grande virtuosité, mais sa vision du paysage tend à se rétrécir aux dimensions d'une saisie impressionniste d'un aspect momentané et singulier de la nature. En ceci il prépare directement la voie aux paysagistes brillants, mais peut-être plus superficiels, des Song du Sud.
Mais, tandis qu'un courant de la peinture commence ainsi à s'attacher aux habiletés de métier, apparaît dans la seconde moitié du xie siècle, avec Mi Fu (1051-1107), un art insolite et spontané dont l'individualisme constituera un des aspects de la pein ture des lettrés. Le lettré dédaigne la science technique du professionnel ; il aborde la peinture avec une audace désinvolte, se fiant aux seules ressources de sa formation calligraphique. Que lui importe le reste ? Son ambition en effet n'est pas de décrire l'apparence des choses, mais d'en écrire les signes. La peinture devenant une écriture spirituelle, sa qualité sera avant tout fonction de la qualité intellectuelle et morale du peintre. Dans le groupe des lettrés, notons cependant que, chez un peintre comme Wen Tong, spécialiste des bambous et ami de Su Dongpo (Su Shi), l'intensité mystique de l'inspiration s'appuie sur une austère discipline des formes, dont la puissance reste toute classique.
L'Académie
Une autre tendance s'affirme simultanément. Sa vogue sera d'autant plus large que, durant le premier quart du xiie siècle, elle sera directement soutenue et illustrée par l'empereur Huizong – lui-même peintre de talent. Huizong avait rassemblé dans son académie un certain nombre de professionnels habiles dont le registre, mineur peut-être, est d'un charme raffiné, mais exempt de mièvrerie. Le courant de l'Académie, sans pouvoir prétendre à la profondeur, n'en correspond pas moins à l'une des grandes constantes du génie chinois : une contemplation attentive et émerveillée du réel sous tous ses aspects, même les plus humbles et les plus ténus – animaux, fleurs, oiseaux, insectes –, rendus avec un réalisme minutieux (et cependant ferme), sans que pour autant poésie et humour soient absents de ces œuvres, où la sûreté du métier est toujours admirable. Dans la même ligne, mentionnons au passage Li Di dont la longue carrière couvre presque tout le xiie siècle ; il pratique une peinture anecdotique où le paysage ne sert plus que de toile de fond à de charmantes scènes de genre qui rassemblent toutes les séductions et aussi toutes les limites de cet académisme chinois.
Le paysage lyrique : xiie et xiiie siècles
Sous les Song du Sud, à la fin du xiie et au début du xiiie siècle, deux grandes personnalités dominent l'art du paysage : Ma Yuan et Xia Gui. Ces artistes partent de la conception du paysage à la fois plus étroite et plus impressionniste qu'avait amorcée un Li Tang ; dans l'emploi des « rides fendues à la hache » et des nappes de lavis enlevées à l'emporte-pièce, ils affirment une éblouissante virtuosité technique. Dans le domaine de la composition et du cadrage, ils s'adonnent à d'audacieuses recherches d'asymétrie, jouant sur l'antagonisme des pleins et des vides. Par opposition au grand paysage des xe et xie siècles, leur peinture se veut elliptique et fragmentaire : l'artiste isole un élément significatif qu'il met puissamment en valeur par le contraste d'une large zone de vide. Alors que le paysage classique s'efforçait de saisir la nature dans sa permanence majestueuse, cette peinture-ci vise à l'instantané tant dans le sujet que dans l'exécution, et, contrairement à l'impassibilité sereine qui prévalait deux siècles plus tôt, elle se montre lyrique et subjective ; l'homme n'est plus cet infime élément perdu dans le grand Tout : il occupe souvent l'avant-scène (poète contemplant la lune, lettré en promenade, ermite dans sa barque) ; spectateur et témoin de la nature, le personnage mis ainsi en évidence catalyse une émotion fugace qui devient, elle, le véritable sujet de la peinture. Cet art impeccable et brillant est limité par sa virtuosité même ; il repose sur des artifices de composition d'une efficacité infaillible, mais dont le caractère par trop inéluctable peut lasser. C'est du reste ce que l'esthétique des lettrés, telle qu'elle se définira à partir de l'époque Yuan, lui reprochera le plus sévèrement. En tout cas, cette peinture a exercé une influence considérable non seulement sur les peintres professionnels de l'époque Ming, mais également au Japon (toute la peinture de Sesshū est une paraphrase de Xia Gui, et on retrouve plus tard jusque chez Hiroshige ce sens de l'ellipse puissante et du cadrage asymétrique qui caractérisait le paysage des Song du Sud). Participant d'une vision commune, Ma Yuan et Xia Gui n'en manifestent pas moins des tempéraments fortement individualisés : Ma, plus mélancolique et méditatif, Xia, plus emporté et dramatique.
Peintres adeptes du Chan
Enfin, pour le xiiie siècle, il nous faut encore mentionner un phénomène particulier, d'une grande valeur spirituelle et esthétique, mais dont l'influence sur l'évolution ultérieure de la peinture chinoise resta malgré tout limitée : il s'agit de la peinture inspirée par le bouddhisme Chan (plus connu en Occident sous son nom japonais de Zen). Cette école de pensée, qui doit en fait plus à la mystique taoïste qu'à l'orthodoxie bouddhique, estime que la vérité ne saurait être approchée par des voies purement intellectuelles (étude des textes sacrés), mais au contraire qu'elle ne peut être pleinement possédée que par une intuition totale, instantanée et immédiate de toute l'être, l'« illumination ». Celle-ci s'atteint au terme d'une ascèse physique et spirituelle, où la méditation prend pour support la contemplation du réel concret, fût-il le plus humble et le plus insignifiant ; elle saisit dans cette réalité fragmentaire, isolée dans sa pure et irréductible singularité objective, l'absolu du réel, et cela en un éclair dont l'instantanéité même rejoint l'intemporel. Plusieurs adeptes du Chan ont pratiqué la peinture – citons surtout Muqi et Liang Kai – car la peinture peut s'accomplir à l'image de l'illumination Chan : leurs œuvres elliptiques, enlevées d'un fulgurant coup de pinceau, sont le fruit d'une exécution instantanée, l'artiste opérant dans une sorte de transe ou d'extase, où l'intuition de la main devance tout contrôle rationnel. Il ne s'agit pas cependant d'une « écriture automatique » au sens occidental du terme, car, loin de valoriser les forces de l'inconscient, cette libre explosion de la création artistique ne s'obtient qu'au terme d'un apprentissage long, austère et ingrat (parallèle à l'ascèse monastique) de l'encre et du pinceau et repose précisément sur une intense discipline de toutes les énergies de la conscience ; aussi, les créations picturales du Chan, d'une éblouissante audace plastique et d'une déconcertante simplicité de moyens, sont-elles toujours sous-tendues par une extraordinaire concentration spirituelle qui assure leur densité et leur profondeur. Dans cet art, nous voyons conciliées en une synthèse unique les diverses valeurs et sollicitations entre lesquelles la peinture chinoise s'est constamment trouvée partagée : peinture instantanée, mais où l'instant devient une intuition de la permanence ; peinture elliptique, mais où le fragment détaché nous renvoie à la totalité du réel dont il est le substitut ; virtuosité technique, mais mise tout entière au service d'une vision spirituelle ; attachement à la réalité sensible et concrète, mais transcription de celle-ci dans une écriture abstraite. L'équilibre si rare réalisé par la peinture Chan, qui parvient à marier des vertus aussi contradictoires, nous incite parfois à voir en elle une des expressions les plus hautes et les plus complètes de la peinture chinoise. Remarquons cependant qu'en Chine elle ne s'est jamais vraiment intégrée dans le grand courant d'évolution historique. Elle est restée un phénomène relativement marginal, et n'a guère exercé d'influence, sinon sur quelques individualistes Min et Qing ; elle comporte en effet quelque chose de trop « voyant », une sorte de véhémence et d'exhibitionnisme trop agressifs pour le goût des connaisseurs chinois. En revanche, elle a connu une fortune considérable au Japon – mais là, malheureusement, l'engouement pour ce type de peinture n'a abouti le plus souvent qu'à des manifestations spectaculaires d'une formule vidée de toute substance intérieure.
La peinture comme évasion spirituelle
L'époque Yuan, bien que relativement brève, est d'une importance considérable pour la peinture, qui connaît alors un tournant décisif. En rupture complète avec la peinture des Song du Sud, une esthétique nouvelle s'élabore, et son influence sera déterminante sur les époques Ming et Qing.
L'occupation mongole voue à l'inactivité d'une retraite volontaire toute une partie de l'élite lettrée, pour qui la peinture devient la plus noble évasion spirituelle. Vivant en marge du siècle, les artistes rompent avec leurs prédécesseurs immédiats et, par réaction contre leur époque, renouent avec les sources antiques : la peinture des Tang et des Cinq Dynasties. Mais parallèlement à cet archaïsme délibéré, ils jettent aussi les bases d'un art neuf ; dorénavant, la peinture de l'homme de qualité s'insurge contre les artifices « vulgaires » des professionnels ; elle répugne à toute exhibition de virtuosité : l'honnête homme, préférant l'obscurité aux suffrages du commun, évite de se faire remarquer, de manière à n'être reconnu que de ses pairs. Cette peinture se veut d'une discrétion altière ; par opposition à la perfection immanquable du paysage des Song du Sud, elle cultive délibérément une sorte d'irrésolution détachée, d'élégante nonchalance, de caprice inspiré, laissant subtilement place à l'accidentel. Les esthètes estiment que la saveur suprême réside dans une apparente « insipidité » (dan), et que la force véritable est celle, tout intérieure, qui parvient à s'exprimer par des moyens volontairement pauvres, apparemment ternes et nus. La catégorie critique suprême devient celle de yi, « fantaisie détachée », « nonchalance désinvolte » ; peindre est beaucoup plus que peindre : par-delà le prétexte des formes et des apparences, la peinture est avant tout une « écriture du cœur ».
Parmi les plus importants artistes de cette période si riche en personnalités originales, mentionnons d'abord, du côté des archaïsants, Qian Xuan (1235-1300) et Zhao Mengfu (1254-1322). Gao Kegong (1248-1310) donne tour à tour dans un archaïsme monumental et un tachisme fluide, dérivé de Mi Fu. Parmi les novateurs, Wu Zhen (1280-1354) est le type même du peintre-lettré ; son style, d'une candeur abrupte, exercera une influence considérable sur la postérité. Huang Gongwang (1269-1354) est souverain dans le paysage ; la qualité structurelle de ses compositions présente une « modernité » qui, pour le critique occidental, suscite spontanément la comparaison avec les expériences de Cézanne. Ni Zan (1301-1374) fournit peut-être l'illustration la plus exemplaire de l'idéal esthétique esquissé plus haut ; il se limite à un type de composition presque invariable : paysages nus et austères, désertés de toute présence humaine, où le pinceau, avare de son encre, laisse de grandes plages de vide entre l'avant-plan et la désolation limpide d'un horizon exhaussé. Derrière son dépouillement et sa froideur apparente, ce génie altier et solitaire, assoiffé de pureté, découvre à qui sait l'approcher avec recueillement et silence une des sensibilités les plus profondes et les plus frémissantes de toute l'histoire de la peinture chinoise. Les peintres lettrés Ming et Qing lui ont voué un véritable culte ; ils l'ont étudié et copié sans relâche, bien que la simplicité de ses formes et de ses compositions recèle une densité spirituelle dont le secret échappe à l'analyse et à l'imitation. Wang Meng ( ?-1385) est plus curieux d'une recherche proprement formelle ; sa peinture, touffue et baroque, est tissée d'une forme de « rides » originale, dont la ponctuation dynamique et nerveuse sera, elle aussi, une source d'inspiration pour la postérité.
L'étude des Anciens
Les époques Ming et Qing furent très riches dans le domaine pictural – jamais les peintres n'ont été plus nombreux, ni les théories critiques et esthétiques plus développées – et paradoxalement elles sont pourtant restées les moins connues et les moins comprises en Occident. Cela non seulement parce que le tempérament multiforme des artistes et la complexité des écoles permettent moins aisément de dégager les lignes de force de l'évolution picturale, mais surtout parce que les critères auxquels l'Occidental a instinctivement tendance à se référer s'avèrent ici particulièrement inadéquats. Pour apprécier véritablement les mérites de la peinture Ming et Qing, il nous faut plus que jamais nous mettre à l'école du critique chinois. L'Occidental en effet considère que l'originalité (c'est-à-dire la capacité d'inventer des formes neuves, d'augmenter le répertoire de signes plastiques dont dispose la peinture) constitue en soi une qualité – voire la qualité par excellence – et que l'absence de cette « originalité » est un indice d'impuissance et de sclérose académique. Devant la peinture Ming et Qing, dont le courant majeur est celui de la copie et de l'étude des Anciens, il aura le sentiment qu'il s'agit d'une époque sèche et creuse. En fait, pour le peintre chinois, l'originalité n'est pas en soi une qualité, ni le manque d'originalité un défaut ; l'objet du peintre en effet n'est pas d'inventer des formes neuves, mais de saisir et transmettre l'influx du souffle cosmique ; du moment que ce but suprême est atteint, il importe peu que le prétexte formel soit original ou emprunté. La valeur d'une œuvre réside donc non pas dans des formes ou des schémas de composition, lesquels peuvent sans inconvénient n'être que des stéréotypes, mais bien dans cette animation intérieure du souffle – manifestée par les valeurs d'encre et le graphisme du pinceau – dont il est beaucoup plus difficile pour le non-initié de reconnaître l'accomplissement.
Au début de l'époque Ming (xve siècle) se manifeste encore un courant de peinture professionnelle, illustré surtout par Dai Jin – qui s'inspire souvent des paysages des Song du Sud – et par Wu Wei (1459-1508). Ce courant sera fort combattu par la critique lettrée dont l'autorité deviendra bientôt souveraine. La peinture professionnelle ne se relèvera pas de ces attaques et finira par perdre toute influence. Aujourd'hui, cependant, nous redécouvrons ces artistes, et nous sommes assez sensibles à leur verve robuste et franche ainsi qu'à leurs audaces plastiques. Celles-ci, n'étant pas sous-tendues par une inspiration spirituelle, restent entachées, aux yeux du lettré, d'une irrémédiable « vulgarité » ; mais ce jugement peut paraître aujourd'hui d'une sévérité excessive.
Le courant de la peinture des lettrés est tout entier dominé par la puissante personnalité de Shen Zhou (1427-1509) ; artiste prodigieusement divers et fécond, nourri d'une vaste culture, à la fois littéraire et esthétique, il a puisé son inspiration surtout chez les « quatre grands maîtres Yuan » (Wu Zhen, Huang Gongwang, Ni Zan et Wang Meng). Son registre est d'une déconcertante variété ; ses grandes compositions sont des constructions intellectuelles élaborées non plus à partir de la nature, mais à partir des œuvres de ses devanciers, subtilement réinterprétées ; dans ses feuillets d'album, par contre, il exprime avec une objectivité candide une vision d'une franchise ferme et savoureuse. Il eut de nombreux disciples : Wen Zhengming (1470-1559) est sans conteste le plus illustre.
Orthodoxes et individualistes
À la fin de l'époque Ming, un autre grand lettré, Dong Qichang (1555-1636), a exercé, par son œuvre et ses théories esthétiques et critiques, une domination incontestée sur la peinture des lettrés : toute l'orthodoxie picturale de l'époque Qing s'est fondée sur ses principes d'académisme éclectique. Dong Qichang cependant, loin d'être le pontife pédant que l'on imagine trop souvent, révèle, dans certains aspects de son œuvre diverse et complexe, une sensibilité aiguë et libre. En marge de l'orthodoxie s'affirme dès l'époque Ming (avec la personnalité violente d'un Xu Wei, 1529-1593, par exemple) un courant individualiste dont les plus remarquables représentants seront, au début de l'époque Qing (seconde moitié du xviie siècle) quelques grands solitaires : Bada Shanren (1625-1705), personnalité excentrique, atteint la perfection dans ses petits formats (fleurs, insectes, oiseaux, rochers, poissons) dont l'insolite simplicité repose sur une extraordinaire science de la composition, remarquable surtout par son usage dynamique des vides ; Shitao (1641-apr. 1717) est un créateur protéiforme, chez qui le philosophe et le mystique sont à la mesure du peintre ; Kuncan, dans sa réclusion monastique, embrasse une vision puissante et tumultueuse de l'univers ; Hongren et Gong Xian, sans disposer d'un registre aussi ample que les précédents, affirment chacun un tempérament d'une fascinante originalité. Il ne faudrait cependant pas forcer l'antithèse entre les orthodoxes et les individualistes, comme certains critiques sont parfois trop tentés de le faire : les orthodoxes ont souvent témoigné dans leurs œuvres de moindre importance d'une audace et d'une liberté comparables à celles des individualistes, et ceux-ci, bien qu'insistant plus particulièrement sur le caractère autonome et égocentrique de la création picturale, ne le cèdent en rien aux orthodoxes sur le chapitre de la culture et de la connaissance des Anciens.
Le goût de l'indépendance cultivé par les individualistes finira par culminer au xviiie siècle dans la flamboyante extravagance des « Huit excentriques de Yangzhou » – dont Zheng Banqiao (ou Zheng Xie, 1693-1765), Li Shan, Jin Nong (1687-1764) – qui sont encore de très grands peintres, bien que n'ayant pas la profondeur de leurs devanciers.
D'autre part, au début de l'époque Qing, le courant orthodoxe a été illustré par les « quatre Wang » : Wang Shimin (1592-1680), Wang Jian (1598-1677), Wang Hui (1632-1717), Wang Yuanqi (1642-1715). L'œuvre de ce dernier est particulièrement attachante : son art, très cérébral, peut paraître aride à l'observateur superficiel, mais il recèle en fait une trame complexe d'allusions plastiques, admirablement unifiée par l'intelligence hardie de la composition. Yun Shouping (1633-1690) et Wu Li (1632-1718) montrent par bien des aspects de leur œuvre que la frontière tracée entre orthodoxes et individualistes est souvent arbitraire.
Aux abords des temps modernes
Le xixe siècle reste une époque encore trop méconnue ; il abonde pourtant en personnalités intéressantes, et le plaisir de l'amateur se double ici de la joie de la découverte. Certaines réputations sont cependant déjà bien établies, ainsi celles de Xugu (1824-1896), peintre de fleurs et d'animaux, et de Ren Bonian (1840-1896), peintre de personnages au talent insolite et truculent, qui aime à créer des effets de contraste en combinant de larges morceaux enlevés à l'emporte-pièce avec des détails d'une exécution minutieuse.
La première moitié du xxe siècle est une période passionnante de la peinture chinoise, mais il serait malaisé d'en établir le bilan en quelques lignes, tant les courants et les maîtres sont nombreux et divers : Huang Binhong (1863-1955), génie intègre et puissant, fut sans doute le plus grand paysagiste chinois moderne ; Pu Xinyu (1887-1964) a illustré avec une noble élégance la permanence des valeurs académiques ; Zhang Daqian (1899-1983) est un éclectique que l'abondance de ses dons a quelque peu gâté ; Qi Baishi (1863-1957) n'a exploré que son petit jardin, mais il en est le roi superbe et candide ; sa triomphale originalité ne doit cependant pas nous faire oublier son grand devancier Wu Changshi (1844-1927) dont l'œuvre n'a pas autant de fraîcheur poétique, mais possède plus de densité et de profondeur. Fu Baoshi (1904-1965) est parfois inégal, mais ses réussites compteront parmi les œuvres les plus importantes du demi-siècle ; de tous les peintres traditionnels, c'est lui peut-être qui fut le plus moderne et le plus révolutionnaire, ayant réussi à intégrer harmonieusement dans la peinture chinoise une conception nouvelle de l'espace. Xu Beihong, souvent désigné sous le nom francisé de Jupéon (1895-1953), fut le plus célèbre de ces pionniers qui, dans les premières années de la République, se rendirent en Europe pour s'initier à la peinture à l'huile ; sur le plan artistique, son œuvre assez faible survivra difficilement, mais il lui restera le mérite historique d'avoir été l'un des premiers à aborder de plein front l'étude de la peinture occidentale et le problème de son adaptation à l'art chinois. Depuis, des expériences plus significatives se sont développées dans ce sens, mais le problème est encore loin d'être résolu, et l'on peut supposer qu'il occupera (avec son corollaire, l'exploration de la tradition picturale chinoise par l'Occident) une bonne part des énergies créatrices de la seconde moitié du siècle.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Corinne DEBAINE-FRANCFORT : docteur-chercheur au C.N.R.S. (UMR 7041) , directeur de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine)
- Daisy LION-GOLDSCHMIDT : chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michel NURIDSANY : critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition
- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Pierre RYCKMANS
:
reader , Department of Chinese, Australian National University - Alain THOTE : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, membre de l'Institut
Classification
Médias
Autres références
-
ASTRONOMIE
- Écrit par James LEQUEUX
- 11 343 mots
- 20 médias
Quant auxChinois, ils pratiquent l’astronomie depuis l’Antiquité. Ils s’intéressent alors surtout aux événements temporaires survenant dans le ciel et qui leur paraissent comme autant de présages : éclipses, apparition d’étoiles nouvelles, de comètes, etc. Ils consignent soigneusement... -
CALENDRIERS
- Écrit par Jean-Paul PARISOT
- 9 907 mots
- 4 médias
Nos connaissances surl'astronomie et le calendrier chinois sont dues au travail monumental réalisé entre 1723 et 1759 par le jésuite français Antoine Gaubil. Pendant les trente-six années qu'il passe à Pékin, sa fonction de traducteur et d'interprète lui permet d'être en contact permanent avec la cour... -
CHINE - Hommes et dynamiques territoriales
- Écrit par Thierry SANJUAN
- 9 801 mots
- 5 médias
...comme l'extension d'un monde chinois qui trouve son foyer originel dans le bassin moyen du fleuve Jaune dès le IIe millénaire avant J.-C. Plus largement, la Chine se veut le foyer de civilisation de l'Asie orientale dans la mesure où elle était elle-même l'ensemble du monde, « tout ce qui était sous le... -
CHINE : L'ÉNIGME DE L'HOMME DE BRONZE (exposition)
- Écrit par Viviane REGNOT
- 934 mots
L'expositionChine : l'énigme de l'homme de bronze. Archéologie du Sichuan (XIIe-IIIe s. av. J.-C.), un des sommets de l'année de la Chine en France, eut lieu du 14 octobre 2003 au 28 janvier 2004 à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Elle avait pour commissaires...
- Afficher les 10 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- ILLUMINATION
- PEINTURE SUR PAPIER
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- COLONNE
- PIERRE, sculpture
- GRÈS, poterie dure
- CHINOISE PEINTURE
- DRAPÉ, sculpture
- MONUMENTALE SCULPTURE
- FUNÉRAIRE SCULPTURE
- BRONZE, sculpture
- SOIE PEINTURE SUR
- CHINOISE SCULPTURE
- CHINOISE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE PEINTURE
- TOMBEAU
- BANPO CULTURE DE
- DALLE FUNÉRAIRE
- FONTE DANS L'ART
- CANON, esthétique
- OR ORFÈVRERIE D'
- BOUDDHIQUE ART
- PARURE
- SCULPTURE RELIGIEUSE
- SCULPTURE DÉCORATIVE
- HAUT-RELIEF
- BAMBOU
- MODELÉ, arts
- BLEU & BLANC, céramique
- CHINOIS ART
- AMULETTE
- CHINOIS JARDIN
- ROCAILLE STYLE
- INSCRIPTIONS, archéologie
- ESTAMPAGE REPRODUCTION PAR
- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire
- TEMPLE
- BLEU DE COBALT
- CONSOLE, architecture
- BEI QI [PEI TS'I] STATUAIRE DES
- CALLIGRAPHIE CHINOISE
- ENCRE, peinture
- COUVERTE, céramique
- CÉLADON
- LI TANG (1050 env.-? 1130)
- HU [HOU], poterie
- MINGQI [MING-K'I], céramique
- MEIPING [MEI-P'ING] VASE
- MA YUAN (actif vers 1190-1225)
- REN BONIAN [JEN PO-NIEN] (1840-1896)
- GLAÇURE, céramique
- FOGUANGSI [FO-KOUANG-SSEU] SALLE DU
- GÉOMANCIE
- NÉPHRITE, gemme
- ZHENGZHOU, site archéologique
- SHANG SÉPULTURES
- DIAN [TIEN], pavillon
- TANG [T'ANG] LES (618-907)
- YU, pierre précieuse
- SYMBOLE DANS L'ART
- YUE, céramique chinoise
- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)
- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)
- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)
- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE
- WEI, royaumes et dynasties chinois
- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)
- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne
- INCRUSTATION, technique décorative
- GALETS, industrie lithique
- CHAN & ZEN ARTS
- RITES FUNÉRAIRES
- COLLECTIONNEURS
- TEINTURE
- INDIGO
- ENCEINTE
- PEINTRE-LETTRÉ
- QING ART DES
- BAS-RELIEF
- VASES
- FUNÉRAIRE ART
- FU BAOSHI [FOU PAO-CHE] (1904-1965)
- SUPPORT, arts plastiques
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- CIMETIÈRE
- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- VANNERIE
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- MOULAGE
- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART
- LANTIAN [LAN-T'IEN]
- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire
- HUILE PEINTURE À L'
- PINCEAU TECHNIQUE DU
- MICROLITHES, préhistoire
- TOMBE
- NÉCROPOLE
- TUMULUS
- MOBILIER FUNÉRAIRE
- TEMPLE, Extrême-Orient
- GALERIES D'ART
- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire
- BRONZE ART DU
- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE PEINTURE, Chine
- EXTRÊME-ORIENT ART D'
- CHINE, préhistoire
- CÉRAMIQUE CHINOISE
- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES
- BOIS, architecture
- FERME, charpente
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU
- CHARPENTE
- CIRE PERDUE, techniques
- RIZICULTURE
- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire
- MAJIAYAO CULTURE DE
- HEMUDU CULTURE DE
- DAWENKOU CULTURE DE
- QINGLIANGANG CULTURE DE
- LIANGZHU CULTURE DE
- QUJIALING CULTURE DE
- ERLITOU [EUL-LI-T'EOU] CULTURE D'
- ERLIGANG [EUL-LI-KANG]
- ANYANG, site archéologique
- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire
- TAILLE DES ROCHES DURES
- LITHIQUES INDUSTRIES
- VILLE, urbanisme et architecture
- TERRE CUITE, poterie
- BOUDDHISME CHINOIS
- RITUELS DE LA CHINE
- ÉLITES
- MÉTALLURGIE, histoire
- CIVILE ARCHITECTURE
- ANIMALIER ART
- MUDRĀ
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- MARCHÉ DE L'ART
- CHAMBRE FUNÉRAIRE
- EXTRÊME-ORIENT, architecture
- EXTRÊME-ORIENT, sculpture
- EXTRÊME-ORIENT, peinture
- FOSSE, sépulture
- LONGMEN, Chine
- GROTTES BOUDDHIQUES
- PALÉOZOOLOGIE
- TAOTIE, masque
- MAWANGDIU [MA-WANG-TIEOU], site archéologique
- AGRAFE, parure
- PINGTUO, technique
- MANCHENG [MAN-TCH'ENG], site archéologique
- BI ou PI, Chine
- MING SÉPULTURES
- WULIANGZI [WOU-LEANG-TSEU], site archéologique
- TIANLONGSHAN [T'IEN-LONG-CHAN], grottes bouddhiques
- LI DI [LI TI] (1100 env.-apr. 1197)
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- XUJIAYAO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CISHAN CULTURE DE
- PEILIGANG CULTURE DE
- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire
- TAOSI CULTURE DE
- HONGSHAN CULTURE DE
- CHANGZIYAI SITE PRÉHISTORIQUE DE
- MAJIABANG CULTURE DE
- DAXI CULTURE DE
- SHIXIA CULTURE DE
- BAIYANGCUN CULTURE DE
- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FU HAO TOMBE DE
- COUR, architecture
- FIGURINE
- TOUR DE POTIER
- PAPIERS DÉCOUPÉS
- LAVIS
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- ARGILE, poterie
- ARGILE, sculpture
- TERRE CUITE, sculpture
- XING XING ou GROUPE DES ÉTOILES
- HUANG YONG PING (1954-2019)
- XU BING (1955- )
- ZHANG XIAOGANG (1958- )
- HUANG RUI (1952- )
- YUE MIJUN (1962- )
- ZHOU CHUNYA (1955- )
- ZHANG HUAN (1965- )
- SONG DONG (1966- )
- XU ZHEN (1977- )
- YANG FUDONG (1971- )
- MARTIN JEAN-HUBERT (1944- )
- SINOGRAMME ou CARACTÈRE CHINOIS