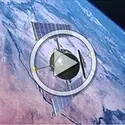- 1. Évolution générale
- 2. Préhistoire et archéologie
- 3. L'Âge du bronze
- 4. Orfèvrerie
- 5. Jade
- 6. Ivoire
- 7. Architecture
- 8. Jardins
- 9. Mobilier
- 10. Sculpture
- 11. Calligraphie et peinture
- 12. Estampes et gravures
- 13. Estampage
- 14. Céramique
- 15. Émaux
- 16. Arts populaires
- 17. Le connaisseur chinois
- 18. L'art contemporain
- 19. Bibliographie
CHINOISE CIVILISATION Les arts
Article modifié le
L'art contemporain
En Chine, l'art contemporain est un produit d'importation. En Occident, il se développe à partir d'une histoire, certes constamment remise en cause, mais inlassablement poursuivie. Ainsi Buren peut-il se réclamer de Matisse, Stella de Caravage. En Chine, l'art contemporain ne marque pas seulement une rupture radicale avec la tradition asiatique lettrée, c'est tout simplement un moyen d'expression autre, qui apparaît à la fin des années 1970. Cet art, rapidement assimilé par les jeunes Chinois se développe alors, accompagnant les avancées victorieuses de l'économie.
On doit se pénétrer de ces évidences pour bien comprendre, sur fond de réussite économique libérale et de pouvoir communiste, à la fois le dynamisme de la scène artistique chinoise récente, les réussites de l'art vidéo à la fin des années 1990, les nombreux voyages et séjours des artistes à l'étranger, les fortes sommes atteintes par les œuvres contemporaines chinoises en vente publique à New York, à Londres et à Hong Kong, en 2008, la chute des cotes en 2009... et le retour de la censure aujourd'hui.
Le tournant des années 1970
Certes, des artistes chinois sont venus peindre à Paris au début du xxe siècle. Rentrés dans leur pays frottés de modernité européenne, ils eurent en fait peu d'influence sur la création chinoise des années 1920 et des décennies suivantes. Sans vrai passé, l'art contemporain chinois naît d'une décision : celle de Mao Zedong, en 1950, d'importer le modèle réaliste socialiste soviétique en Chine dans le contexte du rapprochement avec l'U.R.S.S. Le champ de l'art se réduit alors à celui de la propagande figurant, dans des postures héroïques, des paysans, des ouvriers et Mao sur des affiches peintes à la main. Les techniques de la soie et de l'encre sont alors abandonnées au profit de l'huile et de la toile. Pour mesurer la révolution que cela représente, il faut rappeler que la peinture à l'huile était ravalée par les peintres lettrés au rang d'artisanat d'art. À travers la technique de l'huile, c'est la possibilité de reprendre et de corriger le « geste premier » qui les gênait, alors que la peinture à l'encre sur soie privilégie la spontanéité alliée à la maîtrise.
Au début des années 1970, en l'absence d'atelier de peinture à l'huile, il faut tout inventer, se grouper pour apprendre. Tout commence pour l'art contemporain chinois, après la révolution culturelle (1966-1976) et la mort de Mao (1976), quand naît le mythique groupe des Étoiles (Xing Xing). Composé de Huang Rui, Wang Keping, leaders du groupe qui comprend une dizaine de membres dont une femme, Li Shuang, les Étoiles s'inventent dans l'urgence, sans lieu pour exposer si ce n'est les appartements des diplomates étrangers, parfois la rue. La parole se libère. Les verrous sautent. On ose beaucoup dans une atmosphère électrique.
Le 27 septembre 1979, les Étoiles n'ont pas reçu l'autorisation d'exposer à l'intérieur du Musée national des beaux-arts, leur travail étant jugé trop expérimental. Ils accrochent alors leurs toiles, leurs dessins leurs gravures à l'extérieur, sur les grilles entourant le bâtiment. Deux jours plus tard, la police interdit l'intervention, certes, mais pendant deux jours on s'est précipité pour la voir.
Des artistes se solidarisent avec eux, défilent, exigent la liberté d'expression. Un an après, les artistes du groupe des Étoiles obtiennent l'autorisation de monter leurs œuvres à l'intérieur du musée, au dernier étage. Le succès est incontestable : 80 000 personnes viennent voir l'exposition qui dure 16 jours.
La réponse ne se fait pas attendre : en 1983, une association d'artistes hostiles, forte d'un millier de membres, lance une campagne contre l'art contemporain qui aboutit à une Exposition d'Art national, prônant « l'élimination de la pollution spirituelle dans le monde artistique », et d'abord l'influence étrangère.
Ouvertures
De 1979 à 1984, les « réformateurs » décollectivisent l'exploitation agricole, suppriment les communes populaires, libéralisent le commerce et l'artisanat. Deng Xiaoping lance son fameux « Enrichissez-vous ! ».
L'art contemporain profite de ces ouvertures. L'époque est confuse politiquement mais aussi artistiquement, agitée de soubresauts, traversée sans doute de réactions hostiles mais également de multiples adhésions, de tentatives de toutes sortes. Les artistes découvrent pêle-mêle l'impressionnisme, le surréalisme et Marcel Duchamp. Des expositions clandestines s'organisent partout, inégales sans doute mais enthousiastes. Elles ferment parfois quelques heures après le vernissage, mais on recommence ailleurs.
Le pouvoir assouplit la censure sur la culture. Des groupes se forment dans toute la Chine : le Groupe Zéro à Changsha, celui de l'art du Nord à Harbin. Wang Du crée un salon des artistes de la Chine du Sud et Fine Art in China, un journal spécialisé qui va servir de lien entre les artistes. On découvre la performance. Certaines durent trois jours. C'est dans cette atmosphère euphorique que Rauschenberg arrive à Pékin puis à Lhassa, où il présente avec un immense succès une rétrospective de ses œuvres.
Les magiciens de la terre
En 1989, au Musée national des beaux-arts de Pékin, l'exposition China/Avant-garde fédère toute cette effervescence. Dans la bonne humeur et le chahut, 185 artistes s'y trouvent réunis. On lance au sol de longs draps avec des slogans, on montre de la peinture traditionnelle et de la peinture abstraite. On accueille des installations et des performances. Au cours de l'une d'elle, signée Xiao Lu et Tang Song, des coups de feu sont tirés. La police arrête les auteurs et ferme l'exposition.
Cette même année, le groupe des Étoiles fête son Xe anniversaire à la nouvelle galerie Hanart TZ à Hong Kong (avec une extension à Taipei). Au Centre Georges-Pompidou à Paris, Jean-Hubert Martin ouvre l'art contemporain aux artistes non occidentaux lors de l'exposition Les Magiciens de la terre. Pour la première fois des artistes chinois (et même un tibétain : Temba Rabden) vont exposer leurs œuvres dans une grande manifestation internationale : Gu Dexin, Yang Jiechang, Yongping Huang, ainsi orthographiés dans le catalogue. Ce dernier, de loin le meilleur des trois, s'installera peu après à Paris.
Cette même année également ont lieu les événements de la place Tiananmen. Ces événements dramatiques n'empêchent pas la poursuite de la transformation de l'économie, qui connaît même une relance. Le président Jiang Zemin multiplie les contacts avec les milieux artistiques, laissant entendre qu'une certaine impertinence pourra être tolérée pourvu qu'elle reste dans des limites « acceptables ».
Ce qu'on a appelé le « pop politique » se développe dans ce créneau étroit, procédant par allusion et dérision. Figure emblématique de cet art cynique qui a séduit les marchands occidentaux, Wang Gangyi a parfaitement compris ce que souhaite le régime. S'inspirant de Warhol, il incarne un art qui associe et confronte deux types de sociétés, l'une communiste et l'autre libérale, opposant formellement l'emphase du réalisme socialiste et l'efficacité de l'esthétique commerciale.
À la fin des années 1980, on distingue cinq artistes phares.
Huang Yong Ping (1954-2019) se fait remarquer à Xiamen, sa ville natale, brûlant ses toiles qu'on refuse de montrer, exposant les cendres ainsi produites. Il crée le groupe Xiamen Dada. En 1999, il sera invité avec Jean-Pierre Bertrand dans le pavillon français à la biennale de Venise alors qu'il n'est pas encore naturalisé. Il figure après cela dans de nombreux rendez-vous internationaux. En 2008, il effectue un retour triomphal à Pékin au Centre Ullens pour l'art contemporain avec une importante rétrospective de son travail.
Xu Bing (né en 1955) invente une écriture aux allures d'idéogrammes sur toiles ou venant s'inscrire dans des installations de grandes dimensions qui interrogent la question du sens à travers la langue. Dès 1990, il expose aux États-Unis où il s'installe. Revenu à Pékin et nommé en 2008 vice-président de l'Académie des beaux-arts, il occupe aujourd'hui une place centrale sur la scène chinoise.
Zhang Xiaogang (né en 1958) est un peintre plus secret que les autres. Réfutant l'explication de son art par la politique, il met en scène des familles au regard grave, vues de face, reliées par des fils rouges. Son art, qui refuse de céder à la dérive critique des années 1990, privilégie une atmosphère hypnotique, s'ouvre au mystère.
Ai Weiwei (né en 1957) et Huang Rui (né en 1952) sont perçus comme des provocateurs. Ce sont des opposants. Le premier est un adepte des coups d'éclat. Courageux, voire téméraire, il dénonce ouvertement via Internet, ce que cherche à cacher le régime. D'autre part, entouré de nombreux collaborateurs, il cumule les activités d'artiste, photographe, éditeur, marchand, galeriste, commissaire d'exposition et architecte. Il a collaboré au design du « nid d'oiseau », le stade des Jeux Olympiques à Pékin. Le second est avant tout un meneur. Cofondateur du groupe des Étoiles, il sera aussi à l'origine du plus important des quartiers de galeries d'art à Pékin, l'Espace 798 à Dashanzi.
Les années vidéo
Les années 1990 partagent leur dynamisme entre la performance, la vidéo naissante et la peinture dite « cynique » qui a la faveur des médias occidentaux. L'un des artistes les plus en vue, Yue Mijun (né en 1962) se représente – parfois en plusieurs exemplaires – dans toutes sortes de situations le crâne rasé avec un large sourire béat, même devant le peloton d'exécution. Zhou Chunya (né en 1955), quant à lui, est célèbre pour les représentations de son chien vert à la gueule rouge sang. C'est ce que l'Occident attend de la peinture chinoise : un point de vue critique sur le régime.
Très inventive, la performance prolifère, peut-être en réaction contre cet art ambigu. Dans la lignée des actionnistes viennois et américains des années 1970, Zhang Huan (né en 1965) éprouve les limites de résistance de son corps. Ainsi dans sa performance intitulée 12 square meters (1994), enduit d'huile de poisson et de miel, il se tient immobile pendant une heure, couvert d'abeilles, dans une latrine pestilentielle tandis qu'on le photographie. La nuit du nouvel an de 1996, une nuit de passage, Song Dong (né en 1966), tout en allusions discrètes plus poétiques que politiques, s'étend à plat ventre sur la place Tiananmen, souffle, déposant sur le sol une mince couche de glace qui fond aux premières heures du jour. Ian Lei (né en 1965), plus mordant, envoie en 1997 à de nombreux artistes chinois une fausse invitation à exposer à la Documenta de Kassel, révélant les attentes et les frustrations du milieu.
La performance appelle la vidéo qui sert à conserver des traces de cet art éphémère. Puis, en Chine comme ailleurs, la vidéo se développera en tant qu'art autonome.
D'emblée, dans ce domaine, les vidéastes chinois se situent au niveau international. À la biennale de Venise, en 2001, le tout jeune Xu Zhen (né en 1977) présente une vidéo intitulée Rainbow (1998) où l'on voit rosir son dos flagellé par un fouet invisible. Une façon de peindre pour ce trublion aigu. À la Documenta en 2002 et à la biennale de Venise en 2007, Yang Fudong (né en 1971) montre ses vidéos en noir et blanc mettant en scène des jeunes gens qui cherchent à donner un sens à leur vie dans de longues déambulations d'une insondable et fascinante vacuité.
Au cours des années 2000, le dynamisme économique qui accompagne la société de consommation en marche déborde sur le territoire de l'art contemporain. Créée en 1996, la galerie Shanghart dirigée par un Suisse, Lorenz Helbling, participe à la foire de Bâle dès l'an 2000. En 2000 et en 2002, la biennale de Shanghai (créée en 1996) acquiert une audience internationale. Après, elle retombe à un niveau médiocre.
Au tournant de l'an 2000, Xu Zhen devenu directeur artistique de la galerie BizArt et un autre artiste, Yang Zhenzhong (né en 1968), vont faire de Shanghai le centre du renouveau de la vie artistique chinoise avec des expositions en forme de coups d'éclat. Citons Art for sale (1999) présentée dans un grand magasin puis, à l'occasion de la biennale de 2002, Jumelles, étrange exposition en miroir et Fuck off (2000) organisée par Ai Weiwei qui déclenche les investigations du F.B.I. et de Scotland Yard, à la suite d'une performance intitulée Eating people au cours de laquelle l'artiste Zhu Yu (né en 1970) aurait cuit et mangé en public un fœtus mort-né.
Après l'euphorie des années 1999 à 2002, la scène artistique se déplace de Shanghai à Pékin qui compte peu de galeries, très disséminées, tenues, comme à Shanghai, par des étrangers. Le mouvement commence vers 2003 autour de Huang Rui et Bérénice Angrémy à Dashanzi dans un espace d'usines désaffectées qui deviendra le 798 Art District. Ils ouvrent là une galerie, un loft et un café avant de créer le festival international des arts de Dashanzi. D'autres artistes s'installent dans des lofts, puis viennent des galeries telles que Continua et la première galerie chinoise, Long March. On compte là près de 300 galeries, de nombreux restaurants et boutiques de toutes sortes quand, en 2007, l'industriel et collectionneur Guy Ullens ouvre U.C.C.A. (Ullens Center for Contemporary Art), première institution culturelle à but non lucratif en Chine et vaste lieu d'exposition, dont l'inauguration constitue un évènement.
Parallèlement, les cotes des artistes chinois s'envolent en vente publique, atteignant des prix record, qui engendrent une vision plus spéculative qu'artistique ou culturelle de l'art contemporain en Chine. L'envolée commence en 2006 quand Bloodline series : Comrade no 120 de Zhang Xiaogang (né en 1958) triple son estimation chez la maison de vente Sotheby's pour être adjugée à 979 200 dollars. Ce record est largement dépassé en mai 2008, chez Christie's à Hong Kong, quand la peinture Masques, séries 1996, no 6 de Zeng Fanzhi (né en 1964) atteint 9,7 millions de dollars.
Depuis lors, les cotes se sont effondrées, les invendus atteignent 50 p. 100 à Hong Kong dans un climat de crise financière, certes, mais aussi de défiance, l'art contemporain chinois n'apparaissant plus ni aussi attrayant artistiquement parlant, ni aussi sûr comme valeur marchande. À Dashanzi, de nombreuses galeries ferment. Certes, non loin de là, à Caochangdi, un nouveau quartier émerge Et d'importantes galeries internationales s'y implantent. Certes, à l'école des Beaux-Arts, on constate une effervescence nouvelle avec l'arrivée de Xu Bing comme vice-président. Né, dit-on, de la peur qu'à le pouvoir de ne plus réussir à contrôler un monde de l'art trop actif, le retour de la censure inquiète.
Après les succès des années 2000 en Chine et sur la scène internationale, des années sombres s'annoncent-elles pour l'art contemporain chinois ? Rien n'est assuré, ni dans le pire ni dans le meilleur. Mais chaque artiste sait aujourd'hui qu'une menace plane sur lui et que la liberté pourrait redevenir plus surveillée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Corinne DEBAINE-FRANCFORT : docteur-chercheur au C.N.R.S. (UMR 7041) , directeur de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine)
- Daisy LION-GOLDSCHMIDT : chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michel NURIDSANY : critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition
- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Pierre RYCKMANS
:
reader , Department of Chinese, Australian National University - Alain THOTE : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, membre de l'Institut
Classification
Médias
Autres références
-
ASTRONOMIE
- Écrit par James LEQUEUX
- 11 343 mots
- 20 médias
Quant auxChinois, ils pratiquent l’astronomie depuis l’Antiquité. Ils s’intéressent alors surtout aux événements temporaires survenant dans le ciel et qui leur paraissent comme autant de présages : éclipses, apparition d’étoiles nouvelles, de comètes, etc. Ils consignent soigneusement... -
CALENDRIERS
- Écrit par Jean-Paul PARISOT
- 9 907 mots
- 4 médias
Nos connaissances surl'astronomie et le calendrier chinois sont dues au travail monumental réalisé entre 1723 et 1759 par le jésuite français Antoine Gaubil. Pendant les trente-six années qu'il passe à Pékin, sa fonction de traducteur et d'interprète lui permet d'être en contact permanent avec la cour... -
CHINE - Hommes et dynamiques territoriales
- Écrit par Thierry SANJUAN
- 9 801 mots
- 5 médias
...comme l'extension d'un monde chinois qui trouve son foyer originel dans le bassin moyen du fleuve Jaune dès le IIe millénaire avant J.-C. Plus largement, la Chine se veut le foyer de civilisation de l'Asie orientale dans la mesure où elle était elle-même l'ensemble du monde, « tout ce qui était sous le... -
CHINE : L'ÉNIGME DE L'HOMME DE BRONZE (exposition)
- Écrit par Viviane REGNOT
- 934 mots
L'expositionChine : l'énigme de l'homme de bronze. Archéologie du Sichuan (XIIe-IIIe s. av. J.-C.), un des sommets de l'année de la Chine en France, eut lieu du 14 octobre 2003 au 28 janvier 2004 à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Elle avait pour commissaires...
- Afficher les 10 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- ILLUMINATION
- PEINTURE SUR PAPIER
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- COLONNE
- PIERRE, sculpture
- GRÈS, poterie dure
- CHINOISE PEINTURE
- DRAPÉ, sculpture
- MONUMENTALE SCULPTURE
- FUNÉRAIRE SCULPTURE
- BRONZE, sculpture
- SOIE PEINTURE SUR
- CHINOISE SCULPTURE
- CHINOISE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE PEINTURE
- TOMBEAU
- BANPO CULTURE DE
- DALLE FUNÉRAIRE
- FONTE DANS L'ART
- CANON, esthétique
- OR ORFÈVRERIE D'
- BOUDDHIQUE ART
- PARURE
- SCULPTURE RELIGIEUSE
- SCULPTURE DÉCORATIVE
- HAUT-RELIEF
- BAMBOU
- MODELÉ, arts
- BLEU & BLANC, céramique
- CHINOIS ART
- AMULETTE
- CHINOIS JARDIN
- ROCAILLE STYLE
- INSCRIPTIONS, archéologie
- ESTAMPAGE REPRODUCTION PAR
- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire
- TEMPLE
- BLEU DE COBALT
- CONSOLE, architecture
- BEI QI [PEI TS'I] STATUAIRE DES
- CALLIGRAPHIE CHINOISE
- ENCRE, peinture
- COUVERTE, céramique
- CÉLADON
- LI TANG (1050 env.-? 1130)
- HU [HOU], poterie
- MINGQI [MING-K'I], céramique
- MEIPING [MEI-P'ING] VASE
- MA YUAN (actif vers 1190-1225)
- REN BONIAN [JEN PO-NIEN] (1840-1896)
- GLAÇURE, céramique
- FOGUANGSI [FO-KOUANG-SSEU] SALLE DU
- GÉOMANCIE
- NÉPHRITE, gemme
- ZHENGZHOU, site archéologique
- SHANG SÉPULTURES
- DIAN [TIEN], pavillon
- TANG [T'ANG] LES (618-907)
- YU, pierre précieuse
- SYMBOLE DANS L'ART
- YUE, céramique chinoise
- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)
- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)
- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)
- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE
- WEI, royaumes et dynasties chinois
- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)
- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne
- INCRUSTATION, technique décorative
- GALETS, industrie lithique
- CHAN & ZEN ARTS
- RITES FUNÉRAIRES
- COLLECTIONNEURS
- TEINTURE
- INDIGO
- ENCEINTE
- PEINTRE-LETTRÉ
- QING ART DES
- BAS-RELIEF
- VASES
- FUNÉRAIRE ART
- FU BAOSHI [FOU PAO-CHE] (1904-1965)
- SUPPORT, arts plastiques
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- CIMETIÈRE
- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- VANNERIE
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- MOULAGE
- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART
- LANTIAN [LAN-T'IEN]
- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire
- HUILE PEINTURE À L'
- PINCEAU TECHNIQUE DU
- MICROLITHES, préhistoire
- TOMBE
- NÉCROPOLE
- TUMULUS
- MOBILIER FUNÉRAIRE
- TEMPLE, Extrême-Orient
- GALERIES D'ART
- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire
- BRONZE ART DU
- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE PEINTURE, Chine
- EXTRÊME-ORIENT ART D'
- CHINE, préhistoire
- CÉRAMIQUE CHINOISE
- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES
- BOIS, architecture
- FERME, charpente
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU
- CHARPENTE
- CIRE PERDUE, techniques
- RIZICULTURE
- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire
- MAJIAYAO CULTURE DE
- HEMUDU CULTURE DE
- DAWENKOU CULTURE DE
- QINGLIANGANG CULTURE DE
- LIANGZHU CULTURE DE
- QUJIALING CULTURE DE
- ERLITOU [EUL-LI-T'EOU] CULTURE D'
- ERLIGANG [EUL-LI-KANG]
- ANYANG, site archéologique
- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire
- TAILLE DES ROCHES DURES
- LITHIQUES INDUSTRIES
- VILLE, urbanisme et architecture
- TERRE CUITE, poterie
- BOUDDHISME CHINOIS
- RITUELS DE LA CHINE
- ÉLITES
- MÉTALLURGIE, histoire
- CIVILE ARCHITECTURE
- ANIMALIER ART
- MUDRĀ
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- MARCHÉ DE L'ART
- CHAMBRE FUNÉRAIRE
- EXTRÊME-ORIENT, architecture
- EXTRÊME-ORIENT, sculpture
- EXTRÊME-ORIENT, peinture
- FOSSE, sépulture
- LONGMEN, Chine
- GROTTES BOUDDHIQUES
- PALÉOZOOLOGIE
- TAOTIE, masque
- MAWANGDIU [MA-WANG-TIEOU], site archéologique
- AGRAFE, parure
- PINGTUO, technique
- MANCHENG [MAN-TCH'ENG], site archéologique
- BI ou PI, Chine
- MING SÉPULTURES
- WULIANGZI [WOU-LEANG-TSEU], site archéologique
- TIANLONGSHAN [T'IEN-LONG-CHAN], grottes bouddhiques
- LI DI [LI TI] (1100 env.-apr. 1197)
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- XUJIAYAO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CISHAN CULTURE DE
- PEILIGANG CULTURE DE
- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire
- TAOSI CULTURE DE
- HONGSHAN CULTURE DE
- CHANGZIYAI SITE PRÉHISTORIQUE DE
- MAJIABANG CULTURE DE
- DAXI CULTURE DE
- SHIXIA CULTURE DE
- BAIYANGCUN CULTURE DE
- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FU HAO TOMBE DE
- COUR, architecture
- FIGURINE
- TOUR DE POTIER
- PAPIERS DÉCOUPÉS
- LAVIS
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- ARGILE, poterie
- ARGILE, sculpture
- TERRE CUITE, sculpture
- XING XING ou GROUPE DES ÉTOILES
- HUANG YONG PING (1954-2019)
- XU BING (1955- )
- ZHANG XIAOGANG (1958- )
- HUANG RUI (1952- )
- YUE MIJUN (1962- )
- ZHOU CHUNYA (1955- )
- ZHANG HUAN (1965- )
- SONG DONG (1966- )
- XU ZHEN (1977- )
- YANG FUDONG (1971- )
- MARTIN JEAN-HUBERT (1944- )
- SINOGRAMME ou CARACTÈRE CHINOIS