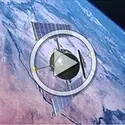- 1. Évolution générale
- 2. Préhistoire et archéologie
- 3. L'Âge du bronze
- 4. Orfèvrerie
- 5. Jade
- 6. Ivoire
- 7. Architecture
- 8. Jardins
- 9. Mobilier
- 10. Sculpture
- 11. Calligraphie et peinture
- 12. Estampes et gravures
- 13. Estampage
- 14. Céramique
- 15. Émaux
- 16. Arts populaires
- 17. Le connaisseur chinois
- 18. L'art contemporain
- 19. Bibliographie
CHINOISE CIVILISATION Les arts
Article modifié le
Ivoire
Des techniques minutieuses
La production des ivoires chinois s'étend sur plus de trois millénaires. Ils peuvent se répartir en catégories distinctes, liées à leur époque, leur destination et la disponibilité de la matière première. Sous les dynasties Shang et Zhou, l'éléphant était indigène dans le nord et le centre de la Chine ; l'ivoire, matière précieuse, était réservé à des objets rituels ou cérémoniels destinés au roi ou à la noblesse. Aux environs de l'ère chrétienne et pendant les siècles qui suivirent, l'éléphant ne subsiste qu'en Chine du Sud et l'ivoire semble avoir été importé occasionnellement de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les pièces connues sont rares et difficiles à dater. En revanche, à partir des Yuan et surtout des Ming, la production devient de plus en plus abondante et variée, servie par un commerce maritime intense qui répand en Chine l'ivoire de l'Asie et de l'Afrique. Enfin, dès le début du xviiie siècle, apparaît une fabrication massive destinée à l'exportation vers l'Europe ; elle se poursuivra jusqu'aux temps modernes, mais a sombré très vite dans la pure virtuosité.
L'ivoire se travaille facilement avec des outils de métal, dans le sens du grain pour éviter les éclats ; il permet un rendu réaliste et minutieux des détails. En vieillissant, l'ivoire prend une patine chaude et brillante que ne peut égaler aucun procédé artificiel (fumées de tabac, ocre, tanin). Sa résistance au temps, sa douceur au toucher après polissage en ont fait un matériau très apprécié des lettrés chinois. La taille est l'ouvrage d'artisans groupés en corporations, qui ne signent leurs œuvres que très rarement. Par contre, beaucoup de pièces sont datées ou portent un poème gravé. Les ivoires peuvent être finement incisés, sculptés, ajourés, incrustés de turquoises ou d'autres matières précieuses. À certaines époques, ils ont été rehaussés de couleurs, laqués ou dorés.
Une production variée
Les ivoires archaïques, qui remontent à 1300 environ avant J.-C., sont de petites dimensions : épingles à large tête, pièces d'ornement, manches d'objets rituels, et ne subsistent souvent qu'à l'état de fragments. Ils portent le même décor gravé que les bronzes, les marbres, les jades contemporains : masques dragons, spirales, cigales. Ce décor évoluera, comme celui des bronzes, à l'époque Zhou, vers un style animalier plus souple. Parmi les plus importants des ivoires archaïques figurent un beau masque de taotie, d'époque Shang, et une pièce d'applique de la fin des Zhou, ornée de dragons entrelacés dans le style des bronzes du ve siècle (musée Guimet, Paris).
Sous les dynasties suivantes, les ivoires sont rares ; les seuls que l'on puisse dater avec certitude, de l'époque Tang, se trouvent dans le trésor du Shōsōin, à Nara (Japon) : pièces ornementales, instruments de musique, dés à jouer, manches d'éventail ou de poignard.
Les Ming inaugurent une ère d'abondante production ; ce sont des statuettes, religieuses ou profanes, traitées avec simplicité et dont l'attitude et les draperies souples s'adaptent à la courbe de la défense ; ce sont tous les accessoires du lettré (pots à pinceaux, appuie-bras, écrans de table), ainsi que ceux des fumeurs d'opium. Il faut encore mentionner les ivoires « médicaux » – ils offrent un des seuls exemples de nudités féminines dans l'art chinois –, les sceaux, dont quelques exemplaires impériaux nous sont parvenus, et les ornements des mandarins. Sous les Qing, la variété est plus grande encore et l'habileté technique va croissant. Outre un atelier impérial fondé en 1682 et resté actif jusqu'en 1796, des centres fonctionnent à Canton, Shanghai, Amoy, Ningbo ; il est d'ailleurs impossible d'identifier leurs productions respectives. Il semble cependant que les pièces les plus fouillées proviennent du Sud, tandis que les décors du Nord sont à la fois plus sobres et plus robustes.
Depuis le début du xviiie siècle, les ateliers de Canton sont spécialisés dans les ivoires d'exportation, qui deviennent des exercices de virtuosité répondant au goût européen pour l'exotique et l'insolite. Tels sont les éventails ajourés, les « boules de Canton » aux nombreuses sphères concentriques, les jeux d'échecs et toutes sortes de bibelots, jusqu'aux maquettes de temples, de pagodes, de palais, tous reproduits avec un grand luxe de détails.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Corinne DEBAINE-FRANCFORT : docteur-chercheur au C.N.R.S. (UMR 7041) , directeur de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine)
- Daisy LION-GOLDSCHMIDT : chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michel NURIDSANY : critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition
- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Pierre RYCKMANS
:
reader , Department of Chinese, Australian National University - Alain THOTE : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, membre de l'Institut
Classification
Médias
Autres références
-
ASTRONOMIE
- Écrit par James LEQUEUX
- 11 343 mots
- 20 médias
Quant auxChinois, ils pratiquent l’astronomie depuis l’Antiquité. Ils s’intéressent alors surtout aux événements temporaires survenant dans le ciel et qui leur paraissent comme autant de présages : éclipses, apparition d’étoiles nouvelles, de comètes, etc. Ils consignent soigneusement... -
CALENDRIERS
- Écrit par Jean-Paul PARISOT
- 9 907 mots
- 4 médias
Nos connaissances surl'astronomie et le calendrier chinois sont dues au travail monumental réalisé entre 1723 et 1759 par le jésuite français Antoine Gaubil. Pendant les trente-six années qu'il passe à Pékin, sa fonction de traducteur et d'interprète lui permet d'être en contact permanent avec la cour... -
CHINE - Hommes et dynamiques territoriales
- Écrit par Thierry SANJUAN
- 9 801 mots
- 5 médias
...comme l'extension d'un monde chinois qui trouve son foyer originel dans le bassin moyen du fleuve Jaune dès le IIe millénaire avant J.-C. Plus largement, la Chine se veut le foyer de civilisation de l'Asie orientale dans la mesure où elle était elle-même l'ensemble du monde, « tout ce qui était sous le... -
CHINE : L'ÉNIGME DE L'HOMME DE BRONZE (exposition)
- Écrit par Viviane REGNOT
- 934 mots
L'expositionChine : l'énigme de l'homme de bronze. Archéologie du Sichuan (XIIe-IIIe s. av. J.-C.), un des sommets de l'année de la Chine en France, eut lieu du 14 octobre 2003 au 28 janvier 2004 à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Elle avait pour commissaires...
- Afficher les 10 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- ILLUMINATION
- PEINTURE SUR PAPIER
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- COLONNE
- PIERRE, sculpture
- GRÈS, poterie dure
- CHINOISE PEINTURE
- DRAPÉ, sculpture
- MONUMENTALE SCULPTURE
- FUNÉRAIRE SCULPTURE
- BRONZE, sculpture
- SOIE PEINTURE SUR
- CHINOISE SCULPTURE
- CHINOISE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE PEINTURE
- TOMBEAU
- BANPO CULTURE DE
- DALLE FUNÉRAIRE
- FONTE DANS L'ART
- CANON, esthétique
- OR ORFÈVRERIE D'
- BOUDDHIQUE ART
- PARURE
- SCULPTURE RELIGIEUSE
- SCULPTURE DÉCORATIVE
- HAUT-RELIEF
- BAMBOU
- MODELÉ, arts
- BLEU & BLANC, céramique
- CHINOIS ART
- AMULETTE
- CHINOIS JARDIN
- ROCAILLE STYLE
- INSCRIPTIONS, archéologie
- ESTAMPAGE REPRODUCTION PAR
- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire
- TEMPLE
- BLEU DE COBALT
- CONSOLE, architecture
- BEI QI [PEI TS'I] STATUAIRE DES
- CALLIGRAPHIE CHINOISE
- ENCRE, peinture
- COUVERTE, céramique
- CÉLADON
- LI TANG (1050 env.-? 1130)
- HU [HOU], poterie
- MINGQI [MING-K'I], céramique
- MEIPING [MEI-P'ING] VASE
- MA YUAN (actif vers 1190-1225)
- REN BONIAN [JEN PO-NIEN] (1840-1896)
- GLAÇURE, céramique
- FOGUANGSI [FO-KOUANG-SSEU] SALLE DU
- GÉOMANCIE
- NÉPHRITE, gemme
- ZHENGZHOU, site archéologique
- SHANG SÉPULTURES
- DIAN [TIEN], pavillon
- TANG [T'ANG] LES (618-907)
- YU, pierre précieuse
- SYMBOLE DANS L'ART
- YUE, céramique chinoise
- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)
- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)
- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)
- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE
- WEI, royaumes et dynasties chinois
- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)
- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne
- INCRUSTATION, technique décorative
- GALETS, industrie lithique
- CHAN & ZEN ARTS
- RITES FUNÉRAIRES
- COLLECTIONNEURS
- TEINTURE
- INDIGO
- ENCEINTE
- PEINTRE-LETTRÉ
- QING ART DES
- BAS-RELIEF
- VASES
- FUNÉRAIRE ART
- FU BAOSHI [FOU PAO-CHE] (1904-1965)
- SUPPORT, arts plastiques
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- CIMETIÈRE
- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- VANNERIE
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- MOULAGE
- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART
- LANTIAN [LAN-T'IEN]
- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire
- HUILE PEINTURE À L'
- PINCEAU TECHNIQUE DU
- MICROLITHES, préhistoire
- TOMBE
- NÉCROPOLE
- TUMULUS
- MOBILIER FUNÉRAIRE
- TEMPLE, Extrême-Orient
- GALERIES D'ART
- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire
- BRONZE ART DU
- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE PEINTURE, Chine
- EXTRÊME-ORIENT ART D'
- CHINE, préhistoire
- CÉRAMIQUE CHINOISE
- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES
- BOIS, architecture
- FERME, charpente
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU
- CHARPENTE
- CIRE PERDUE, techniques
- RIZICULTURE
- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire
- MAJIAYAO CULTURE DE
- HEMUDU CULTURE DE
- DAWENKOU CULTURE DE
- QINGLIANGANG CULTURE DE
- LIANGZHU CULTURE DE
- QUJIALING CULTURE DE
- ERLITOU [EUL-LI-T'EOU] CULTURE D'
- ERLIGANG [EUL-LI-KANG]
- ANYANG, site archéologique
- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire
- TAILLE DES ROCHES DURES
- LITHIQUES INDUSTRIES
- VILLE, urbanisme et architecture
- TERRE CUITE, poterie
- BOUDDHISME CHINOIS
- RITUELS DE LA CHINE
- ÉLITES
- MÉTALLURGIE, histoire
- CIVILE ARCHITECTURE
- ANIMALIER ART
- MUDRĀ
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- MARCHÉ DE L'ART
- CHAMBRE FUNÉRAIRE
- EXTRÊME-ORIENT, architecture
- EXTRÊME-ORIENT, sculpture
- EXTRÊME-ORIENT, peinture
- FOSSE, sépulture
- LONGMEN, Chine
- GROTTES BOUDDHIQUES
- PALÉOZOOLOGIE
- TAOTIE, masque
- MAWANGDIU [MA-WANG-TIEOU], site archéologique
- AGRAFE, parure
- PINGTUO, technique
- MANCHENG [MAN-TCH'ENG], site archéologique
- BI ou PI, Chine
- MING SÉPULTURES
- WULIANGZI [WOU-LEANG-TSEU], site archéologique
- TIANLONGSHAN [T'IEN-LONG-CHAN], grottes bouddhiques
- LI DI [LI TI] (1100 env.-apr. 1197)
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- XUJIAYAO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CISHAN CULTURE DE
- PEILIGANG CULTURE DE
- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire
- TAOSI CULTURE DE
- HONGSHAN CULTURE DE
- CHANGZIYAI SITE PRÉHISTORIQUE DE
- MAJIABANG CULTURE DE
- DAXI CULTURE DE
- SHIXIA CULTURE DE
- BAIYANGCUN CULTURE DE
- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FU HAO TOMBE DE
- COUR, architecture
- FIGURINE
- TOUR DE POTIER
- PAPIERS DÉCOUPÉS
- LAVIS
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- ARGILE, poterie
- ARGILE, sculpture
- TERRE CUITE, sculpture
- XING XING ou GROUPE DES ÉTOILES
- HUANG YONG PING (1954-2019)
- XU BING (1955- )
- ZHANG XIAOGANG (1958- )
- HUANG RUI (1952- )
- YUE MIJUN (1962- )
- ZHOU CHUNYA (1955- )
- ZHANG HUAN (1965- )
- SONG DONG (1966- )
- XU ZHEN (1977- )
- YANG FUDONG (1971- )
- MARTIN JEAN-HUBERT (1944- )
- SINOGRAMME ou CARACTÈRE CHINOIS