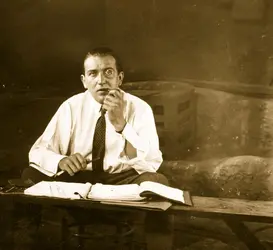CINÉMA (Aspects généraux) Histoire
Article modifié le
La première projection du cinématographe Lumière a lieu le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Le nouvel art puisera abondamment dans le trésor dramatique aussi bien théâtral que romanesque, du xixe siècle finissant. Il lui empruntera sa puissance d'évocation liée à l'appétit de conquête d'une société industrielle en plein essor. Il prolongera sa vocation à l'universel.
Ni Dickens, ni Dumas père (morts en 1870), ni Dostoïevski (mort en 1881), ni Herman Melville (mort en 1891), ni Dumas fils (mort en 1893) n'ont pu soupçonner les immenses virtualités cinématographiques de leurs œuvres. Au cours de ces mêmes années naissent D. W. Griffith (1875), Carl Dreyer (1889), Fritz Lang (1890), Jean Renoir (1894), John Ford (1895) et S. M. Eisenstein (1898).
À l'aube du xxe siècle, au moment où tous les arts se découvrent dans une impasse et doivent se soumettre à des mutations, le jeune cinéma voit s'ouvrir devant lui le plus vaste et le plus neuf des champs d'investigation.
Le temps des pionniers (1895-1914)
« Le vocabulaire le plus riche »
Le cinéaste ignore, pour l'instant, les scrupules et les doutes de l'artiste moderne.
En France, Louis Lumière se contente de cinématographier, comme il a toujours photographié, avec une science discrète de la composition. Il filme la sortie de ses usines, l'entrée d'un train en gare, une baignade en mer, une partie d'écarté, un bocal de poissons rouges. Il envoie ses opérateurs à travers le monde filmer Venise ou le couronnement du tsar Nicolas II. Le cinéma permet désormais d'enregistrer un événement, du plus mince au plus considérable, dans sa durée propre. Il donne corps à la fugacité même. Le cinéma ne reproduit pas seulement le réel, il fixe à raison de 16 (puis de 24) images par seconde des moments d'attention pure, exacte, singulière. Jusqu'à Lumière, la réalité n'était que le modèle proposé à l'artiste. Dès ses premiers films, elle change radicalement de fonction en devenant une matière, aussi digne que le marbre du sculpteur, la couleur du peintre, les mots de l'écrivain. « Écrire pour le cinéma, écrire des films, dira plus tard Alexandre Astruc, c'est écrire avec le vocabulaire le plus riche qu'aucun artiste ait eu jusqu'ici à sa disposition, c'est écrire avec la pâte du monde. »
Le spectacle et le récit
Parallèlement, Georges Méliès poursuit par d'autres voies son métier d'illusionniste. Il se sert du même appareil pour saper les vérités irréfutables établies par Lumière. Les personnages apparaissent, disparaissent, se substituent les uns aux autres, voyagent « à travers l'impossible ». L'« automaboulof », dans ce film tourné en 1904, emporte ses passagers dans le Soleil, puis retombe sur la Terre et s'enfonce dans l'océan, mais une explosion le ramène à la surface. La seule magie de la réalité découverte par Lumière ne suffit plus. Il s'agit, comme dit Guillaume Apollinaire, rendant visite à Méliès, d'« enchanter la vulgaire réalité ». La poésie du Voyage dans la Lune (1902), de L'Homme à la tête de caoutchouc (1901) ou des Quatre Cents Farces du diable (1906) est d'autant plus sensible, aujourd'hui, qu'elle ne se donne pas d'abord comme poésie. La fantaisie et la fièvre hallucinatoire qui emportent les films de Méliès visent avant tout à l'effet de surprise ou d'émerveillement, à l'effet de spectacle.
La caméra de Lumière nous éveille au monde. Méliès tend derrière ses personnages les toiles peintes de l'inconscient collectif. Avec les cinéastes anglais de l'école de Brighton, le cinéma découvre sa troisième fonction, celle du récit visuel. Anciens photographes de plage, Williamson et Smith seront les premiers à faire valoir l'utilisation du découpage et des différentes échelles de plans. Dans La Loupe de grand-mère, réalisé en 1900 par G. A. Smith, des gros plans de détail s'insèrent dans le tableau principal. La loupe du garçonnet isole successivement une montre, un canari, l'œil de grand-mère ou la tête du chat.
Thèmes et tensions
Avant la guerre de 1914, le cinéma explore les voies où il s'engagera dans les cinquante années suivantes. L'appât du gain aidant, l'art se confond très vite avec la fabrication et le commerce de pellicule impressionnée. En France, Charles Pathé et Léon Gaumont bâtissent leur empire. Aux États-Unis, William Fox, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, les frères Warner s'emparent du marché de l' exploitation avant de conquérir les instruments de production. Le cinéma international est une gigantesque foire d'empoigne, où la propriété artistique se débite au mètre, où l'on s'attaque allégrement aux plus grands thèmes de la culture universelle. En 1904, Ferdinand Zecca tourne La Passion en s'inspirant de tableaux célèbres, dont La Cène de Vinci. Or c'est déjà la troisième vie du Christ portée à l'écran, sans compter Le Christ marchant sur les eaux (1899) de Méliès. Le cinéma exploite tous les thèmes existants avant de donner un éclat jusqu'alors inconnu à certains d'entre eux, qui apparaîtront bientôt comme les siens propres : l' érotisme, le grand spectacle, le réalisme, le suspense, la tarte à la crème, le western.
Déjà les premières tensions apparaissent. La projection de sujets grivois, dans les nickelodeons (permanents à 5 cents) américains, suscite une première levée de boucliers des ligues de vertu, qui imposent la création d'une censure, ou plutôt de quarante-huit censures différentes, correspondant à chacun des États américains. Mais l'érotisme reparaît au Danemark, qui invente la vamp (avec Asta Nielsen) et filme le baiser prolongé. À la veille de la guerre, les cinéastes danois Urban Gad (L'Abîme, Le Vertige) et Holger Madsen (Les Morphinomanes, L'Amitié mystique) se sont acquis une réputation internationale.
L'Italie invente le « peplum », c'est-à-dire l'épopée historico-légendaire à grand spectacle. Les cinéastes italiens bénéficient du soleil, des décors et d'une figuration à bon marché. On construit les remparts de Troie, on déploie les légions romaines, on jette les chrétiens aux lions. Gabriele d'Annunzio signe le scénario de Cabiria (1914), mais c'est Giovanni Pastrone qui l'écrit et le réalise. Ce film marque l'apogée du genre.
Cependant, la tradition réaliste se maintient face à l'épopée et au drame mondain. Zola inspire Les Victimes de l'alcoolisme (1902) de Zecca, Germinal (1913) de Capellani, la série de films de La Vie telle qu'elle est (1911-1913) de Louis Feuillade, ainsi qu'une Thérèse Raquin italienne réalisée par Nino Martoglio (1915). La contradiction du réalisme et de la fiction apparaît féconde, comme en témoigne la série des Fantomas, réalisée en 1913 par Feuillade, qui lançait trois ans plus tôt le manifeste de La Vie telle qu'elle est (« Ces scènes, écrivait-il, veulent être et sont des tranches de vie. Elles s'interdisent toute fantaisie et représentent les choses et les gens tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être »). La poésie de Fantomas et des Vampires (1915) s'inscrira tout naturellement dans la réalité du paysage parisien.
En 1908, le « film d'art » se propose d'élever le niveau de la production cinématographique. Cette contradiction entre l'esthétique et le spectacle populaire est assez grave, dans la mesure où elle demeure théorique et par conséquent promise à un bel avenir de malentendus. On ouvre donc les portes du cinéma aux gloires de la littérature et de la Comédie-Française. L'Assassinat du duc de Guise (scénario de Lavedan, musique de Saint-Saëns, réalisation de Le Bargy) connaît un grand succès mondain. Les ambitions académiques du « film d'art » s'opposent à la fraîcheur d'invention des bandes comiques de l'époque (André Deed, Jean Durand, Max Linder), à la merveilleuse naïveté des films à épisodes et des mélodrames, à tout ce qui fait, précisément, le génie des primitifs.
« Ceux qui nous ont précédés avaient bien de la veine, dira Jean Renoir en 1948 : pellicule orthochromatique interdisant toute nuance et forçant l'opérateur le plus timide à accepter des contrastes violents ; pas de son, ce qui amenait l'acteur le moins imaginatif et le metteur en scène le plus vulgaire à l'emploi de moyens d'expression involontairement simplifiés.
« Heureux les potiers étrusques qui, pour la décoration de leurs vases, ne connaissaient que deux couleurs... / « Heureux les faiseurs de films qui se croyaient encore des forains. »
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CERISUELO : professeur d'études cinématographiques et d'esthétique à l'université Gustave-Eiffel, Marne-la-Vallée
- Jean COLLET : docteur ès lettres, professeur à l'université de Paris-V-René-Descartes, critique de cinéma
- Claude-Jean PHILIPPE : journaliste
Classification
Médias
Autres références
-
ACTEUR
- Écrit par Dominique PAQUET
- 6 818 mots
- 1 média
Aux débuts du cinéma, l'acteur ne paraît pas un instant différent de l'acteur de théâtre. Car ce sont les mêmes qui, dans les premiers films de Méliès, interprètent les textes classiques. De même, dans le cinéma expressionniste, la technique de monstration et de dévoilement de l'expression appartient... -
AFRICAINS CINÉMAS
- Écrit par Jean-Louis COMOLLI
- 1 131 mots
L'histoire des cinémas africains se sépare difficilement de celle de la décolonisation. Il y eut d'abord des films de Blancs tournés en Afrique. Puis, à partir des années soixante, les nouveaux États africains ont été confrontés au problème de savoir quel rôle, quelle orientation, quels...
-
ALLEMAND CINÉMA
- Écrit par Pierre GRAS et Daniel SAUVAGET
- 10 274 mots
- 6 médias
Le cinéaste Volker Schlöndorff a suggéré que l'histoire du cinéma allemand était faite d'une série de ruptures esthétiques mais aussi d'une grande continuité dans le domaine de l'industrie cinématographique. L'alternance entre les phases les plus inventives, comme celles des années 1918-1933, voire...
-
AMENGUAL BARTHÉLEMY (1919-2005)
- Écrit par Suzanne LIANDRAT-GUIGUES
- 758 mots
L'œuvre d'écrivain de cinéma de Barthélemy Amengual est considérable, autant par sa quantité (une douzaine d'ouvrages et une multitude d'articles) que par l'acuité de son propos. Comparable aux meilleurs analystes français de sa génération (tels André Bazin ou ...
- Afficher les 100 références
Voir aussi
- AMÉRICAIN CINÉMA
- MACCARTHYSME
- KOULECHOV LEV VLADIMIROVITCH (1899-1970)
- EXPLOITATION, cinéma
- EPSTEIN JEAN (1897-1953)
- ASTRUC ALEXANDRE (1923-2016)
- DOUBLAGE, cinéma
- TOURNAGE, cinéma
- SYNCHRONISATION
- TRUCAGE, cinéma
- CINÉMA TECHNIQUES DU
- JAPONAIS CINÉMA
- SPECTACLE
- DÉCOUPAGE, cinéma
- CRICHTON CHARLES (1910-1999)
- ACTEURS ET ACTRICES, cinéma
- IVORY JAMES (1928- )
- CINEMA NOVO, Brésil
- CINÉMA THÉORIES DU
- CINÉMA ET THÉÂTRE
- CINÉPHILIE
- BLOCKBUSTER
- NEWELL MIKE (1942- )
- CORÉEN CINÉMA
- ADAPTATION DES ŒUVRES
- RÉALISME, cinéma
- SOVIÉTIQUE CINÉMA
- FINLANDAIS CINÉMA
- DANOIS CINÉMA
- CINÉMA MUET
- ANGLAIS CINÉMA
- FRANÇAIS CINÉMA
- POLONAIS CINÉMA
- ITALIEN CINÉMA
- SUÉDOIS CINÉMA
- CINÉMATOGRAPHE
- RÉALISATION, cinéma
- CINÉMA HISTOIRE DU
- MOSJOUKINE IVAN (1889-1939)
- ÉROTISME, cinéma
- PÉPLUM
- SMITH GEORGE ALBERT (1864-1959)
- ZECCA FERDINAND (1864-1947)
- CINÉMA POLITIQUE
- IRANIEN CINÉMA
- GUERRA RUY (1931- )
- DISTRIBUTION, cinéma
- BRÉSILIEN CINÉMA
- POLITIQUE CULTURELLE
- MONTAGE, cinéma
- TAÏWAN CINÉMA DE
- HORREUR CINÉMA D'