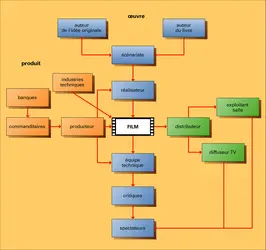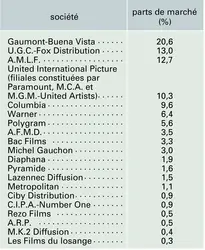CINÉMA (Aspects généraux) L'industrie du cinéma
Article modifié le
Le cinéma d'auteur en question
La « mort du cinéma » appartient à une rhétorique qui hante le paysage audiovisuel depuis quelques dizaines d'années. Après avoir accompagné les chocs technologiques : le tout télévision, la généralisation de la vidéo, elle se mêle aujourd'hui aux peurs que fait naître l'univers du numérique. Pourtant la salle de cinéma reste bien vivante et de nombreux jeunes gens gardent l'envie de s'exprimer au moyen de la caméra. Le spectre de la crise apparaît de nouveau en France, où existe un système très codifié d'intervention publique dans la production et la diffusion. Des diagnostics pessimistes émergent des variations incontrôlables du marché, des difficultés qu'ont les jeunes cinéastes à trouver un public et à obtenir des financements qui soient à la hauteur de leurs ambitions, des rapports de pouvoir avec la télévision, enfin d'un déséquilibre croissant entre le cinéma dominant et le cinéma dominé. Entendons par ce dernier terme le cinéma ambitieux, créatif, indépendant, le cinéma d'auteur à la française, qui n'est pas le cinéma d'auteur de l'âge classique, celui des cinéastes capables d'imposer une touche personnelle au sein des grands studios, mais plutôt celui de réalisateurs qui pensent leur travail sur le modèle de celui de l'écrivain. Si crise il y a, elle renvoie sans doute à celle d'un système de production, mais aussi à une crise d'identité.
Un système qui repose sur les aides de l'État
« Si le cinéma français est en crise, c'est depuis 1895 ! », aurait dit, à la fin des années 1980, un directeur du Centre national de la cinématographie, embarrassé par la baisse des performances du cinéma français et agacé par les admonestations des professionnels. Bien que ne résistant guère à l'analyse, la phrase conserve une petite part de vérité, dans la mesure où l'évolution artistique et économique du cinéma s'est faite par à-coups, par alternance d'échecs et de réussites, d'assoupissements et d'innovations. Depuis la Seconde Guerre mondiale et sa perte d'hégémonie au profit de Hollywood, le cinéma français est à la recherche de lui-même. Dans les années 1950, il a entrepris la conquête d'une légitimité culturelle qui s'est appuyée sur la complémentarité avec l'économie. Aucun pays au monde n'a à ce point associé financement matériel et ambition qualitative, initiative privée et encadrement par l'État : réglementation de l'ensemble de la filière film, rapports cinéma-télévision, déploiement des avances, subventions et avantages fiscaux, pacification des rapports entre branches, soutien aux établissements culturels et aux festivals, insertion du cinéma dans l'enseignement. Il en est résulté une politique du cinéma, concrète, enviée dans sa diversité par les professionnels des pays voisins, constituée en modèle aux yeux de l'Europe. Un système responsable à bien des égards de la résistance dont le cinéma national a fait preuve sur son propre marché face à l'hégémonie du cinéma-monde américain, comme de la vitalité et du renouvellement de la création cinématographique.
Depuis le tournant du xxe siècle, après des années de satisfaction, le temps est venu des critiques, internes et externes, le temps des constats rigoureux qui mettent en évidence la misère, voire la « violence » (le terme a été employé par la réalisatrice Pascale Ferran en 2007), dissimulées sous les succès commerciaux et les récompenses obtenues dans les festivals. Aux années 1990 qui ont vu l'affirmation d'une ou de plusieurs nouvelles vagues de cinéastes affichant un programme de cinéma d'auteur, succède ainsi le désenchantement. On jette un regard plus critique sur les œuvres, on s'interroge sur le jeune cinéma, on renoue avec la contestation du rôle de la télévision. On devient plus sensible également aux menaces pesant sur le système d'aides, aux risques de réformes néo-libérales, et on craint un désengagement de l'État. Le modèle français, qui se veut un dépassement de la contradiction existant entre le commercial et le culturel, n'en a pas pour autant évacué les ambiguïtés constitutives du septième art.
Cette politique du cinéma – copiée pour partie dans d'autres pays européens comme dans d'autres secteurs culturels –, qui a favorisé, sur le marché, des prélèvements destinés au développement, à l'innovation, au renouvellement, à la culture, au prestige, se voit désormais fragilisée. Pour une meilleure compréhension de cette situation, un bref retour en arrière est nécessaire.
La longue marche vers une politique du cinéma
« Par ailleurs, le cinéma est une industrie. » La phrase de Malraux si souvent citée n'est, en réalité, que la conclusion en forme d'esquive d'une étude d'esthétique parue en 1946 (Esquisse d'une psychologie du cinéma) qui, précisément, s'abstient d'aborder la question économique. Malgré son apparente indifférence aux contingences indissociables d'une expression cinématographique, c'est ce même Malraux, devenu ministre de la Culture, qui prendra à partir de 1959 une série de mesures diversifiant l'intervention publique dans ce domaine. Il s'agit alors de dépasser les oppositions simplistes en intégrant du qualitatif dans le dispositif qui depuis une dizaine d'années traite le cinéma en termes seulement quantitatifs, alors même que cette « industrie » française du cinéma, si on la compare à Hollywood, est dotée de structures artisanales – ce qui est toujours le cas cinquante ans plus tard.
Malraux puis ses successeurs, en particulier Jack Lang dans les années 1980, ont fait évoluer un fonds spécial qui fonctionne selon un principe élémentaire : il s'agit d'une taxe prélevée sur les tickets vendus par les salles de cinéma qui à l'origine disposaient du monopole de l'exploitation du film, et exclusivement réservée au secteur du cinéma. Le produit de cette taxe se trouve réinvesti dans les projets des producteurs, proportionnellement aux résultats de leur film antérieur. On a donc affaire à un prélèvement sur le marché, qui épargne le budget général de l'État et doit son existence aux seuls consommateurs de cinéma. La filière film tout entière bénéficiera du produit de cette taxe qui, à l'origine, consistait en une aide purement économique, où l'argent va à l'argent, un succès engendrant une aide importante, un échec réduisant le droit à un soutien. Le système a évolué de manière à freiner les effets pervers de ces modalités automatiques, à intégrer les nouveaux entrants, et à renforcer peu à peu les aides qualitatives et culturelles, dites sélectives, sans annuler celles à caractère strictement économiques, automatiques.
Du point de vue de l'histoire, le calendrier des premières innovations (l'avance sur recettes et l'aide aux salles d'art et d'essai) coïncide pratiquement avec celui de la Nouvelle Vague, même si les premiers longs-métrages des Chabrol, Truffaut, Godard, Rohmer, Resnais ont été tournés avant que les premières mesures innovantes soient prises, dans la foulée d'une « prime à la qualité » qui avait été accordée après réalisation à des films de Bresson, Jacques Baratier, Pierre Kast et Louis Malle, ainsi qu'au Beau Serge de Chabrol.
Grâce à cette nouvelle politique du cinéma, le mouvement de rénovation du cinéma français a pu s'appuyer sur des bases plus fermes, d'abord par les aides à la production. La liste des cinéastes bénéficiaires de l'avance sur recettes dans les années 1970, période où ce type d'aide (en principe remboursable, mais seulement si les recettes d'exploitation le permettent) atteint son rythme de croisière, constitue un impressionnant tableau d'honneur : en bénéficieront René Allio, Bertrand Blier, Robert Bresson, Alain Cavalier, Franck Cassenti, André Delvaux, Jacques Doillon, Jacques Doniol-Valcroze, Marguerite Duras, Jean Eustache, René Feret, Jean-Luc Godard, Benoît Jacquot, William Klein, Chris Marker, Claude Miller, Maurice Pialat, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Jacques Rozier, Jean-Daniel Simon, Bertrand Tavernier, André Téchiné, Agnès Varda – pour ne citer que les plus connus et les plus significatifs. Car il faudrait citer aussi ceux qui n'ont pu, ou pas voulu, continuer dans la voie de la mise en scène cinématographique (Robert Benayoun, Peter Brook, Pierre-William Glenn, Michel Polac, Jerôme Savary, Jean-Louis Trintignant...), et d'autres, considérés comme plus attentifs au grand public – Yves Boisset, Costa-Gavras, Robert Enrico, Barbet Schroeder, Pascal Thomas par exemple.
Perfectionné avec le temps, le Soutien financier de l'État à l'industrie du cinéma (S.F.E.I.C.) est une structure caractérisée par une grande diversité des interventions au titre du sélectif, dont les ressources se sont étendues à des prélèvements touchant les autres supports de diffusion du film de cinéma, la télévision et la vidéo, redevables de nouvelles contributions en échange de quelques avantages dans le financement des programmes depuis les années 1985-1987. Telle quelle, cette architecture a permis au cinéma français de conserver une part importante sur son propre marché. Elle a assuré l'existence du secteur recherche-développement que toute industrie se doit de constituer.
L'heure des remises en cause
Ainsi cette histoire institutionnelle témoigne-t-elle à la fois de la légitimation culturelle d'un divertissement, de l'importance accordée au cinéma en France, et d'une analyse rigoureuse de ce qu'est fondamentalement celui-ci : une industrie culturelle (une industrie du copyright, dit-on aujourd'hui aux États-Unis), productrice de prototypes, donc d'une part de création relevant de l'art. En harmonie avec les ambiguïtés propres au cinéma, le modèle français, encourageant à la fois l'industrie et l'art, ne peut échapper à l'ambiguïté. Sur un marché national de dimensions insuffisantes, l'innovation ne peut être soutenue par les seules entreprises. La fragilité du secteur exige le concours de fonds publics, voire une réglementation favorable dans la sphère de la diffusion, et seule l'existence des indépendants détermine de nouvelles créations. En résumé, il s'agit de corriger les tendances lourdes du marché pour garantir l'existence d'un cinéma d'auteur suffisamment varié.
Le système français encourage de ce fait une expression nationale – et même, jusqu'à une date récente, exclusivement dans la langue nationale. Seules les entreprises de droit français ont accès au Compte de soutien. Les Américains, cycliquement, expriment leur insatisfaction devant cette forme de protectionnisme, bien conscients que ce sont leurs programmes qui dominent les audiences du cinéma, de la télévision et de la vidéo, ce qui a évidemment une conséquence sur les prélèvements effectués. Toutes les mesures qui ont permis au cinéma français de résister, du moins sur le marché intérieur, peuvent être remises en cause à l'heure de la mondialisation. Le prestige international que connaît l'exception culturelle à la française n'a pas éliminé les menaces émanant des partisans d'une libre circulation des produits culturels sans préférence nationale. Les autorités de Bruxelles font pression de manière récurrente sur le modèle français, au nom de la suppression des entraves à la concurrence, et contestent la territorialité des aides et les obligations des chaînes de télévision, qui ne sont préservées que par un moratoire fragile. Jusqu'à présent amortie dans la sphère du politique, une contestation analogue s'exprime aussi en France, renforcée par une exigence de résultats mesurés en termes comptables. « Du point de vue de l'État, il n'y a pas d'exception culturelle : dans le domaine de la culture comme ailleurs, il faut se demander si l'argent public est bien dépensé et se donner les moyens d'apprécier l'efficacité de la dépense », dit un rapport de la Commission des finances du Sénat consacré au cinéma et daté de 2003. L'alliance du néo-libéralisme et des audits à courte vue menace donc le débat sur la diversité culturelle et le pluralisme que le modèle français se propose de garantir. Ainsi s'explique l'inquiétude des militants du cinéma d'auteur et des catégories professionnelles qui ne sont présentes que sur le segment le plus culturel, en termes de marché : une « niche » bien éloignée des médias de masse.
Bref, c'est la fin des certitudes, marquée par l'apparition des « déclinologues » et des « refondateurs », bien dans l'air du temps. Quoi qu'il en soit, le système s'essouffle. Ses lois ont généralisé la recherche des préfinancements (État, chaînes de télévision, options payantes prises par les diverses branches). Elles ont déconnecté le film de son public originel, les sommes investies par le producteur ne provenant pas directement du spectateur ; l'anticipation de recettes par la prévente des droits de diffusion domine la logique de production, de manière à se prémunir contre les aléas du marché. De telles pratiques peuvent condamner le cinéma d'auteur et le confiner dans une logique de subvention où on ne se soucie plus de la place du spectateur.
Ces phénomènes sont aggravés du fait qu'un film normal ne se finance plus, désormais, qu'avec le concours financier des chaînes de télévision. La participation des chaînes en clair est acquise à la moitié des films français, tandis que les pré-achats de la chaîne payante Canal Plus ont porté pendant plusieurs années sur quatre films sur cinq ; la chaîne cryptée, « grand argentier du cinéma français », apporte le premier concours financier, devant les interventions des fonds publics. Bien que ses difficultés des années 2003-2004 et celles de sa maison mère Vivendi aient obligé à réduire la voilure, elle participe encore au financement de deux tiers des films, et fournit 17 p. 100 des capitaux mobilisés par la production, sans compter les investissements de ses propres filiales de production. Canal Plus est intervenu, il est vrai, dans les domaines du documentaire et du court-métrage, mais le soutien au petit film d'auteur, personnel et innovant, s'est effrité, les achats étant rarement consacrés aux œuvres à petit budget qui pourtant dominent l'effectif annuel du long-métrage de fiction. La récente réduction des concours financiers de la part de l'ensemble des chaînes a provoqué la faillite de quelques producteurs indépendants, devenus paradoxalement trop dépendants de leurs partenaires.
La responsabilité du secteur audiovisuel porte aussi sur la nature des films. Au-delà des exigences techniques et thématiques qu'elle impose, elle exerce sur le cinéma son pouvoir en privilégiant logiquement l'adéquation aux critères d'audience qui lui sont propres. Arte est la seule chaîne à prendre quelques risques artistiques, à condition que cela ne coûte pas très cher, étant donné la modestie de sa participation sur chaque film, soit un sixième de l'intervention moyenne de T.F.1 sur les films que la chaîne la plus marchande retient. La télévision, dont on dit qu'elle a failli tuer le cinéma, a bien constitué un moteur de son développement pendant une vingtaine d'années. La baisse du niveau de ses investissements, la réduction des cases horaires consacrées au cinéma sur les grandes chaînes, en particulier dans le secteur public, imposent la révision de ce schéma d'explication, car les dangers résident dans la tutelle artistique autant que dans celle économique. Alors qu'un cinéma spectaculaire, un cinéma d'action, de genre, connaît une renaissance en France sous l'impulsion d'un Luc Besson, le cinéma d'auteur le plus ambitieux voit les obstacles se multiplier sur sa route.
Le pouvoir télévisuel se manifeste dans le contrôle a priori sur la naissance d'un film. À preuve l'importance acquise par des comédies hâtivement faites pour exploiter la popularité des vedettes des programmes de distraction réalisés par les chaînes (en particulier par Canal Plus) et qu'on impose au grand écran avec leurs metteurs en image et leurs faiseurs de bons mots. De tels choix rencontrent de plus en plus de critiques, quand ils ne suscitent pas des pamphlets comme celui de Pascal Mérigeau, rédigé au terme de trente années d'observation critique du film et de ses conditions de diffusion, et qui déplore que le cinéma devienne une simple « télévision que l'on peut regarder en sortant de chez soi ». Sur un ton posé, l'universitaire David Vasse évoque, dans son étude thématique et formelle sur le cinéma français actuel « comment le babil télévisuel s'est invité dans le cinéma... » Cette évolution contribue à écraser les virtualités propres au cinéma et, contrairement aux situations du passé, elle a pour effet de contingenter le cinéma d'auteur au lieu de se conjuguer avec lui.
Les enjeux de l'indépendance
En 1994 déjà, un dirigeant de Canal Plus avait exposé crûment qu'il fallait « unifier les marchés du cinéma et de la télévision ». Et il ajoutait : « L'indépendance du producteur est une fiction à l'époque où les diffuseurs, contraints ou non, assurent l'essentiel du financement de la production. » Le terme « indépendant » est certes ambivalent. Une entreprise n'est vraiment indépendante que si elle est capable d'agir sans l'intervention de tiers – ce qui est rare dans la production cinématographique, voire inexistant, sauf cas marginal d'autoproduction. Malgré ses ambiguïtés, l'indépendance reste un argument dans les luttes symboliques. Elle mobilise dans l'action les groupes de pression qui rassemblent les catégories dominées. Ce peut être aussi la marque des refusés de la promotion sur les rayons des supermarchés du cinéma et sur les grandes chaînes. Dans la pratique, elle reste une aspiration militante, qui la situe à l'opposé des majors et de l'intégration dans les groupes audiovisuels ou bien dans ceux de la communication qui pénètrent à leur tour dans le champ, comme France Télécom. C'est en général le statut des auteurs de films et des entreprises de production et de distribution qui s'associent avec eux pour affirmer l'autonomie de la conception d'un film, et qui tentent de fournir des arguments pour que le film puisse trouver sa place et son public.
Le grand mérite des institutions du cinéma français est d'avoir su conjuguer la démarche purement commerciale et l'expression personnelle de cinéastes. L'audience atteinte par leurs films a permis de monter de manière suffisamment libre des projets personnels. Ce cinéma d'auteur, largement reconnu au-delà des polémiques entre écoles esthétiques, est celui des grands anciens : Truffaut, Chabrol, Malle, Resnais, mais aussi Maurice Pialat, Bertrand Tavernier, Bertrand Blier, Michel Deville, Claude Miller, Patrice Chéreau. D'autres, comme Patrice Leconte, ont pu se permettre d'alterner des essais personnels et des films grand public. Il faudrait également citer tous ceux qui ont pu faire une vraie carrière d'auteur sans pouvoir s'approcher des sommets du box-office, ni des budgets de superproduction (Jacques Rivette, André Téchiné, Alain Cavalier, Jacques Doillon, Benoît Jacquot).
Bien que les difficultés grandissent, de jeunes générations de cinéastes s'inspirent de ces devanciers. Beaucoup d'auteurs de films ont non seulement émergé aux environs de 1990, mais parviennent encore à travailler de façon plus ou moins régulière – avec toutefois quelques interruptions dues aux difficultés croissantes à monter un projet. Ce qui, pour certains, peut entraîner un détour par le film de genre ou par le documentaire, voire même un bref retour au court-métrage (mais rarement un passage par le téléfilm). Olivier Assayas, Christian Vincent, Manuel Poirier, Laetitia Masson, Noémie Lvovsky, Pascale Ferran, Arnaud Desplechin, Cédric Kahn, Lucas Belvaux, François Dupeyron, Philippe Le Guay, Xavier Beauvois, Bruno Dumont, Laurence Ferreira Barbosa, Gaël Morel, Laurent Bouhnik, Malik Chibane, Tony Gatlif, Nicolas Boukhrief, Christophe Honoré, et d'autres, sont là pour illustrer cette vitalité. Certains ont marqué des points dans le fameux Ciné Chiffres, dont l'influence est bien connue dans le domaine de l'exploitation : Jean-Pierre Jeunet, Cédric Klapisch, François Ozon, Robert Guédiguian, Dominik Moll, Jacques Audiard, Anne Fontaine, Olivier Assayas, Noémie Lvovsky, Lucas Belvaux, Xavier Beauvois. Des réussites qui permettent d'espérer, bien qu'elles soient beaucoup moins nombreuses dans le camp du cinéma d'auteur que les échecs et les désillusions.
Une bonne santé apparente, une constitution fragile
En économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne, disait déjà, au xvie siècle, un certain Thomas Gresham. Si les œuvres qui viennent d'être évoquées prouvent que le mauvais film ne chasse pas complètement le bon, il ne faut pas pour autant qu'une perception trop globalisante brouille celle des véritables problèmes : si le terreau reste favorable, il est nécessaire d'examiner ce qui est dissimulé par une apparence de prospérité.
Ainsi, à l'examen du classique bilan annuel du Centre national de la cinématographie, on se félicite rituellement de la vitalité du cinéma français, en s'appuyant sur trois données principales dont, en premier lieu, la part de marché des films français dans les salles. Variant autour de 40 p. 100 des entrées sur les dernières années (mais avec une grande amplitude d'environ dix points entre les bonnes et les mauvaises années), ce score représente une donnée de grande valeur, il est vrai, surtout lorsqu'on la compare au marché des films en vidéo (23 p. 100 des ventes) ou quand on examine la situation des autres pays européens (les chaînes télévisées ne se prêtent pas à comparaison, car elles se trouvent placées en France sous le régime des quotas minimaux de diffusion de films français). Le deuxième argument est celui du nombre total de films produits en une année, qui est passé de 150 environ, en moyenne, à 213 pour les années 2000-2007. Le troisième critère évoqué est le nombre important de premiers films tournés par de nouveaux réalisateurs, qui a fortement augmenté au début de ce siècle, progressant de 53 à 72 de 2001 à 2007, au lieu de 35 en moyenne au cours de la décennie 1990.
Benoît Jacquot a affirmé que la France est « le seul pays où un garçon de seize ans qui veut être cinéaste peut être sûr de le devenir un jour ». Michel Marie, plus concret, explique que le jeune cinéma existe d'abord statistiquement, dans la mesure où les dispositifs français accordent une prime à la jeunesse, au moyen d'une aide spécifique au premier film, à laquelle on a adjoint une aide au deuxième film qui intervient, il faut le préciser, sur un nombre d'œuvres deux fois moindre. De plus, les films des jeunes auteurs sont pour la plupart à petit budget, inférieurs en moyenne de plus de la moitié au budget moyen de production, lui-même assez faible (moins de cinq millions d'euros, moyenne qui n'a pratiquement pas évolué depuis dix ans). Parvenir à une troisième réalisation dans le long-métrage de fiction, signe qu'une véritable carrière prend forme, est devenu plus héroïque que de réaliser un premier film. Quelques-uns des meilleurs représentants du cinéma d'auteur en ont fait l'expérience, supportant des délais de quatre à cinq années entre leur deuxième et leur troisième film, comme parfois entre le premier et le deuxième (Emmanuelle Cuau, Nicolas Boukhrief, Judith Cahen, Noémie Lvovsky, Erick Zonca, Philippe Le Guay ou Pascal Ferran). Le chemin qui conduit à une vraie reconnaissance est plus ardu que celui de l'apprentissage.
Si l'on excepte les premiers films des stars de la télévision, le secteur des premiers et deuxièmes films est très exactement le domaine où une volonté d'auteur est affichée, et souvent plus affichée que tangible ou certifiée. La plupart de ces premières œuvres, grandes par l'ambition, restent petites par les budgets et par les résultats. Les films « pauvres » ont de moins en moins de chance d'être diffusés sur d'autres supports, et lorsque par exception une chaîne les a pré-achetés ou coproduits, elle les réservera aux tranches horaires les moins regardées. Dans les années 1980 comme dans les années 1950, le court-métrage a été le banc d'essai des nouveaux talents. Les Zonca, Klapisch, Ferran, Ozon, Jeunet, Lvovsky sont en ce sens les successeurs des Resnais, Franju, Kast, Astruc, Agnès Varda, Yannick Bellon. Aujourd'hui c'est le long-métrage de fiction à petit budget qui devient très directement un tel banc d'essai. Ce qui est plus coûteux pour la branche de la production, et plus mortifiant pour les jeunes cinéastes en devenir.
Il faut tenir compte de l'évolution de la diffusion et du comportement du consommateur qui condamnent à l'oubli les films qui ne connaissent pas de résultats probants dès la première semaine, voire dès le premier jour. Les films indépendants, diffusés par des entreprises dotées de faibles moyens, édités à un petit nombre de copies, visibles dans une faible minorité de salles d'art et d'essai, sont vite condamnés. En 2004, Jean-Luc Godard se souvenait que, à une certaine époque, « on disait qu'on faisait le film pour 200 000 amis possibles, aujourd'hui ils sont beaucoup moins nombreux... » L'évolution des chiffres vrais est en effet alarmante. En 2007, une soixantaine de films français n'ont pas atteint les 25 000 entrées. Parmi eux, 35 n'ont pas atteint les 5 000 entrées. Non seulement ils restent très éloignés des seuils de rentabilité, mais leur diffusion est tellement restreinte que certains ne se distinguent plus guère des films projetés hors des circuits commerciaux. Il en est qui sont vus par autant de spectateurs dans une poignée de festivals que dans les salles de cinéma – les festivals offrant une alternative maigrement compensatoire à ces longs-métrages, contrairement à ce qui s'observe dans le domaine du film court.
Les critiques de cinéma, qui ont suivi avec sympathie le jeune cinéma français, affichent un désintérêt croissant qui ne se résume pas à une prise de distance par rapport au militantisme qui les a jadis caractérisés, ni à un recentrage de la presse sur ce qui intéresse « les gens ». Ce cinéma d'auteur, avec ses tics formels appris dans les écoles, parfois immature dans ses thématiques et maladroit dans ses références aux grands modèles dont beaucoup prétendent s'inspirer (Truffaut, Pialat, Rohmer, Doillon), décourage trop souvent – presque autant que les statistiques le concernant.
Le sort de ces films relève aussi d'un problème plus général : y aurait-il trop de films ? Les statistiques de production témoignent de cette surchauffe, avec plus de 200 films par an depuis 2001 (240 en 2005) au lieu de 151 en moyenne dans les années 1990. De même, toutes les parties prenantes estiment qu' on diffuse trop de films en salles : près de 600 titres par an (auxquels s'ajoutent reprises et rééditions), soit un phénomène de saturation qui condamne aux oubliettes des dizaines de films désavantagés par la concurrence, par une promotion insuffisante ou inexistante, et par le désintérêt que leur montrent les médias dominants. Toutes nationalités confondues, l'ensemble des entrées des films à moins de 25 000 entrées ne représente que 1 p. 100 du total des entrées, ce qui illustre la forte concentration d'un marché où les dix plus grands succès mobilisent chaque année près de 30 p. 100 de l'audience en salles, avec comme on sait une forte prééminence américaine. Quant à l'effectif de films produits, après des années de discours optimistes, le C.N.C. lui-même s'est interrogé sur cette production abondante, déséquilibrée, dispersée, « trop nataliste ». Non seulement le marché ne parvient pas à les absorber, mais la faiblesse des budgets affectés aux films non formatés ne peut favoriser la constitution d'une œuvre véritable, alors qu'il existe encore de nombreux cinéphiles très capables de distinguer une œuvre d'un produit même s'il leur arrive d'apprécier un film de pur divertissement.
Le temps des réformes est sans doute revenu
Pendant des années, la concertation entre les pouvoirs publics et les professionnels, y compris les groupes de pression gros et petits, a donné naissance à des réformes consensuelles qui se résument à toujours plus de concours financiers, à de petits correctifs, à de nouvelles subventions, à des mesures visant à freiner des déséquilibres dans la diffusion (par exemple : le tirage de copies supplémentaires, le renforcement des aides aux salles d'art et d'essai programmant des films reconnus difficiles), à la création de nouveaux guichets susceptibles d'apporter des compléments de financement (extension des taxes aux nouveaux supports, abri fiscal, recours aux collectivités territoriales, crédit d'impôt). Fait nouveau, les réflexions s'orientent vers une révision du fonctionnement des lignes de crédit et de soutien les plus importantes, tout particulièrement dans la sphère de la production.
Répondre à ceux qui veulent redonner le pouvoir au vrai producteur, le rendre plus fort économiquement et plus autonome vis-à-vis de ses partenaires télévisuels est la tâche la plus ardue. Elle suppose en effet une autre répartition des avantages du Fonds de soutien aux différents partenaires, qui renforcerait le poids et l'accès au soutien du producteur qui prend l'initiative, et limiterait les avantages des coproducteurs télévisuels. De son côté, le statut du scénariste mériterait d'être renforcé, tant il est vrai que la rémunération de son travail reste faible dans la quasi-totalité des cas et que l'une des faiblesses des films français réside dans la finition des scénarios. Les scénaristes professionnels auront fort à faire entre, d'une part, les techniciens de narration imposés par les chaînes et, d'autre part, l'individualisme attaché au statut de créateur défendu par des réalisateurs qui se veulent des auteurs complets. Cette proposition développée par Pascale Ferran et ses amis nécessitera, pour entrer dans les mœurs, de sérieux changements dans les rapports des producteurs de cinéma avec l'audiovisuel comme dans les habitudes de pensée (légitimes) de ceux qui aspirent à la création. Elle n'en est pas moins fondée sur de vertueuses observations dont il faut tenir compte.
Publié en 2008, le rapport non officiel du Club des 13, ce groupe de professionnels organisé autour de Pascale Ferran, met l'accent sur toute une série de problèmes, et comporte quelques appels discrets à l'État-providence, par exemple afin de rendre à l'avance sur recettes son caractère de levier permettant une vraie production. Ses analyses s'attardent en particulier sur le fossé qui s'est creusé entre les films « riches » et les films « pauvres ». Les premiers obéissent, au fond, à la loi des séries, aux genres fermés sur eux-mêmes, à une normalisation télévisuelle qui ignore le plus souvent la singularité du spectacle cinématographique. Ils bénéficient d'une surexposition qui a pour effet de dégrader l'ensemble de la production. Ce n'est pas seulement de paupérisation que souffrent les petits films, mais aussi de « ghettoïsation », comme disent les auteurs. On pourrait ajouter dans ce diagnostic les comportements autodestructeurs, voire une fuite en avant médiocrement subventionnée de la part des petits indépendants qui ne connaissent plus le public. Les membres du Club des 13 portent le fer sur une question clé : « Le milieu n'est plus un pont mais une faille », disent-ils, dévoilant une analyse essentielle conduisant à une revendication prioritaire. Le titre de l'ouvrage met l'accent sur la nécessité de mieux soutenir des films de budget moyen. Ils sont en effet le fondement même de l'affirmation d'un cinéma de qualité, un pilier du film d'auteur qui permet d'aller véritablement à la conquête d'un public. Car c'est bien le film indépendant de ce type qui a permis de constituer, à différentes époques, un cinéma d'auteur viable et susceptible de créer et de fidéliser un public. Revitaliser cette catégorie constitue effectivement un des enjeux essentiels du cinéma français.
Dans le jeu contrarié des oppostions d'intérêts souvent masquées qui caractérisent l'univers du cinéma et de l'audiovisuel, il n'était pas certain qu'un tel débat soit suivi d'effets. Pourtant, au début de l'année 2011, le ministère de la Culture et de la Communication annonçait la parution d'un décret présenté comme la conclusion des discussions menées avec le Club des 13. Au terme de plusieurs années de concertation avec toutes les professions du cinéma au nom d'une nécessaire « remise à plat », avec notamment un rapporteur-enquêteur qui, très officiellement cette fois, a refait le parcours tracé par ceux qui possédaient une expérience de terrain et qui tiraient la sonnette d'alarme. Trois années aussi, de marchandages avec toutes les branches de la filière cinématographique – non seulement les télévisions, mais aussi le DVD, la vidéo à la demande, etc. Il s'agira essentiellement de nouvelles mesures financières et d'un aménagement du système de soutien de l'État, visant à encourager la liberté des auteurs dans le démarrage d'un projet, à majorer le soutien à des producteurs qui seraient réellement à l'initiative du film : en l'occurrence le « producteur délégué », le vrai producteur, celui qui s'engage avant tout partenariat, et qui signe les contrats avec les artistes et les techniciens.
Les mesures prévues tentent également de restreindre les pouvoirs des chaînes de télévision sur les producteurs. Un objectif délicat au moment où, pour des raisons d'audience, celles-ci ont tendance à intervenir plus fortement sur un nombre moins important de films. En outre, l'équipement numérique des salles de cinéma aggrave le risque de concentration de la programmation et d'écrasement des « petits films » et des « films moyens », et menace la diversification et l'espace de l'Art et Essai. De plus, de nouvelles technologies, comme la télévision directement connectée à Internet, viennent brouiller les conditions du financement et de la concurrence, et perturber la régulation dans la filière cinématographique. Contexte moins clément, on s'en doute, pour le cinéma d'auteur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre-Jean BENGHOZI : directeur de recherche au centre de recherche en gestion de l'École polytechnique
- Daniel SAUVAGET : économiste, critique de cinéma
Classification
Médias
Autres références
-
ACTEUR
- Écrit par Dominique PAQUET
- 6 818 mots
- 1 média
Aux débuts du cinéma, l'acteur ne paraît pas un instant différent de l'acteur de théâtre. Car ce sont les mêmes qui, dans les premiers films de Méliès, interprètent les textes classiques. De même, dans le cinéma expressionniste, la technique de monstration et de dévoilement de l'expression appartient... -
AFRICAINS CINÉMAS
- Écrit par Jean-Louis COMOLLI
- 1 131 mots
L'histoire des cinémas africains se sépare difficilement de celle de la décolonisation. Il y eut d'abord des films de Blancs tournés en Afrique. Puis, à partir des années soixante, les nouveaux États africains ont été confrontés au problème de savoir quel rôle, quelle orientation, quels...
-
ALLEMAND CINÉMA
- Écrit par Pierre GRAS et Daniel SAUVAGET
- 10 274 mots
- 6 médias
Le cinéaste Volker Schlöndorff a suggéré que l'histoire du cinéma allemand était faite d'une série de ruptures esthétiques mais aussi d'une grande continuité dans le domaine de l'industrie cinématographique. L'alternance entre les phases les plus inventives, comme celles des années 1918-1933, voire...
-
AMENGUAL BARTHÉLEMY (1919-2005)
- Écrit par Suzanne LIANDRAT-GUIGUES
- 758 mots
L'œuvre d'écrivain de cinéma de Barthélemy Amengual est considérable, autant par sa quantité (une douzaine d'ouvrages et une multitude d'articles) que par l'acuité de son propos. Comparable aux meilleurs analystes français de sa génération (tels André Bazin ou ...
- Afficher les 100 références
Voir aussi
- AMÉRICAIN CINÉMA
- COPRODUCTION, cinéma
- FILM
- EXPLOITATION, cinéma
- COPIE, film
- FINANCEMENT
- CULTURE SOCIOLOGIE DE LA
- CANAL PLUS
- MAJOR COMPANIES
- SCÉNARIO
- BLOCKBUSTER
- CONGLOMÉRAT, économie
- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
- OFFRE & DEMANDE
- ADMINISTRATIVE ORGANISATION
- CNC (Centre national de la cinématographie)
- FRANÇAIS CINÉMA
- VIDÉO
- TRAVAIL TEMPORAIRE
- CONSOMMATION CULTURELLE
- DISTRIBUTION, cinéma
- SUPERPRODUCTION, cinéma
- TRAVAIL INTERMITTENT
- POLITIQUE CULTURELLE