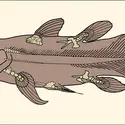COMORES
| Nom officiel | Union des Comores |
| Chef de l'État et du gouvernement | Azali Assoumani - depuis le 3 avril 2019 |
| Capitale | Moroni |
| Langue officielle | Comorien , Français , Arabe |
| Population |
850 387 habitants
(2023) |
| Superficie |
1 861 km²
|
Article modifié le
Histoire
Les Comoriens : Africains et Orientaux
Il est difficile de dater avec précision l'arrivée des premiers habitants, mais il est vraisemblable que le peuplement d'origine africaine précéda la venue des Arabo-Shirazi et des Malgaches. Il semble probable que la vague de population africaine originaire de la côte orientale d'Afrique a atteint les Comores à l'âge du fer, entre le ve et le xe siècle. Malheureusement, on ne sait que peu de chose sur cette période. Ont-ils été les premiers ? Ont-ils été précédés par des Protomalgaches en route vers Madagascar ? ou par ces navigateurs commerçants d'origine indéterminée désignés ultérieurement comme Antalotes ? Toujours est-il que la chronique de Saïd Bakari qui relate l'origine des sultanats de Grande Comore suggère que les premiers arrivants venaient d'Afrique. La chronique de Kilwa, quant à elle, fait remonter la venue des premiers Arabo-Shirazi au xie siècle à Anjouan (Kilwa fut érigé en sultanat par un prince persan originaire de Shiraz, en 975). Les courants marins et les régimes des moussons rendent également plausibles des passages, à une époque reculée, de gens venant d'Asie du Sud-Est. Certains éléments très anciens de la civilisation comorienne proviennent probablement, directement ou non, de cette région (pirogue à balancier, bétel, cocotier et peut-être riz). De toute façon, ce n'est sans doute qu'à partir du xvie siècle que l'arrivée aux Comores d'une nouvelle vague d'Arabo-Shirazi (venant soit directement de « Shiraz », terme désignant, en fait, le golfe Arabo-Persique, soit de la côte est du continent appelée Zanj ou Mrima) transforma en profondeur la société existante, les nouveaux venus dominant les chefs traditionnels et/ou s'alliant à eux par des mariages. C'est de cette époque que datent des sources écrites, manuscrits en arabe, en swahili ou en comorien en graphie arabe, qui permettent de reconstituer des généalogies. On dispose parallèlement de récits de navigateurs européens : les Portugais s'installèrent même en Grande Comore de 1500 à 1505, déclenchant un mouvement de fuite des Grands-Comoriens vers les autres îles, et notamment à Mchambara (qui deviendra M'zamboro) au nord-ouest de Mayotte. L'archipel est désormais organisé en sultanats et la société divisée en classes plus ou moins rigides (wakabaila : les « nobles » ; une classe d'hommes libres : agriculteurs, bouviers, pêcheurs ; les esclaves). L'islamisation s'impose de façon plus générale : construction de la première mosquée en pierre de Mayotte, à Chingoni en 1566, et de celle d'Anjouan, à Sima, à peu près à la même époque. C'est au xvie siècle également qu'une troupe de Malgaches Sakalava s'établit dans le sud de Mayotte. Dès cette période coexistent dans l'île un peuplement arabo-shirazi au nord et un peuplement sakalava au sud, le tout sur fond d'origine africaine.
Aux xvie et xviie siècles, des navigateurs européens, en route vers les Indes, font escale aux Comores. À partir du milieu du xviiie siècle, les quatre îles sont victimes de razzias organisées par des pirates malgaches. Ces incursions affaiblissent les îles et poussent les sultans à rechercher la protection des grandes puissances. En 1841, Mayotte est aux mains d'un sultan né à Madagascar, Andrian Souli, qui, sentant le contrôle de l'île lui échapper, préféra la vendre au commandant Passot de la marine française contre une rente viagère de 1 000 piastres. Louis-Philippe entérina cette acquisition en 1843. L'installation de la France à Mayotte fut suivie de cinquante ans de rivalités franco-britanniques dans l'océan Indien, particulièrement dans les autres îles qui, de ce fait, demeurèrent formellement indépendantes. Mais le rôle prédominant joué par quelques aventuriers poussa les autorités françaises à intervenir bien avant l'annexion. En 1865, la reine de Mohéli concède à Lambert l'exploitation de toutes les terres de son choix. En Grande Comore, le sultan Saïd Ali procède de même avec Léon Humblot qui finira par l'évincer et deviendra le véritable maître de l'île jusqu'à sa mort en 1904. La monopolisation des meilleures terres, l'imposition du travail forcé déclenchent des insurrections (1856, Mayotte ; 1889, Anjouan ; 1896 et 1902, Mohéli ; 1890, Grande Comore) qui entraînent des interventions de la marine et l'installation de l'administration françaises. En 1890, un accord intervient entre la France et la Grande-Bretagne, laissant les mains libres aux Anglais à Zanzibar et aux Français aux Comores et à Madagascar. Le rattachement juridique des trois autres îles à Mayotte s'effectua en 1904 ; il fut suivi, le 9 avril 1908, d'un second décret rattachant Mayotte et ses dépendances à Madagascar. La loi d'annexion du 25 juillet 1912 ne fit que confirmer ces décrets.
Il n'y a pas un type physique comorien mais tout un spectre de métissages allant du plus clair, à dominante arabe, au plus foncé, à dominante africaine. Ce cocktail génétique – sur un fond africain des apports arabes, indonésiens-malgaches et même indiens et européens – n'empêche pas qu'une unité culturelle profonde rattache l'archipel à l'aire de culture swahili, laquelle s'étend le long de la côte de la Somalie au Mozambique en incluant les îles (Pate, Lamu, Pemba, Zanzibar, Mafia et Comores). Il ne s'agit pas de nier les particularismes de chaque île, ni les variantes régionales à l'intérieur d'une même île, mais de dégager les éléments communs à l'ensemble comorien. Une langue, le comorien, divisée en deux groupes dialectaux : d'une part, anjouanais-mahorais ; d'autre part, grand-comorien-mohélien. L'intercompréhension entre locuteurs des quatre parlers est possible même si elle demande un effort ; par contre, il n'y a pas intercompréhension avec le swahili standard, fondé sur le parler urbain de Zanzibar, qui ne servait que de langue diplomatique et commerciale dans les rapports de l'archipel avec le reste de la région.
Le ciment véritable de toute cette culture est l' islam (sunnite, rite shaféite). Sa pratique rigoureuse influence la vie de chaque individu par le respect des cinq obligations de l'islam, mais n'en laisse pas moins subsister un complexe de coutumes d'origine africaine préislamique, très proches de celles des peuples du continent : dévolution matrilinéaire des droits fonciers et responsabilité de l'oncle maternel sur les enfants de sa sœur, par exemple, ou encore rôle des devins-thaumaturges, les walimu (de l'arabe 'ulama, « savants »), identique à celui des « féticheurs » traditionnels. Le « grand mariage », source de dépenses ostentatoires aux conséquences économiques néfastes, est également un exemple d'institution africaine islamisée, dont le rituel (danses, notamment) n'a rien de coranique ou d'arabe.
C'est précisément ce mélange fonctionnel de traits culturels africains et orientaux qui caractérise la culture swahili dans son ensemble. En témoigne la facilité avec laquelle les Comoriens expatriés s'insèrent dans la vie sociale des autres îles et établissements côtiers. Certains lignages nobles sont ainsi représentés jusqu'aux confins somalo-kenyans, leurs membres occupant des fonctions administratives et religieuses importantes, à Lamu et Zanzibar entre autres. Parallèlement, une émigration populaire nombreuse a fourni des ouvriers et des petits cadres de Madagascar à la péninsule arabique et même au-delà.
Les Indiens, minorité musulmane shi‘ite, de rite ismaélien, pratiquent une endogamie presque totale et conservent en famille l'usage de la langue du Gudjarat (province d'origine de la plupart d'entre eux). Ils sont essentiellement commerçants et entretiennent des liens familiaux et économiques dans toute la région. Les chrétiens, en très petit nombre, sont les descendants de créoles des Mascareignes ou des métis français.
La période coloniale
À partir de 1912, l'archipel cesse d'intéresser les autorités françaises, et les conséquences de cette politique de l'oubli – retards accumulés dans tous les domaines – restent sensibles aujourd'hui. La « mise en valeur » des Comores est laissée aux sociétés coloniales (Bambao à Anjouan, avec sa filiale en Grande Comore, la S.A.G.C., etc.). Elles possèdent les trois quarts des terres cultivables et se spécialisent successivement dans la production de la canne à sucre, de la citronnelle, de la vanille, du sisal, puis la prééminence est donnée aux plantes à parfum et au coprah dans les années 1960 et au girofle à partir de 1970. Tout cela se fait au détriment de la culture des denrées de consommation locale.
À partir de 1946, les Comores sont détachées de Madagascar et représentées directement au Parlement français. Le Conseil général devient en 1952 l'Assemblée territoriale avec pouvoir délibératif sur les questions non politiques. La loi-cadre Defferre de 1956 institue un collège électoral unique (Français et musulmans) qui élit une assemblée territoriale siégeant à Moroni, tandis que le Conseil de gouvernement (élu par l'Assemblée) se réunit à Dzaoudzi (Mayotte). Un régime d'autonomie interne, mis en place en 1961 et élargi en 1968, doit préparer une transition harmonieuse vers l'indépendance. Mais la vie politique comorienne – dominée jusqu'en 1970 par Saïd Mohamed Cheikh, fondateur du « parti vert » – reste très conservatrice et ménage à la fois les hiérarchies féodales et les intérêts coloniaux.
L'indépendance
L'exécutif français s'était engagé à ce que l'indépendance intervienne « dans le respect de l'unité de l'archipel » et tous les discours comoriens soulignaient qu'elle devait se produire « dans l'amitié et la coopération avec la France ». Le résultat global du référendum du 22 décembre 1974 donne 95 % de oui à l'indépendance, les non ne l'emportant – par 60 % des suffrages – que dans la seule île de Mayotte. Le Parlement français refuse d'entériner ce résultat et, par la loi du 3 juillet 1975, soumet la reconnaissance de l'indépendance à l'adoption préalable d'une Constitution île par île. Craignant d'être débordé par l'opinion comorienne, le président du gouvernement, Ahmed Abdallah, proclame unilatéralement, le 6 juillet, l'indépendance des Comores, dont il devient le premier chef d'État. Ce faisant, il apporte une victoire inespérée au Mouvement mahorais qui proclame sa volonté de rester dans le cadre de la légalité française.
Le 3 août 1975, un coup d'État porte au pouvoir le prince Jaffar, l'organisateur réel, Ali Soilih, restant au second plan. Le 21 septembre, les mapindruzi (« révolutionnaires »), encadrés par six mercenaires dont Bob Denard, prennent le contrôle d'Anjouan, capturant Ahmed Abdallah qui sera autorisé, quelques mois plus tard, à quitter les Comores.
En octobre 1975, l'O.N.U. reconnaît l'État comorien dans ses limites coloniales, ce qui provoque l'échec des négociations menées à Paris en vue de conclure un accord transitoire permettant la réintégration à terme de Mayotte. Le 21 novembre, Ali Soilih organise, sur Mayotte, une « marche rose » pacifique, qui échoue, mais amène la France à retirer d'un coup et sans préavis tous les fonctionnaires et agents, laissant tous les services sans techniciens et les lycées sans enseignants.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marie-Françoise ROMBI : chargée de recherche au C.N.R.S., sous-directeur du Laboratoire de langues et civilisations à tradition orales, U.P.R. 3121 du C.N.R.S.
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
COMORES, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
ABDALLAH ABDERAMANE AHMED (1919-1989)
- Écrit par Marie-Françoise ROMBI
- 977 mots
Premier chef d'État des Comores, Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 sur la côte est de l'île d'Anjouan, dans l'aristocratie de Domoni, selon sa biographie officielle. Mais divers portraits du chef du Parti vert (de la couleur des bulletins de vote) le décrivent plutôt comme un paysan madré...
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
La colonisation de Madagascar et des Comores entre dans le processus global d'« internationalisation » de la partie occidentale de l'océan Indien. Des groupes d'agriculteurs bantu se répandent de la zone des Grands Lacs vers la côte et développent à terme les cités-États swahili... -
CŒLACANTHES
- Écrit par Daniel ROBINEAU
- 2 671 mots
- 3 médias
Tousles spécimens capturés aux Comores l'ont été par les pêcheurs locaux, qui utilisent des pirogues à balanciers et de longues lignes de coton tressé de 2 à 3 millimètres de diamètre, noircies et tannées à l'aide d'extraits végétaux. La ligne est lestée par une pierre, sommairement fixée par une boucle.... -
DENARD BOB (1929-2007)
- Écrit par Olivier HUBAC
- 926 mots
Robert Denard, dit colonel Bob Denard ou encore Saïd Mustapha Mahdjoub, fut, avec le Belge Jean Schramme, l'un des « affreux » les plus connus de l'histoire de l'Afrique postcoloniale. Tour à tour militaire, mercenaire et entrepreneur, Bob Denard fait figure de légende auprès du grand public comme des...
- Afficher les 7 références
Voir aussi