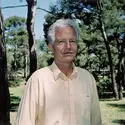CONCEPT DE SANTÉ
Article modifié le
Théories de la santé : entre fonctionnement physiologique et bien-être
Trois grandes familles conceptuelles peuvent être distinguées, qui ont chacune l’ambition de proposer un sens général de l’idée de santé.
L’équilibre ou l’homéostasie
La notion d’équilibre est très présente dans l’histoire de la médecine, dès les écoles hippocratiques et galéniques de la médecine occidentale. Un individu sain est un individu pour lequel les différentes propriétés primaires du corps – qui deviendront les humeurs (sang, phlegme, bile jaune, bile noire) – sont en équilibre les unes par rapport aux autres. L’idée d’équilibre est importante dans d’autres traditions de médecine non occidentales comme dans la tradition ayurvédique, en Inde. On la retrouve au sein de la médecine occidentale plus récemment avec la notion d’homéostasie de Walter Cannon (1946) qui décrit la manière dont les diverses fonctions physiologiques du corps se contrôlent les unes les autres et interagissent dans des boucles de rétroaction pour prévenir des déséquilibres à l’origine des troubles. Toutefois, cette notion, comme l’a montré le philosophe Christopher Boorse en 1977, est confrontée à trop de limites pour constituer un concept général de santé : de nombreux phénomènes biologiques généralement considérés comme sains et fonctionnels reposent sur des bouleversements de l’équilibre plutôt que son maintien, ainsi la croissance, la locomotion, la perception, la reproduction.
Fonction naturelle et théorie biostatistique de la santé
Dans le cadre des débats suscités par la définition très large de l’OMS, Boorse propose donc, dans son article de 1977, de revenir à une définition négative et restreinte de la santé, reposant sur l’opposition normal/pathologique jugée fondatrice de la médecine occidentale moderne. Il existe pour lui au moins un concept théorique de santé qui est objectif, empirique et indépendant des valeurs, d’autres concepts pratiques et normatifs pouvant se greffer sur ce dernier. L’intention est d’extraire la définition implicite de la médecine occidentale à partir de ses définitions et classifications des maladies. Cette définition repose, selon Boorse, sur trois concepts non normatifs : la fonction biologique, la subnormalité statistique et la classe de référence. La fonction est elle-même définie comme une contribution causale à un but dans un système donné, ici l’organisme biologique envisagé comme une hiérarchie de moyens et de fins et dont les buts sont la survie et la reproduction. La classe de référence est une classe naturelle d’organismes avec un design fonctionnel uniforme, c’est-à-dire un groupe d’individus d’âge et de sexe identiques au sein d’une espèce. Elle est déterminée de manière empirique. La santé théorique est alors le fonctionnement normal d’un organisme, c’est-à-dire un organisme dont les parties ou processus contribuent à sa survie et sa reproduction d’une façon qui est typique d’une classe de référence. Par exemple, un cœur fonctionne normalement s’il réalise toutes les contributions statistiquement typiques à la survie et à la reproduction qu’un cœur assure dans une classe de référence.
L’intérêt de ce concept théorique est de distinguer le jugement physiopathologique du jugement évaluatif ou prescriptif. Si la santé est souvent valorisée, cette valorisation ne constitue pas un critère essentiel du concept théorique – ainsi, l’infertilité pathologique peut être valorisée par certains individus. Il est par suite justifié de distinguer le jugement théorique sur ce qui relève de la pathologie du jugement subjectif du patient, mais aussi du jugement clinique, diagnostique (évaluatif) ou thérapeutique (prescriptif) du médecin pour un patient singulier, ces derniers jugements étant liés à d’autres concepts pratiques de la maladie. Il existe des pathologies asymptomatiques et d’autres sans traitement médical.
Cette définition théorique a été abondamment critiquée. D’abord, elle est jugée trop dépendante de la définition médicale de la maladie pour bien rendre compte du concept de santé. Ensuite, elle ne parvient pas à être non normative car, selon certaines critiques, au moins un des trois concepts princeps échouerait à l’être. Surtout, si elle l’était, elle n’aurait pas vraiment d’intérêt et d’utilité car la normativité, en un sens prescriptif d’orientation de l’action, est bien ce qui donne sa pertinence pratique au concept de santé.
Bien-être et capacité : théories positives et holistiques
D’autres théories partent quant à elles du principe que la santé est un concept intrinsèquement normatif. Sans cette normativité, il ne serait pas possible d’expliquer pourquoi nous lui accordons globalement autant d’importance et de valeur. Ces théories se distinguent entre elles en donnant plus ou moins d’importance aux concepts de bien-être ou de capacité (ability), à la place de celui de fonction biologique, jugé trop restrictif.
La définition de l’OMS identifie la santé au bien-être et l’élargit à des dimensions mentale et sociale. La santé y est envisagée comme un état qui permet avant tout à l’individu humain d’assumer ses fonctions relationnelles, sociales et familiales et son rôle professionnel. Une difficulté majeure de cette définition déjà évoquée est qu’elle ne fait pas assez la distinction entre le concept de santé et celui de bonheur. Suivant cette définition, en effet, avoir gagné au loto pourrait être interprété comme constitutif de la santé d’un individu. Une autre difficulté est que le critère de bien-être n’est sans doute pas toujours le plus pertinent, en particulier dans le cas des maladies asymptomatiques.
L’avantage d’une théorie qui envisage la santé comme une condition de l’action, ou capacité, est de moins dépendre de sa dimension subjective ou expérientielle et de permettre une distinction entre santé et bonheur. Pour les auteurs et autrices qui défendent cette approche, une personne saine est une personne qui a la capacité de réaliser ce qu’elle a besoin de réaliser dans sa vie ordinaire. La santé ne dépend pas ici de l’état naturel d’un individu mais de la réalisation de ses buts, projets et aspirations dans le cadre de circonstances ordinaires. Le concept de capacité est relié à celui d’expérience subjective de bien-être, mais il est plus fondamental que ce dernier. Les différentes théories varient en fonction de leur manière de caractériser l’ensemble des actions qu’une personne doit être « capable » de réaliser pour être en bonne santé. Pour Talcott Parsons (1975) ou Caroline Whitbeck (1981), cet ensemble d’actions est déterminé par la volonté ou le désir des individus ; pour Robert Fulford (1989), il est constitué par le champ des « activités ordinaires » : se déplacer, se remémorer des choses, etc. Lennart Nordenfelt, dans sa théorie holistique de la santé (1987), s’intéresse quant à lui aux buts vitaux, eux-mêmes conçus comme les conditions nécessaires à la réalisation d’un bonheur minimal et durable de la personne.
Ces théories de la santé envisagent celle-ci comme un concept d’un ordre différent de celui de la pathologie, compatible avec elle jusqu’à un certain point. Comme le souligne Nordenfelt, la santé peut être compromise par d’autres facteurs que les pathologies, les blessures ou les infirmités, comme dans le cas de la grossesse ou du deuil. Par suite, dans une telle conception, les experts médicaux sont loin d’être les seuls ni même les plus pertinents pour évaluer et intervenir. Cela n’empêche pas qu’il y ait une relation étroite entre les concepts de santé et de maladie, et entre santé et médecine : c’est le souci pour la santé qui est à l’origine de l’intérêt pour la recherche des moyens de prévenir et traiter les maladies en médecine et en santé publique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Élodie GIROUX : professeure des Universités en philosophie des sciences et de la médecine, université Lyon-III-Jean-Moulin
Classification
Médias
Autres références
-
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ
- Écrit par Marilou BRUCHON-SCHWEITZER
- 3 944 mots
- 1 média
La psychologie de la santé est une discipline récente en pleine expansion. Centrée tout d’abord sur les facteurs psychosociaux affectant le développement des maladies, elle s’est ensuite intéressée à ceux menant à des issues de santé positives (qualité de vie, bien-être, santé physique, santé mentale),...
-
SANTÉ PUBLIQUE
- Écrit par Patrice BOURDELAIS
- 5 549 mots
- 5 médias
Dès que l’historien dispose de sources suffisamment précises, il perçoit que toutes les civilisations ont tenté de protéger la vie humaine, à partir de visions différentes – historiquement situées – de la vie, des corps et des éléments qui conditionnent la santé individuelle et collective du groupe....
-
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
- Écrit par Patrice PINELL
- 3 436 mots
L’importance culturelle, sociale, économique et politique prise dans tous les pays développés par les questions de prévention et de préservation de la santé, de traitement et de prise en charge des maladies chroniques et dégénératives, ainsi que par le fonctionnement, l’efficacité, le coût et la gestion...
-
ACNÉ
- Écrit par Corinne TUTIN
- 3 313 mots
- 4 médias
Liée à une inflammation du follicule pileux (précisément, pilo-sébacé), l’acné est une maladie dermatologique très fréquente, qui touche environ 6 millions de personnes en France. Débutant le plus souvent à la puberté, elle n’a en général aucune gravité, mais peut, lorsqu’elle est étendue ou durable,...
-
ASTHME ET IMMUNITÉ INNÉE
- Écrit par Gabriel GACHELIN
- 2 490 mots
- 1 média
...» Dès que les premiers résultats des études sur les amish ont filtré en 2013, Hubert Reeves s’en est emparé pour défendre la biodiversité au nom de la santé. Ces réactions n’étaient encore guère fondées. Au mieux, il pouvait s’agir d’un savoir opératoire ; au pire, constituer une réaction hostile aux... -
BIG DATA
- Écrit par François PÊCHEUX
- 6 148 mots
- 3 médias
En ce qu’il permet de croiser un nombre très important de dossiers médicaux, le big data trouve en la santé de l’homme une application de choix. Avec ses outils statistiques puissants, il aide à identifier très vite et de manière très fiable les origines des maladies chez les patients (étiologie),... -
BIOTECHNOLOGIES
- Écrit par Pierre TAMBOURIN
- 5 368 mots
- 4 médias
Les biotechnologies rouges concernent les domaines de lasanté, du médicament, du diagnostic, de l'ingénierie tissulaire ainsi que le développement de procédés génétiques ou moléculaires ayant une finalité thérapeutique. C'est dans cette catégorie que les efforts les plus importants ont été entrepris.... - Afficher les 32 références
Voir aussi