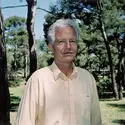CONCEPT DE SANTÉ
Article modifié le
La santé a-t-elle des limites ?
L’absence de définition consensuelle de la santé peut entraîner ce qui est dénoncé comme des risques de surmédicalisation et de « santéisme » (healthism), eux-mêmes liés à la question des limites de l’extension de l’usage de ce terme.
Risques de surmédicalisation et de santéisme
La définition de la santé de l’OMS comme état complet de bien-être physique, mental et social est presque sans limites. Les définitions de la santé à partir de la capacité permettent de restreindre cette définition en précisant le type de bien-être en jeu dans la santé. Néanmoins, elles restent critiquées pour leur étendue, leur connexion à la notion de bien-être et l’effacement de toute distinction entre un simple état de bonne santé et le fait d’être doté de capacités supérieures comme une très grande intelligence ou une très grande capacité respiratoire. Intégrer des aspects sociaux et psychiques dans la définition de la santé et prendre en compte les circonstances et les facteurs plus distants ou plus structurels comme les « déterminants sociaux de la santé » (l’éducation, le statut socio-économique, les inégalités sociales, etc.) peut favoriser une surmédicalisation de nos vies ordinaires à travers une extension inappropriée du pouvoir médical, comme le soulignait Ivan Illich (1975), et une confusion du social, du pouvoir politique et de la santé. C’est une critique qu’on trouve formulée aussi chez Michel Foucault (1977) à partir de la notion de « biopolitique », qui caractérise cette forme spécifique de pouvoir politique s’exerçant non plus sur un territoire mais sur la vie des individus et d’une population. En raison de cette confusion, un problème qui est en grande partie de nature sociale ou structurelle – comme l’obésité ou le burn out – a tendance à être entièrement délégué au médical, et même à la responsabilité individuelle, permettant ainsi aux responsables politiques de se délester de la prise en charge de questions mettant pourtant en jeu l’industrie alimentaire au sens large ou l’organisation du travail dans une société.
Toutefois, un problème posé par différentes critiques de la surmédicalisation est qu’elles présupposent l’existence d’une définition consensuelle et claire de ce qu’est, d’une part, une pratique ou une réalité médicale et, d’autre part, une médicalisation légitime et appropriée. Or c’est loin d’être le cas et ce que recouvre le « médical » est multiple et hétérogène. Les conseils d’hygiène ou les mesures d’assainissement, et plus généralement toute intervention sur l’environnement en vue d’améliorer la santé d’une population par exemple, relèvent-ils de la médicalisation ? L’enjeu est dès lors de préciser les différentes formes de médicalisation à l’œuvre, de distinguer la médicalisation de la pathologisation et de bien peser les gains et les pertes associés pour les populations concernées : prise en charge et déculpabilisation versus stigmatisation, surveillance et contrôle.
En découplant santé et médecine, les théories de la santé qui reposent sur la notion de capacité échappent en partie aux critiques de la surmédicalisation. Il s’agit, par exemple, d’envisager le stress comme relevant d’un problème de santé, sans pour autant le réduire à une étiologie individuelle et sans le considérer comme devant être nécessairement pris en charge par la médecine. Cependant, la santé conserve dans nos représentations un lien étroit avec la médecine. Surtout, ce découplage entre médecine et santé peut renforcer un autre risque de l’élargissement du concept de santé : le poids que prend la valeur de la santé dans nos sociétés contemporaines, valeur qui tend à l’emporter sur les autres et à devenir aussi une norme et même un impératif moral ou une forme d’idéologie. La notion de « santéisme » introduite par Irving Zola (1977) entend interroger ce poids de la préoccupation de la santé qui passe par la modification des modes de vie personnels (l’alimentation, la sexualité, l’identité, etc.) comme principal objectif de réalisation de soi. La médecine ou la santé publique ne sont plus alors envisagées comme les seules institutions sources de contrôle social : le but du maintien de la santé et de son amélioration, devenu central dans nos sociétés, s’imposerait comme une forme de pratique intériorisée de contrôle des vies humaines individuelles.
Toutefois, ce qui est surtout dénoncé dans le cadre des critiques de la surmédicalisation et du santéisme reste la domination du modèle biomédical d’intervention thérapeutique et de la santé, qui réduit cette dernière au niveau individuel et biologique. Ce modèle contribue à envisager l’individu et son mode de vie comme principaux responsables de sa santé. Prendre en compte les déterminants sociaux permettrait donc paradoxalement, à la fois de contrer ce modèle réductionniste qui néglige les déterminants sociaux et les enjeux de justice sociale en santé, tout en augmentant malgré tout, indirectement, le risque d’étendre encore le champ de pouvoir de la médecine et de la santé publique. Toute la difficulté, ici, sur cette ligne de crête, est d’élaborer un concept de santé qui tienne compte des déterminants sociaux et environnementaux, du contexte de vie des individus et pas seulement de leurs facteurs biologiques internes, sans pour autant étendre la définition de la santé au point de favoriser, d’une part, des confusions entre santé, morale, richesse, bonheur, contexte social et environnemental, etc., et, d’autre part, une suprématie de la valeur santé sur les autres objectifs de la vie humaine.
Une première piste possible, sur cette ligne de crête, consiste, comme l’a proposé Sean Valles (2018), à insister sur l’importance du découplage entre santé et médecine en relativisant le rôle de cette dernière dans l’amélioration de la santé des individus, par l’adoption d’une vision très pluridisciplinaire de la santé publique, tout en conservant le souci de situer et relativiser la santé comme une valeur parmi d’autres. Il s’agira, par exemple, de prendre en compte le fait qu’intervenir sur un déterminant social, comme l’accès à de bonnes conditions de logement, a un impact sur d’autres valeurs et objectifs de la vie humaine. Une deuxième piste, défendue par Stephen John (2009), consiste à souligner la différence entre santé publique – qui prendrait plus particulièrement en charge les déterminants sociaux de la santé – et médecine, et à considérer que le concept central de la santé publique devrait être la sécurité (safety) des individus et des populations plutôt que leur santé. Les interventions plus structurelles qui concernent la qualité de l’environnement ont alors leur place, et l’on peut considérer qu’elles améliorent dès aujourd’hui la sécurité des populations concernées, au même titre que des interventions sur les risques physiologiques individuels (facteurs de risque comme la consommation de tabac ou plus généralement le mode de vie), sans pour autant devoir appréhender les déterminants sociaux et environnementaux comme constitutifs de la santé.
Extensions des usages de la santé : sens littéral, analogique ou métaphorique ?
Le poids de la valeur santé et l’extension de son usage conduisent à interroger le type d’entité auquel ce terme est légitimement appliqué. Aujourd’hui, il est utilisé pour décrire les dimensions biologiques, psychiques et sociales de la vie de l’individu humain, mais aussi à propos de la population humaine, des animaux, des plantes, ou encore de l’environnement, des écosystèmes et de la planète. Cette extension est-elle littérale, analogique ou métaphorique ? Si elle n’est que métaphorique, le concept de santé peut-il avoir les mêmes fonctions et implications prescriptives que dans son usage littéral ? Il importe de distinguer ces diverses extensions d’usage et leurs liens respectifs avec ce que serait, à première vue, l’usage littéral restreint à l’individu humain.
Santé mentale ?
Si l’extension au domaine mental a été dénoncée comme métaphorique et même mythique par Thomas Szasz (1975) dans le cadre de l’antipsychiatrie, l’usage littéral du concept de « santé mentale » est aujourd’hui relativement consensuel. La notion de « santé sociale » semble poser davantage de difficultés et renvoie aux débats précédemment évoqués quant à l’importance d’établir une distinction entre les déterminants sociaux et les constituants ou aspects de la santé. Le bon niveau de vie d’un individu contribue, certes, à sa santé, mais il paraît difficile de considérer qu’il en est, à proprement parler, constitutif. Toutefois, la distinction entre déterminant et constituant de la santé n’est pas si simple à établir et n’empêche pas d’envisager par ailleurs un sens de « santé sociale » qui réfère à la capacité relationnelle d’un individu et à l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles liées à l’existence d’un réseau durable de relations. C’est notamment le sens attribué à la notion de « capital social » en épidémiologie sociale.
Santé publique ?
De son côté, la santé publique a prioritairement pour objet la santé de la population. Or, ce qu’on entend par « santé de la population » est loin, là encore, d’être clair et consensuel. Est-elle réductible à la somme des santés de ses membres, ou constitue-t-elle l’état de santé d’un collectif d’individus irréductible à une simple sommation ? Les politiques de santé publique seront différentes selon l’acception retenue. Dans la pratique, c’est la conception agrégative qui l’emporte le plus souvent. Or un certain nombre de caractéristiques populationnelles, comme l’immunité de groupe ou la densité de la population – sans équivalents mesurables au niveau individuel –, ainsi que des causes structurelles ou macrosociales – qui ne sont visibles qu’au niveau populationnel –, donnent des informations déterminantes pour décrire l’état de santé d’une population. C’est l’exposition d’un individu à l’infection et sa susceptibilité qui permettent d’expliquer pourquoi il a contracté la Covid-19 alors qu’un autre s’en est trouvé préservé. Mais, pour expliquer ou prédire une épidémie, la somme des expositions individuelles à l’infection ne suffira pas : outre la virulence et la contagiosité du virus, il importe de comprendre d’autres paramètres qui influencent la dynamique d’une épidémie comme la densité de la population, la proportion d’individus ayant une profession surexposée, les normes culturelles de distanciation sociale, etc. Ainsi, l’existence de caractéristiques populationnelles sans équivalents individuels semble en faveur de la définition holiste selon laquelle la santé de la population est celle d’un collectif d’individus, irréductible à la seule sommation des santés individuelles. Il apparaît par ailleurs qu’au niveau de la population comme l’ont bien montré Kathrine Keyes et Sandro Galea (2016) une acception continuiste et comparative ou relative de la santé soit la plus appropriée. Mais une question se pose : de quelle nature est donc cette entité « population » à laquelle la caractéristique de santé est alors attribuée ?
Une difficulté réside dans le fait que la plupart de nos mesures opérationnelles de la santé de la population reposent sur une définition réductionniste, puisqu’il s’agit principalement de mesures individuelles agrégées comme les taux de mortalité ou de morbidité. Néanmoins, il semble pertinent pour les interventions de santé publique de faire place à une notion de la santé qui serait propre au niveau populationnel, distincte de celle de l’individu – même s’il existe une forte interdépendance entre ces deux niveaux –, et surtout de les penser ensemble et en complémentarité. En effet, comme l’a bien montré l’épidémiologiste Geoffrey Rose (1992), stratégie populationnelle et stratégie individuelle d’intervention sont bien distinctes et complémentaires. La stratégie individuelle cible par exemple les individus à haut risque de maladies cardio-vasculaires, identifiés à partir de leurs facteurs de risque, et consistera à traiter uniquement ces derniers par des antihypertenseurs et des antihypercholestérolémiants. Une stratégie populationnelle a quant à elle pour objectif de déplacer l’ensemble de la courbe populationnelle de distribution de la pression artérielle en agissant plutôt sur des causes fondamentales et structurelles – l’usage du sel dans les plats transformés par l’industrie alimentaire, par exemple. La question de savoir si le concept de santé au niveau de la population est différent de celui qui vaut pour l’individu ou si l’on peut dégager des caractéristiques communes reste toutefois à explorer.
Santé animale et végétale ?
Parler en un sens littéral de santé pour les animaux, comme le font couramment les vétérinaires, et pour les plantes, comme dans le monde phytosanitaire, a fait débat entre théories normativiste et naturaliste. Si la santé est définie en termes de fonctionnement biologique, il devient possible d’envisager un sens littéral de santé animale et végétale. En revanche, si l’on adopte un sens positif et holistique de la santé qui repose sur les idées de bien-être et de capacité d’action, cela devient plus difficile, surtout pour les plantes. Nordenfelt (2006) considère que la notion générale de bien-être vaut aussi pour les animaux. La différence avec l’homme concernerait surtout la complexité, la variété et la richesse des buts vitaux. Mais, pour les animaux les moins organisés et les plantes, l’application du concept de santé serait plutôt analogique, et il propose de préciser la nature du bien-être dont il est alors question à partir de la notion d’épanouissement (flourishing).
Santé des écosystèmes et santé de la Terre ?
L’extension d’un sens littéral aux écosystèmes fait débat d’une autre manière. L’un des enjeux est de déterminer les objectifs de la conservation environnementale : s’ils consistent à préserver un état qu’on désignerait alors par « santé écosystémique », le recours au concept de santé serait ici utile du fait de sa dimension prescriptive. La difficulté est alors de parvenir à élaborer un concept de la santé qui échappe aux implications d’une conception organiciste des écosystèmes. Des perspectives semblent s’ouvrir dès que l’on cesse de restreindre l’applicabilité du concept de santé aux entités organiques. Dans une perspective naturaliste, par exemple, la notion de fonctionnement pourrait être utilisée à propos d’un écosystème, mais en la libérant de son lien à l’organicisme, hérité de la physiologie, et en l’envisageant de manière holiste au niveau du tout plutôt que des parties. En physiologie, la fonction est en effet appréhendée dans le contexte d’une interdépendance entre les parties et le tout, l’organisme étant conçu comme une organisation hiérarchisée de fins et de moyens, d’une part, et la fonction d’une partie étant sa contribution ultime à certains buts au sommet de la hiérarchie de manière plus ou moins directe, d’autre part. Or, dans le cas des écosystèmes, il pourrait être plus pertinent d’identifier des normes de fonctionnalité à l’échelle de la totalité plutôt que des parties en reprenant, par exemple, les trois critères de mesure proposés par Robert Costanza (1992) : la résilience (la capacité du système à maintenir sa structure temporelle et spatiale ainsi que ses processus en présence d’un stress) ; son organisation (le nombre et la diversité des interactions entre les composantes) ; enfin, sa vigueur (la mesure de son activité, de son métabolisme, de sa productivité primaire). Pour Costanza, un « écosystème est en bonne santé et exempt de syndrome de détresse s’il est stable et durable, c’est-à-dire s’il est actif et maintient son organisation et son autonomie dans le temps, et s’il résiste au stress ».
Puis, l’usage du terme de santé s’est élargi à l’environnement en général et à la planète dans une visée très intégrative. Ces derniers usages prolongent la notion de « santé de la Terre » développée par Aldo Leopold (1941). Plus généralement, les relations entre santé et environnement sont devenues une préoccupation centrale. Dans un contexte d’évolution rapide des climats, de réduction de la biodiversité et de mondialisation de l’économie, la conscience de la dégradation de l’environnement et, en retour, de celle de l’humanité, s’accroît.
Des concepts intégratifs ont ainsi émergé depuis le début du xxie siècle, comme celui d’« une seule santé » (One Health), la « santé globale », ou encore « planétaire », dont l’ambition holistique affichée est particulièrement forte, mais rend la détermination précise du sens à accorder à la santé dans ces différents usages particulièrement difficile. L’approche « une seule santé » ne repose pas encore sur une définition consensuelle, même si l’idée commune est d’alerter sur l’interdépendance entre les santés humaine, animale et environnementale et l’importance de l’interdisciplinarité. L’enjeu de la possibilité d’élaborer un sens commun à la santé pour l’homme, l’animal et l’environnement semble déterminant pour l’orientation future de cette approche et notamment son caractère plus ou moins anthropocentré. Quant aux approches en faveur d’une « santé planétaire » ou d’une « santé globale », il semble que diverses acceptions s’y trouvent confusément mêlées. Mieux connaître la spécificité de ce que recouvrent les concepts de santé dans chacune de ces approches permettrait d’envisager plus rigoureusement leurs relations.
Pour conclure, toutes ces extensions d’usage mettent en question l’idée selon laquelle le sens littéral devrait se limiter aux organismes humains. Si cet usage a longtemps dominé, d’autres, élargis ou nouveaux, peuvent advenir qui ne sont pas nécessairement que métaphoriques. Il reste cependant à préciser les conditions que doit respecter une entité donnée pour que le concept de santé puisse lui être attribué de façon pertinente. Surtout, si l’usage pour les écosystèmes peut paraître une extension littérale faisant à juste titre l’objet de débat, il semble important de se demander si l’ambition intégrative des approches « une seule santé » ou de « santé planétaire » ne risque pas de faire courir le risque d’un usage général et plastique du concept de santé qui, plutôt que les faciliter, pourrait complexifier le dialogue et la coopération entre les disciplines, les institutions et les acteurs en invisibilisant certaines divergences.
Utilité du concept de santé ?
Le concept de santé se révèle être ainsi irréductiblement descriptif et normatif. Sa normativité (prescriptive et évaluative) ne le rend pas nécessairement inopérant sur un plan scientifique et empirique et contribue au contraire à sa valeur pratique et à sa dimension politique. Mais l’élaboration d’une définition générale consensuelle reste un défi. Il semble toutefois problématique d’adopter une position irréductiblement pluraliste qui revient à abandonner le concept général – jugé trop vague et inutile – pour s’en tenir à des critères précis et techniques (résilience, fonctionnement, équilibre, etc.) dans chaque domaine concerné. Tout comme s’en tenir par principe à un usage littéral restreint aux organismes humains paraît devoir être questionné. L’importance prise, d’une part, par l’extension de l’usage à d’autres entités que les organismes et, d’autre part, par les approches intégratives comme « une seule santé » ou « santé planétaire » atteste de son poids dans l’usage courant, avec la synthèse qu’il permet, et de son rôle à la fois heuristique et politique dans nos sociétés contemporaines. Néanmoins, ces extensions et ces usages intégratifs doivent s’accompagner d’une réflexivité critique et d’une vigilance sur la dimension politique et normative de ce concept. La question reste ouverte de la possibilité d’élaborer un noyau de signification commun qui ne soit pas, d’un côté, trop vague, pour conserver une pertinence théorique et une valeur pratique, mais aussi, d’un autre côté, suffisamment flexible pour servir « d’objet frontière » facilitant la coopération entre les disciplines et favorisant une bonne communication. Que ce noyau générique de signification puisse ou non être élaboré, mettre en relation et analyser les différents usages du concept de santé peut aider à en repenser le sens et renouveler la manière de le définir.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Élodie GIROUX : professeure des Universités en philosophie des sciences et de la médecine, université Lyon-III-Jean-Moulin
Classification
Médias
Autres références
-
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ
- Écrit par Marilou BRUCHON-SCHWEITZER
- 3 944 mots
- 1 média
La psychologie de la santé est une discipline récente en pleine expansion. Centrée tout d’abord sur les facteurs psychosociaux affectant le développement des maladies, elle s’est ensuite intéressée à ceux menant à des issues de santé positives (qualité de vie, bien-être, santé physique, santé mentale),...
-
SANTÉ PUBLIQUE
- Écrit par Patrice BOURDELAIS
- 5 549 mots
- 5 médias
Dès que l’historien dispose de sources suffisamment précises, il perçoit que toutes les civilisations ont tenté de protéger la vie humaine, à partir de visions différentes – historiquement situées – de la vie, des corps et des éléments qui conditionnent la santé individuelle et collective du groupe....
-
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
- Écrit par Patrice PINELL
- 3 436 mots
L’importance culturelle, sociale, économique et politique prise dans tous les pays développés par les questions de prévention et de préservation de la santé, de traitement et de prise en charge des maladies chroniques et dégénératives, ainsi que par le fonctionnement, l’efficacité, le coût et la gestion...
-
ACNÉ
- Écrit par Corinne TUTIN
- 3 313 mots
- 4 médias
Liée à une inflammation du follicule pileux (précisément, pilo-sébacé), l’acné est une maladie dermatologique très fréquente, qui touche environ 6 millions de personnes en France. Débutant le plus souvent à la puberté, elle n’a en général aucune gravité, mais peut, lorsqu’elle est étendue ou durable,...
-
ASTHME ET IMMUNITÉ INNÉE
- Écrit par Gabriel GACHELIN
- 2 490 mots
- 1 média
...» Dès que les premiers résultats des études sur les amish ont filtré en 2013, Hubert Reeves s’en est emparé pour défendre la biodiversité au nom de la santé. Ces réactions n’étaient encore guère fondées. Au mieux, il pouvait s’agir d’un savoir opératoire ; au pire, constituer une réaction hostile aux... -
BIG DATA
- Écrit par François PÊCHEUX
- 6 148 mots
- 3 médias
En ce qu’il permet de croiser un nombre très important de dossiers médicaux, le big data trouve en la santé de l’homme une application de choix. Avec ses outils statistiques puissants, il aide à identifier très vite et de manière très fiable les origines des maladies chez les patients (étiologie),... -
BIOTECHNOLOGIES
- Écrit par Pierre TAMBOURIN
- 5 368 mots
- 4 médias
Les biotechnologies rouges concernent les domaines de lasanté, du médicament, du diagnostic, de l'ingénierie tissulaire ainsi que le développement de procédés génétiques ou moléculaires ayant une finalité thérapeutique. C'est dans cette catégorie que les efforts les plus importants ont été entrepris.... - Afficher les 32 références
Voir aussi