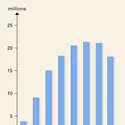CONFLITS SOCIAUX
Article modifié le
Conflit et intégration
Rien n'est plus dangereux que d'opposer, d'une part, une étude du système social, entièrement fondée sur les conditions de l'intégration, et, d'autre part, l'étude des conflits entre unités sociales indépendantes – comme si la paix régnait à l'intérieur des nations et la guerre dans les rapports entre les États.
L. Coser, s'inspirant de G. Simmel (1858-1918), a insisté sur ce thème. Bien que son entreprise soit limitée, L. Coser prend utilement position contre un penchant trop marqué de la sociologie américaine à privilégier les problèmes de l'équilibre et de l'intégration. Il rappelle que non seulement la génération des fondateurs de la sociologie aux États-Unis, mais encore la génération suivante qu'on identifie souvent à l'école de Chicago, formée autour de Park, a porté le plus grand intérêt aux conflits sociaux. Au contraire, après la guerre, après la liquidation de la grande crise et au cours d'une période de rapide développement économique lié à l'absence relative de graves conflits sociaux internes, la sociologie s'est davantage souciée du fonctionnement d'un système défini par un corps de valeurs et de normes centrales que de l'étude des conflits sociaux. On parle alors plus volontiers de déviance, de marginalité, de « dysfonction » ou d'anomie que de conflits. À l'inverse, les sociologues européens, et surtout ceux de régions où la sociologie se développe rapidement, accordent, dans l'étude du développement économique et du changement social, une importance centrale aux conflits en même temps qu'aux rapports de pouvoir et de domination. Mais une telle opposition est chargée d'idéologie et correspond davantage à l'état des sociétés étudiées qu'aux besoins de l'analyse sociologique elle-même.
Il est donc indispensable de dépasser l'opposition trop simple d'une sociologie de l'ordre et d'une sociologie du mouvement, d'une sociologie de l'intégration et d'une sociologie des conflits. On a déjà vu que la théorie des organisations avait fait des progrès décisifs dans cette direction, en critiquant aussi bien la conception wébérienne de la bureaucratie que l'école des relations humaines.
Il n'y a pas d'opposition entre le conflit et l'intégration du système social. Mais leurs liens s'établissent à plusieurs niveaux.
Les modes indirects d'expression des conflits
En premier lieu, l'existence d'un conflit peut renforcer l'intégration sociale. Mais il ne s'agit pas ici d'une liaison véritable entre le conflit et l'intégration, puisque c'est le conflit entre deux unités d'action qui renforce l'intégration de chacune d'entre elles. C'est ainsi que Durkheim a rappelé qu'en période de guerre l'anomie tendait à diminuer. Des valeurs et des normes « sociétales » s'imposent avec plus de force. Même si le thème de l'union sacrée fait bon marché de certains conflits, il n'en demeure pas moins que le système de contrôle social se renforce en temps de guerre et entraîne une intégration sociale plus forte.
Depuis E. Troeltsch (1865-1923) et G. Simmel, on a souvent évoqué le rôle des sectes, unités de taille limitée, très cohésives, imposant à leurs membres un consensus très poussé, et en lutte avec un environnement hostile. Pures et dures, elles sont promptes à éliminer les « déviants » ; le conflit dans lequel elles sont engagées les pousse à renforcer leur unité politique et morale.
Beaucoup plus intéressant est un thème souvent développé par les anthropologues et les psychanalystes. Une société, confrontée à des expressions d'hostilité en son sein, est conduite à inventer des modes indirects d'expression de conflits latents. Elle leur donne une expression qui ne menace pas son unité, et même la renforce. Tel est le sens de la sorcellerie chez les Navahos d'après Clyde Kluckhohm (1905-1960). Il s'agit d'empêcher qu'une hostilité se transforme en conflit ouvert, menaçant l'existence de la société. Au niveau de la personnalité, Freud a attribué un rôle analogue au trait d'esprit, qui permet l'expression d'une hostilité en l'empêchant de devenir une agression directe, entraînant une rupture dangereuse.
Plus généralement, au lieu de considérer qu'il existe des normes sociales dont l'application peut entraîner tensions et conflits, beaucoup de psychologues et de sociologues pensent que les règles ont souvent pour fonction de régler les tensions, non pas en les niant ou en les supprimant, mais en les détournant de leur objet spécifique. Une société qui ne reconnaît pas l'existence de conflits est ainsi amenée à une très faible institutionnalisation, donc à une grande fragilité qui peut masquer pour un temps la brutalité d'un pouvoir central, dont l'action renforce à son tour les tensions et les conflits, ce qui conduit à un cercle vicieux, de l'autoritarisme aboutissant à une gestion totalitaire de la société. Un rôle essentiel des conflits est donc de développer le système institutionnel, et en particulier les institutions judiciaires entendues au sens le plus large.
Conflit et concurrence
En deuxième lieu, le conflit interne à une société peut renforcer celle-ci en faisant apparaître les adversaires comme des concurrents plutôt que comme des étrangers. Telle est l'image qu'on donne souvent des sociétés industrielles et urbaines, à forte mobilité sociale, en les opposant aux sociétés dont l'ordre était plus stable.
Une population paysanne, assurée de rester enfermée pendant plusieurs générations dans sa condition, ou, cas extrême, une caste, n'entre pas aisément en conflit avec d'autres groupes sociaux. Elles sont situées dans un ordre social transmis par une culture. Elles peuvent vivre leur sous-privilège sur le mode du ressentiment ; elles peuvent être dites potentiellement révolutionnaires. Elles sont rarement engagées dans des conflits sociaux. C'est seulement quand l'ordre ancien se désagrège, lorsque les communautés sont ébranlées par les changements économiques et, en particulier, par les migrations professionnelles, que le conflit peut apparaître, car celui-ci suppose une certaine communauté d'objectifs entre les adversaires. Les conflits sont liés à un progrès de la « mobilisation » et de l'intégration sociales. Inversement, l'exemple des travailleurs étrangers temporaires attirés vers les sociétés industrielles les plus développées montre qu'une situation sous-privilégiée, le poids de la ségrégation et de la discrimination ne conduisent nullement à l'éclatement de conflits sociaux, mais plutôt à des conduites de retrait, de rupture ou de marginalité. Aux États-Unis, le conflit ouvert entre les Blancs et les Noirs n'a pas éclaté dans le Sud, mais dans les grandes villes du Nord, et a accompagné un mouvement d'intégration des Noirs à l'économie industrielle et urbaine. L'intégration et le conflit se sont développés parallèlement.
En France, l'exemple le plus clair de ce processus est celui des jeunes agriculteurs. Ce ne sont pas les paysans des régions les plus sous-développées, enfermés dans leur isolement économique et culturel, mais les jeunes qui ont voulu moderniser leur exploitation, entrer dans une économie de marché, investir pour mécaniser, qui ont organisé un syndicalisme nouveau et ont déclenché les conflits sociaux les plus graves.
Le cas de la lutte des classes
Enfin, la formation d'un conflit de pouvoir, de la lutte des classes en particulier, n'est pas davantage une rupture de la société. Une image très répandue représente ces conflits comme une guerre civile. Ce qui est une expression trompeuse. Plus un conflit intersocial est aigu, plus l'opposition des adversaires est marquée ; au contraire, plus la lutte de classes est forte, plus les adversaires se réfèrent explicitement à un modèle intégré de société, parlent au nom de l'intérêt général, et, du même coup, révèlent les forces unificatrices de la société soit pour les renforcer, soit pour les combattre. Pas de mouvement révolutionnaire qui ne parle d'unité nationale, de gouvernement populaire, d'indépendance ou de droits de l'homme. Les conduites de rupture, comme les soulèvements insurrectionnels ou les émeutes, indiquent au contraire que des tensions ou une crise ne peuvent pas encore se transformer en conflit social. Un élément dominé rejette l'ordre qui l'opprime ; il ne lutte pas encore contre un adversaire. La reconnaissance de l'adversaire est inséparable de l'affirmation d'un objectif social général. Viser le pouvoir, ce n'est pas renverser la société, mais renverser l'adversaire au nom des intérêts généraux de la société. Lukacs, reprenant une pensée de Marx, a souligné dans le même esprit qu'une classe montante, en même temps qu'elle combat son adversaire, pense et agit au nom d'une totalité, d'un ordre social et culturel.
On retrouve ici une observation déjà faite : dans les conflits du travail, la rupture est d'autant plus nette, une stratégie de type militaire se forme d'autant plus facilement que le pouvoir est moins mis en cause, que les objectifs sont plus immédiatement et plus étroitement économiques. C'est pourquoi la capacité de négocier et la détermination de rompre, loin d'être opposées, sont complémentaires. Au contraire, un conflit de classes, parce qu'il est plus politique, ne se réduit jamais soit au heurt, soit à la négociation avec l'adversaire. Il en appelle à la construction d'une société nouvelle, et, pour cette raison même, ne se laisse pas enfermer dans un conflit face à face. Celui-ci, malgré ses apparences de brutalité, est nécessairement limité et constitue bien davantage un moyen de modifier un équilibre qu'un instrument de transformation du pouvoir. Ainsi le conflit ne peut-il pas davantage être considéré comme la rupture d'un ordre social que comme l'expression d'une concurrence pour la possession de biens supposés placés dans un vide social, comme l'est un ballon de football placé entre deux équipes sur un terrain neutre.
Ce qu'on nomme l'ordre social ne préexiste pas aux conflits ; il est construit par ces conflits. Il est en équilibre partiel et instable, résultat de pressions et de négociations. Plus les conflits sont forts, plus l'institutionnalisation progresse et plus, en ce sens, l'intégration sociale se renforce. Le conflit est la participation à la recherche d'un mode d'organisation sociale. Plus il est profond, plus il met en cause le pouvoir et plus la participation à l'action historique se renforce. Une société sans conflits ne peut être qu'une société sans historicité, absorbée par ses règles internes de fonctionnement et par l'application de son code culturel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alain TOURAINE : directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (E.H.E.S.S.).
Classification
Médias
Autres références
-
ACTION COLLECTIVE
- Écrit par Éric LETONTURIER
- 1 466 mots
...Les théories du choix rationnel représentent une véritable alternative aux approches psychosociales de l'action collective. Ainsi, dans son travail sur le conflit entre un syndicat ouvrier et la direction d'une entreprise, Anthony Oberschall (Social Conflict and Social Movements, 1973) conçoit l'action... -
AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations)
- Écrit par Claude JULIEN et Marie-France TOINET
- 6 914 mots
- 2 médias
Dans l'histoire sociale du monde occidental, le cas américain a été notoirement brutal. Comme l'écrivent Philip Taft et Philip Ross (in H. D. Graham et T. R. Gurr dir., The History of Violence in America) : « Les États-Unis ont eu l'histoire du travail la plus sanglante et la plus... -
ARGENTINE
- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO
- 38 895 mots
- 19 médias
...est d'assurer la viabilité financière de l'État afin de reconquérir la confiance internationale. Mais elle provoque un immense mécontentement populaire. Les 19 et 20 décembre, en dépit de la proclamation de l'état d'urgence, des millions de manifestants défilent dans d'interminables ... -
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS
- 27 359 mots
- 29 médias
Le maintien du rationnement jusqu'en 1948, la frilosité du gouvernement en matière de hausse des salaires,la lutte engagée par les syndicats pour la semaine de quarante heures (acquise en 1947) et l'amélioration des conditions de travail (notamment dans les mines) sont autant de sujets qui, comme... - Afficher les 54 références
Voir aussi
- EMPLOYÉS, sociologie
- CAPITAL ACCUMULATION DU
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- GROUPE PRIMAIRE
- CONTRADICTION
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- RELATIONS HUMAINES
- MILLER NEAL (1909-2002)
- OUVRIÈRE CLASSE
- SCIENCES SOCIALES
- CONDUITE, psychologie
- DIRIGEANTES CLASSES
- ÉCONOMISME
- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX
- LUTTE DE CLASSES
- HISTOIRE SOCIALE
- RELATIONS DE TRAVAIL
- CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE