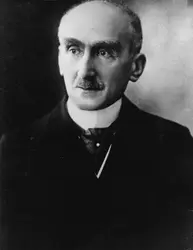CONSCIENCE
Article modifié le
Les structures de l'être conscient
Un être en devenir
Il s'agit de décrire l'articulation des phénomènes qui engendrent l'ordre selon lequel se déroulent la pensée et l'action dont le sujet dispose. Car les perceptions du sujet, ses souvenirs, ses idées, son langage, ses prévisions et ses fins deviennent des réalités dont il est conscient, à la seule condition que tous ils se conforment à sa propre loi. Et ainsi, d'emblée, les phénomènes qui se succèdent ou s'impliquent dans la conscience ne sauraient être seulement envisagés comme le fameux stream of consciousness de W. James, mais plus exactement comme une organisation structurale, comme un ordre auquel le sujet se soumet pour progresser dans son autonomie. C'est dire que la description de ces structures ne peut se faire comme s'il était question de partes extra partes ou de figures de l'espace géométrique, ou encore d'une mosaïque fonctionnelle. Il s'agit plutôt de saisir le mouvement même de l'organisation de l'être conscient, pour autant que cette organisation constitue une architectonie de niveaux, de formes et de perspectives qui permettent au sujet d'avoir conscience de l'expérience actuellement vécue, c'est-à-dire d'en contrôler les catégories de réalité dans le champ de son actualité – et, au travers des champs successifs de son expérience, d'être conscient de son identité et de sa constance, c'est-à-dire d'être quelqu'un. Cette double structure synchronique (le champ de la conscience) et diachronique (le moi ou la personnalité) constituent les deux coordonnées temporelles en fonction desquelles se développe, se construit et s'affirme l'être conscient. À chacune de ces deux dimensions complémentaires de la « conscience » correspondent une organisation structurale et une dialectique propres, toutes les deux ayant en commun d'assumer ce que les béhavioristes appellent l'intégration du comportement ou ce qui, plus exactement, représente pour le sujet la subordination de ces moyens, que sont les forces de la vie, à ses fins, que sont les formes idéales de son existence.
Dans le style même des fameuses Ideen de Husserl, l'être conscient, en tant que disposant de ce qu'il vit en conformité avec ce qu'il a à être, est essentiellement un être logique et éthique, un « être de raison » qui conjugue son sentir, son désir, son savoir aux divers temps de ses possibilités. Telle est la structure générale de l'être conscient, à la fois temporelle, historique, logique et axiologique. Mais il convient de prendre bien garde qu'il ne s'agit de rien moins que d'une abstraction. Il s'agit même du contraire d'une abstraction, dans la mesure même où la description de ces structures, « réduites » par leur fonction à leur essence, saisit ce qu'il y a de plus absolument concret dans ces formes, physionomies et configurations que les mouvements intentionnels du sujet contractent, impliquent ou, au contraire, explicitent et développent, selon que diminue ou augmente le pouvoir de différenciation qui indexe les degrés de lucidité de la conscience, savoir : les transitions qui vont de la fermeture de la conscience endormie à l'ouverture de la conscience éveillée, ces mille manières pour le sujet d'être à son monde, de se le faire apparaître et dont avec Heidegger ou Sartre on peut suivre l'infinité des excursions. Il est impossible de donner une connaissance encyclopédique de la conscience sans tourner délibérément le dos aux « données » (fussent-elles réputées immédiates), aux « états » ou « contenus » de la conscience, et sans choisir délibérément d'en exposer au contraire les perspectives proprement formelles et essentiellement temporelles, celles d'une multiplicité infinie de ses plans et de ses formes. Comme l'être conscient est fondamentalement voué à la constitution de l'ordre dans lequel s'inscrivent les relations du moi à son monde, c'est à cet ordre fondamental que nous renvoie, comme pour nous en faciliter la description, la double structure synchronique et diachronique de l'être conscient.
Le champ de la conscience
Être conscient, dans le sens le plus généralement et aisément admis, c'est avoir conscience d'une expérience actuellement vécue. Cet aspect de la conscience est certainement le moins contesté pour être le plus évident. Il est accepté, par exemple, aussi bien par un philosophe comme K. Jaspers, qui écrit : « La conscience est la totalité du moment [...] la totalité de la vie psychique actuelle » (« Das Bewusstsein ist das augenblickliche Ganze [...] das Ganze des momentanen Seelenlebens ») que par un neurophysiologiste comme A. Fessard (la conscience c'est l'intégration de l'expérience en tant qu'elle peut être à la fois une et multiple à chacun de ses instants). La constitution de la conscience en champ d'actualité étant la moins récusable, c'est bien à l'expérience vécue que l'on pense généralement lorsqu'on entend saisir l'essentiel de l'activité de conscience. C'est qu'en réalité la constitution en champ correspond à une des deux grandes fonctions temporelles de l'être conscient. Le sujet conscient de quelque chose remplit de cette chose (idées, représentations, sentiments, souvenirs, images, perceptions, etc.) le moment actuel de son temps. Et cette formule implique précisément que dans cet espace de temps qui est, comme le dit R. Ruyer, essentiellement axiologique (car il appartient à l'intentionnalité du sujet d'en régler les limites par le sens), ce champ de la conscience est donc rempli à chaque moment du temps de l'expérience actuellement vécue. Et ce qui y est vécu (sous toutes les formes et catégories possibles de contenus de Bewusstheiten) ne l'est qu'à sa place (en conformité avec la fonction thétique de la conscience), c'est-à-dire dans la catégorie de réel qui lui est ainsi assignée. De telle sorte que le champ de la conscience a une constitution matricielle (Ur-form) ou originelle, qui se développe chez le nouveau-né et s'organise dès le réveil. À cette « conscience constituée », à cette « infrastructure » qui est comme l'invariant formel, le socle de la relation du moi à son monde, correspond une triple stratification fonctionnelle : la possibilité de s'ouvrir au monde et de s'y orienter ; la capacité de distribuer l'espace vécu selon ce qui appartient au sujet ou au monde des objets ; et enfin la faculté d'arrêter – pour le remplir – le temps dans cet « espace de temps » que constitue le présent entre la rétropulsion vers le passé et la propulsion vers l'avenir. Ce n'est que lorsque cette infrastructure du champ est constituée que le sujet peut décrire les figures de ses performances réflexives et opérationnelles, ces exercices de style et de pensée, qui sont comme les mouvements facultatifs du sujet à l'extrême pointe de sa virtuosité. Ces quelques mots peuvent permettre de comprendre la complexité et les difficultés infinies des descriptions du champ de la conscience. Disons simplement ici qu'elles ne sont possibles qu'à la condition de les réduire précisément à l'essentiel que nous venons d'esquisser ici.
Le moi et son envers : l'autre
L'être conscient acquiert cependant une autre dimension (la conscience de soi) en se constituant selon une figuration systématique et transactuelle de lui-même. Et c'est bien au moi, en effet, que tout le monde pense, y compris Freud et l'école psychanalytique, quand il est question de cet être conscient et organisé qu'est l'homme. Être quelqu'un, c'est en effet s'identifier soi-même à cette personne que l'on veut et doit être, selon l'idéal de soi que chacun emprunte au milieu de sa culture et, bien sûr, comme l'école psychanalytique l'a particulièrement mis en évidence, à la situation triangulaire qui le lie à ses géniteurs. Autant dire que cette modalité d'être conscient en étant « pour soi » (thème privilégié de la phénoménologie heideggérienne et sartrienne) apparaît essentiellement historique et axiologique. Historique, en ceci que la personnalité se construit au travers des événements qui armorient chaque moment du temps perdu et dans la perspective du temps ouvert et à venir qui reste encore à remplir. Axiologique, en cela que le système de la personnalité est aussi essentiellement celui des valeurs et des fins propres aux projets de l'ego et de sa transcendance idéale. À ces caractéristiques de l'être conscient en tant que « sujet étoffé » ou « moi » (que E. Pichon distinguait du « je » pronominal) s'ajoute celle d'être tout aussi fondamentalement un être dont l'existence est dialoguée, ce qui de soi exclut le soliloque absolu. La conjugaison à la première personne de tous les modes (au passé, au futur, au conditionnel, au subjonctif) suppose naturellement un usage du pronom qui se retrouve dans les ambiguïtés des trois personnes du verbe, support du discours de soi à soi, comme de soi à l'autre. Autrement dit, l'être conscient, en explicitant historiquement, axiologiquement et verbalement les événements, le sens et le discours de sa personne, demeure un être problématique dans et par sa formulation même. Cela ne veut pas dire qu'il soit un être inexistant, mais, au contraire, qu'il est l'existant par excellence, si, pour être conscient de soi, l'existant humain doit précisément s'interroger pour se diriger. De telle sorte que la dialectique de cette modalité diachronique de l'être conscient, fondatrice de la personne du sujet, est celle du moi qu'il a à être en se déclarant tel, et de l'autre, qui, en lui, contredit à l'ordre de ce devoir et de ce discours.
Ainsi nous apparaît clairement la double structure synchronique et diachronique de l'être conscient, qui se recoupe d'ailleurs et s'entrecroise à chaque instant pour former – par les conjugaisons du moi avec les péripéties des événements et les modalités des possibles ou des devoirs – toutes les configurations actuelles et virtuelles de l'existence. Disons aussi que ces deux modalités d'être conscient, non seulement interfèrent mais sont dans des rapports de subordination, car, bien sûr, le champ de la conscience, qui s'ordonne toujours relativement à l'intentionnalité du sujet, dépend du système de la personne, tandis que la réciproque n'est pas vraie. Si, en effet, dans toute expérience vécue, fût-elle celle de l'inconscient du rêve, le « je » figure comme sujet immanent, quand le moi s'affirme, c'est dans sa transcendance à l'égard de son inconscient.
Et c'est bien en effet comme un ordre composé, comme une architectonie ayant un sens et une hiérarchie que nous apparaissent les structures synchronique (l'organisation du champ de la conscience) et diachronique (système historique et axiologique de la personne) de l'être conscient, soit qu'il vive à chaque moment du temps une expérience soumise aux catégories du réel, soit qu'il soit conscient d'être quelqu'un malgré ce qui, en lui, compromet l'unité et l'identité de sa personne. Rien de ce que nous venons de dire des structures de l'être conscient qui, par conséquent, ne nous contraigne à examiner précisément qu'il est de l'essence de l'être conscient qu'il soit pour lui question de son inconscient.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henri EY : ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Bonneval
Classification
Média
Autres références
-
CONSCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 719 mots
Lequel d’entre nous, enfant, traversant la rue sans regarder ou sautant du haut d’un arbre, n’a jamais été accusé d’être « inconscient » ? Nos parents ou nos éducateurs voulaient nous faire comprendre par là que nous étions aveugles au danger, que nous manquions de lucidité et de la plus élémentaire...
-
PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET CONSCIENCE
- Écrit par Axel CLEEREMANS
- 1 623 mots
La conscience, en tant qu’objet d’étude, représente un des plus grands défis scientifiques du xxie siècle. Le concept de conscience est multiple. Dans son sens premier, le mot « conscience », qui tire son origine du latin conscientia, « avec connaissance », fait référence au savoir : nous...
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...l'appétition pures et simples ; celui de l'âme, où la monade se perçoit dans le sentiment, perception déjà plus distincte que celle du simple vivant ; celui de la conscience proprement dite ou aperception, où la mémoire s'associe à la perception, et celui de l'esprit, où surgissent la réflexion et la raison. Il... -
ARCHITECTURE & MUSIQUE
- Écrit par Daniel CHARLES
- 7 428 mots
- 1 média
...démarquer de Hegel : à la différence de ce dernier, l'auteur de Sein und Zeit refusait d'admettre que la relation sujet-objet, c'est-à-dire la conscience dans l'acception traditionnelle, gouvernât l'élévation de l'étant en général – et notamment de cet étant qu'est l' œuvre d'art – à la vérité.... -
ATTENTION
- Écrit par Éric SIÉROFF
- 1 929 mots
Pour William James, psychologue américain de la fin du xixe siècle, l’attention est la prise de possession par l’esprit d’un élément de la pensée ou d’un objet du monde extérieur, afin que cet élément ou cet objet paraisse plus clair. L’attention a donc pour rôle de contrôler la ...
-
AUTO-ORGANISATION
- Écrit par Henri ATLAN
- 6 258 mots
- 1 média
...projets en général, indépendante de tel ou tel projet particulier ; autrement dit, l'expérience qui produit en nous la conscience de l'intentionnalité. Comme nous l'avions suggéré autrefois, la conscience volontaire serait le résultat de la mémorisation de phénomènes auto-organisateurs, alors que ceux-ci... - Afficher les 86 références
Voir aussi