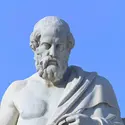CONTRAT SOCIAL
Article modifié le
L'apogée
Plusieurs théoriciens du début du xviie siècle, Suarez, Hooker, Althusius, Grotius, semblent admettre (la question est controversée) l'existence d'un double contrat, dont l'un est destiné à fonder la société et l'autre le gouvernement. Par le premier, les hommes abandonnent l'indépendance dont ils jouissaient dans l'état de nature au profit de la collectivité, qui acquiert ainsi la souveraineté. Ils reçoivent, en échange, protection et garantie de leurs droits individuels (en particulier du droit de propriété). Par le second, le peuple transfère la souveraineté à un ou plusieurs magistrats qui doivent l'exercer dans certaines conditions. Il semble que ces théories constituent une transition. La persistance d'un contrat de gouvernement allait vite être ressentie comme une gêne, tant par les partisans de la monarchie absolue, que par ceux qui, mettant l'accent sur la souveraineté populaire, n'entendaient pas qu'elle soit arrêtée par les droits que le roi pouvait tirer d'un contrat de gouvernement. Ce système présentait en outre certaines difficultés théoriques, car comment concevoir que le roi ait des obligations envers les individus alors qu'il tire ses droits d'un contrat synallagmatique conclu avec la collectivité du peuple. Même si certains, comme Pufendorf, y tenaient encore, la plupart des auteurs allaient abandonner l'idée du double contrat.
Hobbes
Le système de Hobbes repose sur un double postulat. Les hommes sont égoïstes et ne recherchent que leur satisfaction individuelle. Ils sont égaux car le plus faible peut menacer la sécurité du fort. Ce qui caractérise l'état de nature, c'est donc la méfiance mutuelle et la guerre de tous contre tous. Il n'est pas question, à ce stade, de droit naturel. Hobbes distingue le droit de nature, c'est-à-dire la faculté qu'a chacun d'agir par n'importe quel moyen en vue de sa propre conservation, et la loi de nature qui est un ensemble de règles découvertes par la raison et qui interdisent à l'homme de faire tout ce qui peut mener à sa propre destruction. Mais, dans l'état de nature, la loi de nature n'a pas d'effectivité parce qu'elle n'est pas garantie par la force. L'état de nature est donc un état d'insécurité perpétuelle dont les hommes cherchent à sortir. Ils sont en conséquence amenés à conclure un pacte par lequel chacun remet à un homme ou à une assemblée les pouvoirs qu'il a sur lui-même, à la seule condition que les autres en fassent autant. Cet homme (ou cette assemblée) acquiert ainsi la puissance souveraine, dont il doit user pour la protection des sujets. Le fondement de l'obligation d'obéir qu'ont les sujets est à la fois la protection dont ils jouissent et la force du souverain qui les y contraint. Le pacte contient ainsi la garantie de sa propre effectivité. Il est également clair, d'une part, qu'il n'y a pas de limite au pouvoir du souverain et que celui-ci ne peut être déposé, parce qu'il n'y a pas eu de contrat entre lui et ses sujets, et, d'autre part, que ceux-ci n'ont aucun droit, même si leur protection n'est pas assurée et même si le souverain est un tyran, car, à partir de la conclusion du pacte, toute la force est de son côté. L'originalité de Hobbes est d'avoir échappé au dualisme roi-peuple en supprimant la dualité des contrats et d'avoir ainsi fondé en logique l'absolutisme. Le pacte unique qu'il décrit tient à la fois du pacte d'association et du pacte de soumission. C'est la soumission commune au souverain qui seule fonde la société et garantit sa pérennité.
La doctrine du « trust »
La notion de trust permet d'arriver par des procédés analogues à ceux de Hobbes – la suppression de la dualité des contrats – à des résultats inverses : permettre le gouvernement démocratique. C'est en Angleterre, à l'occasion des révolutions du xviie siècle, que certains écrivains commencent à substituer cette notion de trust à celle de contrat de gouvernement, même si la terminologie n'est pas encore fixée. Á la différence du contrat de gouvernement, le trust – il n'existe pas d'équivalent en droit français – ne comporte pas d'obligations réciproques. C'est simplement une mission confiée par le peuple à des gouvernements en vue de certaines fins. Cela implique deux séries de conséquences. En premier lieu, le trust n'est pas le fondement de l'État, ni de la souveraineté, mais seulement un mode d'exercice du pouvoir. Il n'y a donc plus qu'un seul contrat, le pacte d'association, qui fonde à la fois la société, l'État et le gouvernement. En second lieu, l'accent n'est pas mis ici, comme dans la théorie du contrat de gouvernement, sur des droits et obligations symétriques du roi et du peuple, mais sur les obligations du trustee, c'est-à-dire du gouvernement, et les droits du trustor, c'est-à-dire du peuple. Milton va jusqu'à en déduire le droit pour le peuple de déposer le roi même si celui-ci n'est pas un tyran, simplement en vertu du privilège qu'ont les hommes libres d'être gouvernés comme ils l'entendent.
Ce schéma est repris par Locke. Pour lui, l'état de nature est un état de paix, de bonne volonté, d'assistance mutuelle et de conservation, et qui comporte pour les hommes des obligations et des droits découlant de la loi naturelle. Il y manque seulement une autorité commune et c'est pour établir cette autorité que les hommes concluent le contrat social et se constituent en corps. Ils confèrent au corps social les pouvoirs nécessaires à la poursuite de ses fins : le bien commun et la protection des droits naturels, parmi lesquels Locke fait figurer en bonne place le droit de propriété. Mais comme le pouvoir ne peut être exercé par le peuple constitué en corps, celui-ci doit instituer un pouvoir législatif qui sera le pouvoir suprême. Cette institution n'est cependant pas le résultat d'un contrat. Elle est un trust, ce qui implique au minimum que le peuple peut se révolter lorsque le pouvoir n'est pas exercé conformément au trust. Tel est le sens de la révolution anglaise de 1688, que Locke, théoricien whig, désire justifier. De plus, à cette garantie externe, s'ajoute une garantie interne : pour que le pouvoir législatif ne soit pas exercé au détriment des droits naturels des minorités ou d'une classe particulière, il importe qu'il soit mixte, c'est-à-dire composé, comme dans l'Angleterre de Locke, d'un élément démocratique (les représentants élus du peuple ou Chambre des communes), d'un élément aristocratique (les lords) et d'un monarque, et qu'aucune décision ne puisse être adoptée sans que chacune de ces trois catégories ait donné son consentement. Ainsi véritablement, en renonçant à la liberté de l'état de nature, l'homme n'a pas renoncé au gouvernement de lui-même, puisque aucun de ses droits et aucun de ses intérêts ne peuvent être violés sans son accord.
Rousseau
Comme le pacte de Hobbes, le contrat social de Rousseau fonde à la fois la société et l'État et institue un pouvoir sans limites. Mais là s'arrêtent les analogies. Rousseau ne cherche pas comme Hobbes et les autres théoriciens du contrat social à trouver le fondement logique de l'autorité politique, quelle qu'elle soit, mais seulement d'une autorité telle qu'elle rende les individus aussi libres dans l'état social que dans l'état de nature. Le procédé de la définition causale ou génétique est ici appliqué à une chose qui n'existe pas, mais dont on s'efforce de savoir comment, si elle existait, elle aurait été constituée : « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Le contrat est passé, non pas, comme celui de Hobbes, entre les individus, mais entre les individus pris ut singuli d'une part et le corps social d'autre part, et c'est ce dernier qui devient souverain. Chaque individu renonce à l'indépendance et à tous ses droits naturels et se soumet totalement au souverain. Mais cette soumission n'est que le degré suprême de la liberté, car elle est une soumission à la volonté générale et celle-ci présente certains caractères qui font qu'elle ne saurait ni errer ni opprimer : elle est générale dans sa source et dans son objet. Dans sa source, en ce qu'elle émane des citoyens qui lui sont soumis comme sujets, de sorte qu'elle ne saurait léser personne, puisqu'« il n'est personne qui ne songe à soi-même en votant pour tous ». Dans son objet, en ce qu'elle ne doit pas tendre « à quelque objet individuel et déterminé, parce qu'alors jugeant de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe qui nous guide ». La tâche d'appliquer la loi aux cas individuels échappe à la volonté générale et revient au gouvernement, qui lui est totalement subordonné et ne peut agir que conformément à la loi, expression de la volonté générale. Le système contiendrait ainsi, et telle était l'ambition de Rousseau, comme celle de Locke, une double garantie interne. Cette garantie se trouverait même renforcée par le fait que l'un des éléments est la garantie de l'autre : la généralité de la source garantissant la généralité de l'objet ou vice versa, ce qui permettrait d'admettre ou bien que la volonté générale ne requiert pas l'unanimité, ou bien qu'elle n'ait pas effectivement tous les sujets pour destinataires.
La généralité de la source garantit la généralité de l'objet : il n'est pas nécessaire, affirme Rousseau, que la loi, expression de la volonté générale, soit effectivement appliquée à tous. Il suffit qu'elle soit susceptible de l'être. C'est ainsi que la loi pourrait créer plusieurs classes de citoyens ; son objet resterait général si elle ne déterminait pas à l'avance, même implicitement, quels sont les citoyens qui feraient partie de ces classes. Or tel sera bien le cas si la volonté est générale par sa source, puisque la règle de l'unanimité empêche qu'une fraction soit l'objet d'un privilège ou d'une sujétion particuliers.
De même, la généralité de l'objet garantit la généralité de la source : il n'est pas nécessaire que les citoyens soient unanimes. La volonté générale n'est pas, en effet, la volonté de tous et peut être valablement exprimée par la majorité. Même alors, il n'existe aucun risque d'oppression, car si l'objet est véritablement général, c'est-à-dire si la loi est applicable à tous, la majorité qui voudrait être oppressive s'opprimerait elle-même, ce qui est inconcevable.
À vrai dire, il semble que Rousseau, en renonçant à la fois à l'exigence de l'unanimité et à celle de l'application effective à tous, ait échoué à définir un système cohérent. Le système l'eût été en effet si la généralité de l'objet avait été garantie par l'unanimité, ou la généralité de la source par l'application universelle ; mais en prenant deux termes relatifs, en faisant dépendre la généralité de l'objet de la généralité de la source et celle-ci à son tour de la généralité de l'objet, Rousseau ne ménageait plus aucune garantie interne. Quand l'objet n'est plus général, quand « tous les caractères de la volonté générale cessent d'être [dans la pluralité], quelque parti qu'on prenne, il n'y a plus de liberté ».
Après Rousseau, la doctrine amorce son déclin. Des penseurs importants continuent de s'y référer et emploient le vocabulaire contractualiste. Mais ils doivent compter avec une double critique, exprimée en particulier par Hume : en premier lieu, que la théorie du contrat ne correspond pas à la vérité historique ; ensuite qu'il ne suffit pas de dire que le fondement de l'obéissance est le respect des obligations contractées antérieurement, parce qu'il faudrait encore expliquer pourquoi il est nécessaire de respecter ces obligations. Les auteurs sont donc amenés implicitement à traiter séparément le problème de l'origine de la société, celui de son fondement et celui du fondement de l'obligation d'obéissance, ainsi qu'à apporter à ces problèmes des réponses séparées. Désormais, la notion de contrat ne permet plus de traiter que du second problème, celui du fondement de la société. Encore les auteurs prennent-ils soin de préciser, pour tenir compte de l'objection historique, qu'il s'agit d'un contrat tacite ou fictif, d'une « idée de la raison » (dans la terminologie de Kant), ou de marquer qu'ils entendent exprimer par là le consentement nécessaire des individus à l'existence de la société. Même sur ce plan, cette philosophie individualiste s'est vue attaquée tout au long du xixe siècle aussi bien en Allemagne, par la théorie hégélienne de l'État, qu'en France par l'école positiviste. En outre, réduite à l'idée de consentement tacite des individus à la société, la théorie ne pouvait plus rendre les mêmes services, puisqu'elle ne permettait plus de parler de droits et d'obligations et que, d'ailleurs, à une époque où le problème n'était plus avant tout de limiter le pouvoir, cela cessait d'être nécessaire.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel TROPER : professeur à l'université de Paris-X-Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France
Classification
Autres références
-
ALTHUSIUS JOHANN ALTHAUS dit JOHANNES (1557-1638)
- Écrit par Yves SUAUDEAU
- 1 159 mots
Né à une époque où l'Allemagne, notamment la Westphalie où il naquit, était une succession de petits fiefs animés surtout par les communautés calvinistes, Althusius appliqua sa pensée et son activité à ce contexte, aussi original que sa conception de la souveraineté devait l'être...
-
ANARCHISME
- Écrit par Henri ARVON , Encyclopædia Universalis , Jean MAITRON et Robert PARIS
- 13 395 mots
- 7 médias
...notion de la liberté individuelle, il lui apparaît que l' ordre et la justice, dont il ne nie aucunement la nécessité pour la cité, doivent reposer sur un contrat librement conclu entre les intéressés. Les clauses d'un tel contrat, profitables à tous les contractants, sont observées tout aussi librement.... -
AUTONOMIE
- Écrit par François BOURRICAUD
- 4 125 mots
...seulement le niveau des constitutions politiques, elle s'attaque à la loi morale entendue comme idéal de la volonté qu'elle a pour fonction de gouverner. Pourtant, c'est au plan politique, et dans la théorie de la volonté générale, que le double sens de l'autonomie apparaît le plus clairement. Rousseau... -
AUTORITÉ
- Écrit par Éric LETONTURIER
- 2 800 mots
- 11 médias
..., 1651) à Rousseau (Du contrat social, 1762) en passant par Montesquieu (L'Esprit des lois, 1748) et Locke (Traité du gouvernement civil, 1690), les théories du contrat déclinent, malgré la diversité des formes politiques de gouvernement proposées (absolutisme ou libéralisme), ce nouveau mythe... - Afficher les 34 références
Voir aussi