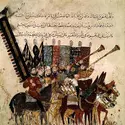COURTOISIE
Article modifié le
L'amour courtois
Un nouvel art d'aimer
La courtoisie concerne en effet, de façon particulière, les rapports entre les sexes. Elle s'oppose à une situation de fait que nous entrevoyons à travers les « chansons de geste », poèmes dont la thématique remonte, pour l'essentiel, au milieu du xie siècle, sinon plus haut encore : mépris des attachements féminins, indignes d'un chevalier, indifférence à la volonté de la femme et complète impudeur de parole. Les mœurs, pendant longtemps encore, consacrent la dépendance totale de la femme, attribuant au mari un droit de correction à peine limité, livrent la fille à la volonté de son père, puis à l'époux qu'il lui choisit. Quoique, depuis la fin du xie siècle, les exceptions à cette règle deviennent de plus en plus nombreuses, l'idéal courtois représente sur ce point une insurrection contre la réalité dominante. Une fiction harmonieuse se substitue à celle-ci, dans le jeu de la cour. Une place d'honneur y est faite à la libre entente amoureuse et au don sexuel réciproque. En d'autres termes, la courtoisie comporte une prédisposition générale à l'amour. Toutefois, ici aussi, une opposition se marque entre le Nord et le Midi. Dans le Nord, l'amour apparaît plutôt comme l'aboutissement, l'épanouissement de la conquête de soi que représente l'acquisition des qualités courtoises. Dans le Midi, l'amour est la source de la cortezia ; celle-ci trouve en lui son aliment et sa justification. Cette différence entraîne des conséquences que les médiévistes, jusqu'à une époque récente, ont eu le tort de négliger. C'est ainsi qu'ils ont généralisé sans nuances l'expression arbitraire d'« amour courtois » (créée vers 1880 par Gaston Paris !), y embrassant des faits complètement hétérogènes. Dans la tradition propre du Nord, la pratique courtoise de l'amour consiste à appliquer aux relations entre homme et femme les vertus de générosité, de discrétion et de fidélité mutuelle qu'exige désormais la vie de cour. Cette conversion implique un art d'aimer assez subtil, aux gentillesses parfois raffinées et qui n'excluent pas de grandes passions, tant que celles-ci restent maîtrisées. L'amour se situe ainsi au sein d'une existence, qu'il anime et éclaire mais qui le dépasse. Il est notable que l'œuvre presque entière de Chrétien de Troyes, principal écrivain courtois de langue française, a pour ressort principal l'amour conjugal, sa croissance, ses cheminements et ses contradictions.
La fin'amor
Dans le Midi, cet amour avec lequel se confond l'existence courtoise porte un nom : fin'amor (l'adjectif fina implique l'idée d'un achèvement). C'est là un terme quasi technique, désignant un type de relation sentimentale et érotique, relativement fixe dans ses traits fondamentaux, en dépit des colorations multiples qu'il peut tenir des tempéraments individuels. La fin'amor est adultère, en imagination sinon toujours en fait. Le mariage est conçu en effet comme l'un des éléments de la contrainte sociale, alors que la courtoisie repose sur le mérite et le libre don. Toute situation amoureuse individuelle est pensée et exprimée en vertu d'un schème, d'origine métaphorique, emprunté aux structures féodales : la femme est suzerain (on l'appelle midons, « mon seigneur », au masculin), l'homme est son vassal. Le lien amoureux s'exprime, du côté de la femme, par les termes juridiques de saisie, saisir ; du côté de l'homme, par service, servir. Le serment de fidélité, le baiser même, quel que soit leur sens érotique, comportent une valeur contractuelle. La « dame » (de domina, proprement « l'épouse du maître ») apparaît donc toujours comme haut placée par rapport à celui qui la désire : fiction marquant, dans les perspectives sociales de l'époque, quelque identité entre la satisfaction espérée et les dons que concède un prince. Par là même, le désir rapproche de façon emblématique du centre de la cour (centre de tout bien) celui qui le ressent. Reconnu, accepté par celle qui en est l'objet, il confère l'onor, terme ambigu, désignant à la fois un fief, un titre de gloire et l'appartenance à Paratge (mot dont le sens propre est « égalité », mais qui, dans l'usage provençal, est relatif à quelque fraternité courtoise, exclusive du monde extérieur). La dame, à un moment qu'il lui appartient de choisir en toute justice, accorde (ou refuse) sa merce, mot qui signifia primitivement « salaire » (cf. notre merci). Il faut entendre par là, sinon toujours l'abandon de sa personne, pour le moins quelque faveur préliminaire, en attendant ce qu'on nomme discrètement, le « reste » ou le « surplus ». La fin'amor en effet, en dépit de ce qu'en ont écrit certains commentateurs pressés ou mal informés, n'est aucunement platonique. Une sensualité profonde l'anime et ne cesse d'affleurer sous les formes d'expression, suscitant dans le discours une abondante (quoique discrète) imagerie érotique : allusions au corps de la femme, au charme des caresses, aux chances qu'offrent l'alcôve, le bosquet du jardin, aux jeux que permet, sur une nudité difficile à toujours dérober, l'incessante promiscuité du château. Certes, la fin'amor comporte, dans les étapes de son déroulement, une subtilité de nuances qui, du point de vue d'une éthique postmédiévale, peut apparaître comme une casuistique confinant parfois à l'hypocrisie. Le désir sexuel se camoufle çà et là sous des hyperboles qui ont pu donner le change aux historiens modernes. Mais il s'agit en réalité d'une attitude générale conforme à l'exigence courtoise de liberté : la possession et le plaisir sont exprimés à l'optatif ou au futur. Ils représentent le terme auquel on aspire ; mais, paradoxalement, la fin'amor implique une sorte d'effroi que l'accomplissement n'entraîne un relâchement du désir. D'où le sentiment qu'un obstacle quelconque, placé entre l'homme et la femme, relève de la nature même de l'amour. La dame est désignée par un pseudonyme plus ou moins symbolique (le senhal ). L'amour partagé s'entoure du plus grand secret, se replie sur le pur échange mutuel des paroles et des gestes dans lesquels il tend à son épanouissement. Tout se passe comme si, au sein de la cour, une dame unique (l'épouse du seigneur) constituait le foyer de désirs multiples (ceux des chevaliers rassemblés), de sorte que la relation amoureuse comporte deux aspects, l'un unique, l'autre multiple. La jalousie paraît dès lors absurde, pourtant on trouve la constante pensée d'autres, impliqués dans le jeu, comme des témoins indiscrets que l'on n'individualise jamais, mais que l'on confond dans le type collectif des lauzengiers, comme des rivaux possibles (gilos), comme des frères de destin (cavaliers, dommejadors). D'où, enfin, le caractère toujours fragile de la plénitude à laquelle on tend, que l'on atteint parfois, que l'on perd pour un rien : celle qu'exprime le mot de joi, « exaltation sentimentale qui, sans être étrangère au désir, le transcende en le spiritualisant » (Belperron). Au reste joi (mot dialectal poitevin, venant du latin gaudium) prend, selon les contextes, diverses valeurs qu'il faut percevoir dans leur implication réciproque : conscience du triomphe de la vie dans la nature printanière, accordée à la beauté de la femme, dans la bienveillance amoureuse de celle-ci, dans le contact savoureux des corps. Le mot en vient à désigner métaphoriquement la dame elle-même, en qui tout se résume et se justifie.
Un hermétisme aristocratique
Mais la fin'amor n'existe qu'au sein de la cour, du réseau de relations qu'ont noué les diverses cours du pays occitan. Elle ne survivrait pas à des contacts habituels avec le monde extérieur. Elle s'en défend, car elle le sent étranger et hostile. Elle sait qu'elle représente virtuellement un scandale pour ce monde rude et trop purement viril du xiie siècle. À plusieurs reprises, des hommes d'Église la condamneront. Une réprobation générale, de leur part, l'entourera au xiiie siècle. C'est pourquoi elle s'est constituée comme une sorte d'hermétisme aristocratique, ayant sa logique propre et sa rationalité qui, considérées de l'extérieur, paraissent vicieuses et contraires à la saine raison. Pour elle, tout ce qui n'est pas elle est fals'amor (« faux amour »). Dieu, quoi qu'on en dise, est avec les fins amants. Le désir est bien en soi, ce qui n'a pas besoin d'être prouvé. Vains et inutiles seraient les prétextes qu'on emprunterait à la religion ou à quelque philosophie que ce fût. Il n'y a pas d'autre métaphysique que l'appel de la beauté et de la vie. Cela n'empêche pas l'existence d'un certain code d'obligations morales, canalisant la liberté de la dame : la nécessité d'accorder sa merce une fois qu'elle a été méritée par le service et l'éloge ainsi que par sa propre inclination. Si la dame s'y dérobait, on romprait avec elle : prouvant ainsi son manque de valor et de pretz, elle se retrancherait alors elle-même de l'univers courtois. Si la fin'amor (ainsi enfermée dans les limites qu'elle a dessinées elle-même) fut « une culture du désir érotique » (J. Frappier), il faut entendre ce mot de culture dans son sens sociologique : on comprend mieux dès lors ce que la civilisation européenne, sur le plan de la sensibilité et des mœurs, hérita de la « courtoisie » occitane.
Hors les sentiers battus du mysticisme
D'où provient, historiquement, cette conception de l'amour ? La question a été souvent débattue, et l'on ne peut tenir les diverses réponses pour assurées. Le problème ne se pose du reste que pour la première génération. Le seul point qui semble hors de doute, c'est l'absence de toute influence religieuse ou mystique. E. Gilson a fait justice de l'hypothèse selon laquelle un lien existerait entre la spiritualité cistercienne et la fin'amor : il est difficile de le suivre quand il admet néanmoins un certain parallélisme des thèmes. La fin'amor reste indépendante des mouvements ascétiques du xiie siècle, par lesquels L. Spitzer et A. Denomy (après C. Appel, A. Jeanroy, E. Wechssler et d'autres) tentent de l'expliquer, l'amour de la femme signifiant, pour ces savants, de manière plus ou moins indirecte, la caritas divine. M. Lazar a prouvé combien la fin'amor est naturellement étrangère à tout mysticisme (sinon pour quelques traits accidentels de vocabulaire tenant au fonds commun d'une civilisation). La dame n'est jamais ni symbole ni métaphore ; tout au plus est-elle, dans certaines œuvres littéraires, un « type » tant soit peu figé, mais dont la signification demeure humaine. L'idée, jadis lancée sans preuves par Denis de Rougemont, d'une collusion avec la secte des Cathares ne résiste pas à l'examen. Il en va de même de celle de J. Wilcox, suggérant une influence du culte de la Vierge (qui s'est en réalité généralisé plus tard, et pourrait même être considéré comme une extension de la courtoisie à la spiritualité).
Restent trois sources possibles. L'une, de nature savante, ne serait autre que les poèmes d'Ovide, en particulier l'Ars amandi et les Remedia amoris, devenus au xiie siècle des classiques scolaires. La deuxième résiderait dans une certaine tradition cléricale remontant au haut Moyen Âge : correspondances plus ou moins amoureuses entre hommes d'Église et moniales (la célèbre liaison d'Abélard et Héloïse doit se situer dans les années 1118-1120) ; poésie latine des vagants ou goliards, où les thèmes érotiques apparaissent dès le xie siècle, sinon même plus tôt. La troisième hypothèse, qu'ont proposée avec vigueur dès l'époque romantique de nombreux savants, décèle dans la fin'amor le produit d'influences musulmanes, plus spécialement andalouses, remontant soit à une certaine notion avicennienne de l'amour, soit à une poésie arabe inspirée par le mysticisme soufi. Quoique cette théorie paraisse de loin la plus probable, elle soulève – en particulier à cause de la différence des langues et des mentalités – des difficultés qui sont loin d'être toutes résolues. Du moins peut-on assurer que, si la fin'amor procède d'une philosophie préexistante, celle-ci a été recueillie simplement en tant qu'elle suggérait certaines formes de sensibilité et d'expression. Quels qu'aient pu être les éléments originels dont se constitua la fin'amor, elle les plia aux exigences et aux aspirations particulières d'un milieu socialement et géographiquement déterminé ; elle les combina en un tout original.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Paul ZUMTHOR : ancien professeur aux universités d'Amsterdam, de Paris-VII, de Montréal
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Média
Autres références
-
‘ABBĀS IBN AL-AḤNAF AL- (748 env.-env. 808)
- Écrit par Régis BLACHÈRE
- 431 mots
À la différence des autres poètes de son temps, al-‘Abbās s'est refusé à n'être qu'un amuseur ou un panégyriste. Il est plutôt le chantre de l'amour, de l'espérance qui le voit naître, des déchirements qui le voient finir. Toutefois cet élégiaque demeure dans les limites de l'« esprit courtois »...
-
ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures
- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL
- 24 589 mots
- 33 médias
...courtoises d'œuvres françaises, Énéide (vers 1170-1190) où Heinrich von Veldeke « ente la première greffe sur l'arbre de la poésie allemande ». Entre 1185 et 1205, Hartmann von Aue, le premier des grands classiques du roman courtois, introduit dans son pays les romans de la Table ronde et du... -
ANDRÉ LE CHAPELAIN (XIIe-? XIIIe s.)
- Écrit par Raoul VANEIGEM
- 1 056 mots
Condamné, en 1277, par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, le De amore d'André le Chapelain n'a pas fini d'alimenter les controverses sur le sens de l'ouvrage et l'identité de l'auteur. Le livre présente une facture antithétique, la première partie célébrant...
-
ARABE (MONDE) - Littérature
- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH , Hachem FODA , André MIQUEL , Charles PELLAT , Hammadi SAMMOUD et Élisabeth VAUTHIER
- 29 248 mots
- 2 médias
...en grande partie cette poésie de la liberté. Au-delà de la diversité des situations et des variations de registre, on peut suivre l'évolution du poème d'amour qui va mettre au point ses langages. Celui de l'amour impossible ou brisé que mettent en scène les couples, célèbres désormais, de Maǧnūn et Layla,... - Afficher les 53 références
Voir aussi