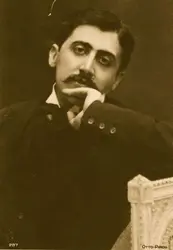CRITIQUE LITTÉRAIRE
Article modifié le
Les modèles contextuels ou explicatifs
La philologie
Ce qu'on appelle une « édition critique » – comprenant l'établissement du texte, c'est-à-dire le choix d'un texte de base, l'établissement des variantes par rapport à ce texte de base, et toute l'information disponible sur les différents états du texte – reste fidèle au sens premier du mot « critique », lorsqu'il s'est réintroduit en français au xvie siècle : « grammairien », « critique », « philologue » désignent alors l'éditeur des textes anciens. En anglais, la philologie se nomme encore textual criticism. Il s'agit du modèle le plus ancien et incontestable de la critique littéraire, perpétué depuis la redécouverte des lettres à la Renaissance, étendu aux textes du Moyen Âge au xixe siècle, puis aux littératures classique et moderne. Le principe de la philologie en France demeure le respect de la dernière édition revue par l'auteur, mais on s'intéresse aussi à la version la plus ancienne d'un texte. Nouveau cas de binarisme : l'histoire de la philologie balance entre deux visions finalisées : le respect de l'intention dernière de l'auteur selon une idée classique valorisant l'achèvement, ou le privilège romantique accordé à la première inspiration.
À côté de la critique externe, qui établit le texte, la tradition philologique distingue la critique interne, qui restitue le contexte, car le sens du texte se déduit à ses yeux des circonstances de son apparition. Cet axiome a été formalisé par l' herméneutique philologique, dont Schleiermacher fut le fondateur en Allemagne, expliquant le texte par son contexte d'origine, et postulant qu'on peut reconstruire ce contexte par la discipline historique.
La philologie n'est plus dominante, mais il y a toujours des philologues, même si on ne pense plus à eux en premier quand on parle de critique littéraire. En Italie, Gianfranco Contini, sous le nom de « critique des variantes », entendue au sens large, a renouvelé au xxe siècle les rapports de la critique et de la philologie. En France, la vieille discipline a été réhabilitée sous l'appellation de « critique génétique », laquelle, marquée par l'approche synchronique et structuraliste, s'intéresse moins au produit qu'à la production, à l'édition critique qu'au processus des états du texte, refusant la vision téléologique qui privilégie l'inspiration première ou l'achèvement parfait.
L'histoire littéraire
Le sixième livre de la Poétique de Jules César Scaliger (1561), intitulé Criticus, dresse un tableau comparatif des poètes grecs et latins : dès le xvie siècle, le terme « critique » n'est plus limité à la philologie. Au cours du xviie siècle, en France, la critique se sépare de la grammaire et de la rhétorique, et remplace peu à peu la poétique, sous laquelle on a parlé de la littérature jusque-là. Lié au scepticisme, au refus de l'autorité et des règles, à la défense du goût et aux belles-lettres, la critique, au sens moderne, apparaît avec l'esprit historique, lors de la querelle des Anciens et des Modernes, en réaction contre une théorie rationnelle ou aristotélicienne de la littérature postulant des canons éternels et universels du jugement esthétique. La critique est inséparable du criticisme : dans sa Critique de la faculté de juger, Kant établira la subjectivité du jugement de goût, qui fait cependant appel à un jugement général, au sens commun de l'humanité. À la fin du xviiie siècle, la critique se présente comme une médiation entre la subjectivité du jugement esthétique et l'objectivité du sens commun, et elle est par définition historique. Herder et les frères Schlegel s'interrogent sur le rapport qui existe entre le jugement personnel et l'objectivité scientifique, l'art et la science.
À son émergence, la critique historique et positiviste, marquée par le romantisme, est relativiste et descriptive. Elle s'oppose à la tradition absolutiste et prescriptive, classique ou néo-classique, jugeant toute œuvre par rapport à des normes intemporelles. Au xixe siècle, le relativisme est lié à l'affirmation de valeurs nationales et historiques, comme dans De l'Allemagne de Mme de Staël. Sainte-Beuve, dans ses Critiques et portraits littéraires, explique les œuvres par la vie des auteurs. Taine, ensuite, explique les individus par trois facteurs : la race, le milieu et le moment ; ce sont les débuts de la critique sociologique, qui se développera plus tard dans une perspective marxiste. Enfin, Ferdinand Brunetière ajoute aux déterminations biographique et sociale celle de la tradition littéraire elle-même, représentée par le genre, qui agit sur une œuvre, ou auquel elle réagit. Brunetière calque l'histoire des genres sur celle des espèces selon Darwin.
La philologie et la critique déterministe partagent l'idée que l'écrivain et son œuvre doivent être compris dans leur situation historique. Au tournant du siècle, marqué par l'histoire positiviste mais aussi par la sociologie de Durkheim, Gustave Lanson formula l'idéal d'une critique objective, réagissant à l'impressionnisme de ses contemporains. Sa position est plus souple que celle de Sainte-Beuve, Taine et Brunetière : l'histoire positiviste accumule les faits relatifs à l'œuvre, à son auteur et à leur temps. Loin des grandes lois de Taine et de Brunetière, les sources et les influences deviennent les maîtres mots de l'histoire littéraire, qui multiplie les monographies et renvoie à plus tard le programme général d'une « histoire de la vie littéraire en France ». Dans l'esprit de Lanson, l'histoire littéraire n'est qu'une première étape, qui n'exclut pas le plaisir de lire ni le contact subjectif avec les textes. Il s'agit de contrôler les impressions, pas de les éliminer. L'histoire littéraire lansonienne s'est pourtant rétrécie à mesure qu'elle fournissait le cadre de l'approche scolaire de la littérature. Ce qui reste déterminant, c'est une conception rationaliste du sujet-auteur présidant à l'œuvre, et une vision strictement référentielle du langage.
Comme le modèle philologique, l'histoire littéraire s'est maintenue. Au milieu des années 1960, la polémique, à propos de Racine, entre Raymond Picard, représentant la Sorbonne, et Roland Barthes, promoteur de la « nouvelle critique », montra que l'histoire littéraire restait un enjeu vivace. Elle demeure très présente, notamment dans l'enseignement de la littérature.
Sociologie et psychanalyse de la littérature
Taine rapportait l'individu à ses conditions sociales. Ce sera le principe du tout-venant de la critique marxiste, faisant de la littérature et de l'art un reflet de la situation économique, de la superstructure un décalque de l'infrastructure. De György Lukács à Lucien Goldmann, cette doctrine est devenue plus complexe, dès lors qu'elle a vu les sujets de la création dans les groupes et non plus les individus, mais elle reste foncièrement déterministe. Moins simplistes, et postulant une autonomie relative des formes esthétiques par rapport aux déterminations socio-économiques, les sociocritiques contemporaines s'inspirent, en Allemagne de Theodor W. Adorno et de l'école de Francfort, en Grande-Bretagne de Raymond Williams et du matérialisme culturel, en France de Louis Althusser et de sa conception de l'idéologie calquée sur le modèle de l'inconscient freudien. De même que le structuralisme génétique de Goldmann, elles tentent une synthèse avec l'approche intrinsèque du texte. Par ailleurs, l'influence de Walter Benjamin a corrigé par le messianisme ce que le marxisme et la critique idéologique ont d'automatisé. Enfin, sous l'impulsion de Pierre Bourdieu s'est développée une sociologie de l'institution littéraire – les écrivains, les académies, l'édition, tout l'appareil de la culture –, fondée elle aussi sur l'idée de l'autonomie du champ littéraire et entreprenant une science non de la production de l'œuvre mais de la production de sa valeur.
Comme la sociocritique s'est adossée au marxisme, la psychocritique adapte la psychanalyse à une approche contextuelle et offre une variante de la critique biographique, par exemple dans le livre consacré à Edgar Poe de Marie Bonaparte. Bien sûr, là aussi, on a cherché des compromis avec la critique interne, introduit une « psychanalyse du texte » (Jean Bellemin-Noël), ou encore une « sémanalyse » (Julia Kristeva). Toutes les variantes critiques marquées par le freudisme, ou par le lacanisme, pourraient figurer dans ce tableau, à mesure qu'elles modifient les conceptions du sujet et du langage qui présidaient au positivisme, mais le principe de toute approche psychanalytique de la littérature reste contextuel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CERISUELO : professeur d'études cinématographiques et d'esthétique à l'université Gustave-Eiffel, Marne-la-Vallée
- Antoine COMPAGNON : docteur ès lettres, professeur à l'université Columbia, États-Unis
Classification
Médias
Autres références
-
ABERCROMBIE LASCELLES (1881-1938)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 295 mots
Poète et critique anglais qui se réfère au groupe des poètes géorgiens (Georgian poets), Abercrombie, après des études à Malvern College, dans le Worcestershire, et à Owens College à Manchester, devint journaliste et commença à écrire des poèmes. Son premier ouvrage, Interludes et poèmes...
-
ABRAHAM PIERRE (1892-1974)
- Écrit par Pierre GAMARRA
- 722 mots
Né et mort à Paris, Pierre Bloch dit Abraham appartient à une famille de la petite bourgeoisie française. Son père, Richard Bloch né à Auxerre, est ingénieur de l'exploitation de la Compagnie d'Orléans. Sa mère, Lorraine, est fille d'un ingénieur des Mines. Pierre Abraham a évoqué lui-même dans ...
-
AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD
- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN
- 29 789 mots
- 28 médias
La littérature noire a longtemps souffert de la faiblesse, voire de l'absence d'un regard critique. Dès 1965, Lewis Nkosi a rendu un grand service à ses confrères en les mettant en garde contre un certain populisme, ainsi dans Home and Exile, puis dans Tasks and Masks (1981), où il nous... -
ALONSO DÁMASO (1898-1990)
- Écrit par Bernard SESÉ
- 1 054 mots
Poète espagnol, Alonso appartient à la fameuse « génération de 1927 » qui, autour de Federico García Lorca, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, regroupe notamment Pedro Salinas, Rafael Alberti, Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Gerardo Diego. Alonso est aussi l'un des critiques...
- Afficher les 147 références
Voir aussi
- LITTÉRATURE SOCIOLOGIE DE LA
- HISTOIRE LITTÉRAIRE
- DÉCONSTRUCTION
- LOGOCENTRISME
- NEW CRITICISM
- ISER WOLFGANG
- FISH STANLEY (1938- )
- MATÉRIALISME CULTUREL
- THÉORIE
- LITTÉRATURE THÉORIES DE LA
- SIGNIFICATION
- FEMME
- PHILOSOPHIE, de 1950 à nos jours
- SUBJECTIVITÉ
- PAROLE
- ÉCRITURE, théories littéraires
- JOURNALISME
- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX
- ANCIENS & DES MODERNES QUERELLE DES
- PSYCHOCRITIQUE
- ENSEIGNEMENT
- ROMANTISME, littérature
- PSYCHOLOGIE DES PROFONDEURS
- DIALOGISME
- LITTÉRARITÉ
- PAVEL THOMAS (1941- )
- HAMON PHILIPPE (1940- )
- MACÉ MARIELLE (1973- )
- BAYARD PIERRE (1954- )