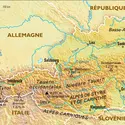CROATIE
| Nom officiel | République de Croatie |
| Chef de l'État | Zoran Milanović - depuis le 18 février 2020 |
| Chef du gouvernement | Andrej Plenković - depuis le 19 octobre 2016 |
| Capitale | Zagreb |
| Langue officielle | Croate |
| Population |
3 859 686 habitants
(2023) |
| Superficie |
56 594 km²
|
Article modifié le
Littérature
La littérature croate est une littérature slave dont la naissance remonte à l'époque où tous les Slaves – y compris la branche dite du Sud à laquelle se rattachent les Croates –, devenus chrétiens, furent dotés de ce qui constitue le fondement de toute culture, notamment littéraire : une écriture et une langue codifiée.
Venus des plaines de Pologne et de Biélorussie entre le vie et le viie siècle, les tribus croates avaient percé jusqu'aux vieilles cités latines de l'Adriatique et cherché tout aussitôt à s'approprier la civilisation des premiers occupants, en adoptant une religion monothéiste et en créant les possibilités d'une communication linguistique sur un territoire dont les frontières, vue l'inexistence des États, restaient d'une extrême mobilité. Ils bénéficièrent du génie linguistique des frères Cyrille et Méthode, inventeurs de la première écriture slave, le glagolitique, et codificateurs d'une langue littéraire idéale, le vieux slave, ou slavon, dans laquelle fut traduite l'Écriture sainte. Tout naturellement, cette langue avait été construite sur la base des parlers slaves de Salonique, pays d'origine de Cyrille et Méthode. À mesure qu'elle rayonnait loin de son point de départ, cette langue s'enrichissait des apports de chacune des tribus qui l'utilisaient. Ainsi en fut-il des Croates. On vit apparaître un type à part de glagolitique croate, et un type de langue fortement influencé par les parlers locaux. Le glagolitique était utilisé non seulement dans la liturgie mais pour le service public, témoin la fameuse pierre de Baška (Baščanska ploča), premier document civil écrit en vieux slave, de rédaction croate et datant du xie siècle.
Le développement de la littérature croate fut très vite entravé par un événement historique d'une importance considérable : la fin, en 1102, de l'État croate indépendant et l'entrée de la Croatie dans l'« Union personnelle » avec les Hongrois, qui devait durer jusqu'à la chute de l'Autriche-Hongrie en 1918.
La perte de l'indépendance eut d'abord pour effet de renforcer les dialectes tout en favorisant la confusion des écritures et l'influence des impérialismes culturels étrangers. Cependant, au fil des ans se dessinèrent les frontières de régions présentant un certain degré d'unité linguistique : Dalmatie du Nord, Istrie, Lika (écriture glagolitique tchakavienne) ; Dalmatie (écriture latine tchakavienne) ; Croatie du Nord (kaïkavien, avec influence du hongrois). Les textes circulent librement entre ces trois territoires. Le public raffole des textes sacrés apocryphes (traductions de la Vie d'Adam, de l'Évangile de Nicodème, des Actes des apôtres), de la vie des saints – notamment de saint Jérôme, présumé croate et inventeur du glagolitique –, ou de celle de la Vierge. Parmi les œuvres profanes, il faut signaler comme particulièrement populaires un Roman de Troie (Rumanac trojski, traduit de l'italien vers 1300) et une Alexandride (Aleksandrida) qui constitue le plus beau texte de la littérature médiévale des Slaves du Sud.
Aux avant-postes
Mais l'art littéraire fait vraiment son apparition avec l'œuvre de Marko Marulić (1450-1524). Latiniste réputé (notamment pour une épopée, Davidias, dont la publication ne date que d'une époque récente), auteur d'ouvrages de morale abondamment publiés à l'étranger, Marulić est le premier écrivain croate d'audience internationale. De son œuvre en langue croate, on retient essentiellement Judith (Judita), épopée écrite en 1501 et qui fera l'objet de trois éditions successives. Inspirée directement d'un épisode de l'histoire croate, la défaite des armées turques sous les murs de Split, ville natale de l'auteur, Judith se présente comme une œuvre de caractère national et constitue le prototype de l'épopée populaire écrite selon des critères artistiques, avec références évidentes à la Bible. Les guerres contre les Turcs allaient considérablement entraver le développement historique de tous les peuples des Balkans, mais, parmi eux, il en est peu auxquels elles aient coûté aussi cher qu'aux Croates : l'épanouissement équilibré du féodalisme, le développement des villes, l'élaboration d'une langue standard, tout fut rendu impossible jusqu'au xixe siècle.
Les Croates, engagés dans une lutte qui dépassait de loin leurs forces, furent contraints de s'exiler en masse, ce qui ne manqua pas de laisser des traces profondes dans la littérature, comme le montre l'étude de la thématique et de la sociologie littéraire de l'époque. C'est ainsi que s'imposent l'héroïsme comme idéal social suprême, le dogmatisme catholique comme vision idéologique fondamentale, et l'épique comme mode d'existence (forma vitae), et par conséquent comme genre littéraire. Le condere urbem de Virgile (fonder la Ville) devint chez les poètes condere patriam. La Ville, pour les Croates, c'était Dubrovnik, territoire indépendant, oasis de culture occidentale et chrétienne au cœur du désert ottoman. Autre exception : la Dalmatie vénitienne, surtout avec Zadar, Šibenik et Split. L'influence réciproque de ces deux milieux culturels fut extrêmement bénéfique pour le développement de l'ancienne littérature croate. En fait, le réseau d'échanges incessants entre Split, Hvar, Zadar et Dubrovnik constitue le ferment de la création littéraire jusqu'au siècle des Lumières.
L'une des particularités de cette création est qu'elle reste profondément enracinée dans la littérature orale. Dès le début du xve siècle, le contenu sémantique de l'oral, dans sa richesse et son intégrité, est assimilé par l'écrit, où il se combine, dans le domaine de la poésie lyrique, avec le pétrarquisme, illustré surtout par Džore Držić (1461-1501) et par Šiško Menčetić (1457-1527) ; dans le domaine épique, avec l'inspiration virgilienne, donnant au cours des siècles des épopées qui figurent parmi les plus grandes œuvres de la littérature croate : Judith, déjà mentionnée (1501), l'Osman (1638), de Gundulić, et La Mort de l'Aga Smail Čengić (Smrt Smail-age Čengić, 1845), de Mažuranić.
D'autres formes littéraires font leur première apparition : le roman, avec Les Montagnes (Planine), du Zadarien Petar Zoranić (1508-vers 1569), inspiré par l'Arcadie de Sannazaro ; le théâtre, avec L'Esclave (Robinja) du Hvarien Hanibal Lucić (1485-1553) ; la mascarade, avec Jejupka (L'Égyptienne), d'un autre écrivain de Hvar, Mikša Pelegrinović (vers 1500-1562) ; enfin une sorte de récit de voyage en vers dialogués, Pêche et discours sur la pêche (Ribanje i ribarsko prigovaranje, 1568) dans lequel l'auteur (Petar Hektorović, de Hvar lui aussi, 1487-1572) introduit fort habilement des chants populaires d'une étrange beauté.
Dans le même temps se fait sentir le besoin de traduire en vers épiques la vie immédiate : Brne Karnarutić, de Zadar (1520-1572 env.), écrit La Prise de Siget (Vazetje Sigeta grada, 1584), épopée quasi contemporaine, et Juraj Baraković (1548-1628), dernier grand poète de la Dalmatie vénitienne, une autre épopée, La Fée slave (Vila slovinka).
Mais l'ancienne littérature croate fleurit surtout dans cette cité de Dubrovnik dont toute la vie politique, sociale et artistique est marquée par la présence, à ses portes, des deux grands empires ottoman et vénitien, et en outre par les liens étroits qui l'unissent à l'Église catholique romaine. Déjà Mavro Vetranović (1482-1576) cherche une réponse aux problèmes de son temps dans le sentiment religieux, ainsi qu'en témoignent L'Hermite (Remeta), sorte de long soliloque, et Le Pèlerin (Piligrin), épopée inachevée dont la chorégraphie s'inspire de la Comédie de Dante. C'est l'âge d'or de la Renaissance, surtout pour la pastorale et la comédie. Nikola Nalješković (vers 1500-1587), d'abord pétrarquiste, écrit par la suite des pièces de théâtre qui ouvriront la voie au plus grand poète comique de l'histoire de Dubrovnik et de la Croatie : Marin Držić (1508-1567).
Držić excelle dans la pastorale – Vénus et Adonis (Venera i Adon), entre autres, compte parmi les créations du genre les plus intéressantes en Europe occidentale –, puis dans la comédie : L'Oncle Maroje (Dundo Maroje), L'Avare (Skup). C'est aussi l'époque des derniers pétrarquistes, tels que Dinko Ranjina (1536-1607), avec ses Poèmes divers (Pjesni razlike, 1563), et Dominko Zlatarić (1558-1613), auteur de poèmes d'amour et traducteur du Tasse, de Sophocle et d'Ovide.
La position géopolitique de la Croatie fit que la Réforme y resta sans effets. Il faut cependant signaler l'œuvre de Matija Vlǎcić (Flacius Illyricus, 1520-1575), qui vivait en Allemagne, fondateur de l'herméneutique moderne ; et, bien entendu, l'action de la Contre-Réforme, à une époque où la domination turque connaissait ses premières faiblesses, ce qui permit aux jésuites de faire de la Croatie une plate-forme de départ pour la reconquête des territoires orientaux. Dans cette ambitieuse perspective, Dubrovnik, enclave libre en terre ottomane, constituait un atout particulièrement précieux. Là, les valeurs morales et spirituelles envahirent de nouveau la littérature, tandis que l'Église commençait à s'intéresser aux problèmes de la codification de la langue. Bartol Kašić, de dialecte tchakavien, fait imprimer à Rome la première grammaire croate, Institutiones linguae illyricae (1604), en se fondant, deux siècles avant Ljudevit Gaj, sur le dialecte chtokavien.
C'est à l'époque où le recul des frontières de l'Empire ottoman favorise la recherche historique et linguistique qu'apparaît le plus grand poète de Dubrovnik, Ivan Gundulić (1589-1638), traducteur des psaumes de David, auteur notamment d'un poème baroque « en trois lamentations », Les Larmes de l'enfant prodigue (Suze sina razmetnoga), de Dubravka, hymne de reconnaissance à la libre cité de Dubrovnik, enfin de la plus grande épopée croate, Osman. Loin du rationalisme critique d'un Marin Držić, le très catholique Gundulić s'en tient au statu quo : amour de sa cité, haine de l'Infidèle, solidarité avec le monde slave, proche ou lointain, et, surtout, cette pietas christiana qui est aussi un sentiment de compassion pour tout ce qui souffre, peuples ou individus.
Ivan Bunić Vučić (1592-1658), sans doute le meilleur poète lyrique de Dubrovnik, auteur de Plaisirs (Plandovanja), paye son tribut à l'épopée religieuse avec sa Madeleine repentie (Mandaljena pokornica) ; Džono Palmotić (1606-1657), traducteur de la Christiade de Girolamo Vida, se distingue par l'abondance de son œuvre, notamment dans le domaine du mélodrame. Avec Stijepo –Durd̄ević (1579-1632) et Vladislav Menčetić (1617-1666), cultivant tous deux le genre épique, c'est l'âge d'or de Dubrovnik qui touche à sa fin. À l'époque même où la vieille cité était rasée par un tremblement de terre (1667), l'Empire ottoman étendait ses frontières et repoussait jusqu'au nord de la Croatie, à Zagreb, le centre politique et culturel du monde croate.
Il s'ensuit que le dialecte kaïkavien, parlé dans cette région, fait une entrée massive dans la langue littéraire. Néanmoins, c'est le dialecte chtokavien du Sud-Est, parlé à Dubrovnik et dans les territoires sous domination turque, qui est ressenti comme devant conquérir une position centrale. Dans ce contexte de combats violents contre les Turcs s'inscrivent les figures de deux fameux écrivains, conjurés décapités pour complot contre l'empereur d'Autriche : Petar Zrinski (1620-1671), traducteur du hongrois en croate d'une grande épopée héroïque dont son frère Nicolas était l'auteur, La Sirène de la mer Adriatique (Adrijanskoga mora sirena) ; et Fran Krsto Frankopan (1643-1671), qui écrivait des poèmes aussi bien en latin qu'en italien ou qu'en croate et qui traduisit George Dandin. Deux écrivains, Juraj Križanić (1618-1683) et Pavao Ritter Vitezović (1652-1713), tentent de résoudre le problème complexe de la restructuration du peuple croate. Le premier cherche une solution dans le panslavisme ; le second songe à une sorte de pancroatisme au service de Vienne : ils échouent tous les deux. Cependant, les efforts de Vitezović dans le domaine linguistique serviront de modèle à Ljudevit Gaj, qui substituera au pancroatisme l'illyrisme « sud-slave ». Signalons, à la même époque, une œuvre qui reste encore aujourd'hui la plus populaire de la littérature croate : Plaisant Discours du peuple slave (Razgovor ugodni naroda slovinskoga), vaste recueil de vers héroïques réalisant la synthèse de l'écrit et de l'oral, du frère Andrija Kacić Miošić (1704-1760).
L'illyrisme unificateur
La fin du xviiie siècle et le début du xixe parachèvent le morcellement du peuple croate. Après la chute de Venise, la brève occupation des provinces illyriennes par les armées napoléoniennes est lourde de conséquences : fin du féodalisme, éveil de la conscience bourgeoise, affirmation de la langue croate moderne. On peut parler de réelles convergences entre l'illyrisme de Gaj, le croatisme de Vitezović, le sud-slavisme de Kačić, et la variante moderne de l'illyrisme napoléonien.
La littérature de l'illyrisme, férue d'ancienne tradition croate, s'attache d'abord à résoudre le problème de la codification définitive de la langue et, cherchant un parler standard, sélectionne le dialecte chtokavien, qui offre l'avantage d'intégrer la tradition, d'être le plus abondamment représenté dans la littérature orale et, enfin, d'avoir été choisi, à la même époque, par Vuk Karadžić pour codifier la langue littéraire serbe : c'était un grand pas dans la voie du rapprochement et de l'influence réciproque des littératures croate et serbe (et, aujourd'hui, monténégrine et de Bosnie-Herzégovine).
L'illyrisme devait donner à la littérature croate quatre grands poètes : Stanko Vraz (1810-1851), Petar Preradović (1818-1872), Dimitrija Demeter (1811-1872) et, surtout, Ivan Mažuranić (1814-1890), l'auteur de La Mort de l'Aga Smail Čengić, magnifique poème épique où les influences de Marulić et de Gundulić, de Kačić et de la poésie populaire, de Virgile et de Byron, se combinent harmonieusement pour chanter le « dialogue » du christianisme et de l'islam sur le territoire balkanique, et éveiller la conscience des Slaves du Sud.
Ces efforts sont tués dans l'œuf par l'absolutisme de Bach (1850-1860), peu favorable à la création littéraire. Jusqu'en 1918, la Croatie restera coupée en deux par la création de l'Autriche-Hongrie : Croatie du Nord-Ouest et Slavonie sont hongroises, Dalmatie et Istrie autrichiennes. Cet état de choses n'est pas sans laisser de traces dans le développement de la littérature moderne, qui manque d'unité, en dépit de l'unification de la langue. Ce que l'on appelle le renouveau national et littéraire se produit en 1835 à Zagreb et en Slavonie, en 1860 en Dalmatie et vers 1880 en Istrie. Si la Dalmatie se rapproche du centre dès la fin du xixe siècle, l'Istrie devra attendre la proclamation de l'Assemblée des partisans la rattachant à la Croatie, en 1943.
Au-delà du nationalisme
À l'époque où, dans les autres littératures européennes, se développait le réalisme critique, la situation historique des Croates interdisait une création libérée des mythes sociaux et nationaux. Il fallait une littérature apte à mobiliser toutes les classes sociales et pratiquant par conséquent l'idéalisation du réel. Ainsi fit le grand romancier August Šenoa (1838-1881), qui admirait Balzac mais qui, s'inspirant de Walter Scott et de Victor Hugo, écrivait des romans historiques : L'Or de l'orfèvre (Zlatarovo Zlato, 1871), La Révolte des paysans (Seljačka buna, 1877), La Malédiction (Kletva, inachevé) sans pouvoir même se permettre une critique sociale à la mesure de celle des Misérables. Néanmoins, Šenoa reste le fondateur du roman croate moderne ; ses recherches formelles ont permis notamment l'épanouissement des aspirations réalistes d'un Eugen Kumičić (1850-1904), qui vécut à Paris au temps de L'Assommoir et qui s'efforça d'introduire les théories du naturalisme dans une capitale culturelle riche, déjà, d'une université, d'une académie des sciences, d'un musée, d'un parlement, de toute une vie politique et polémique. Avec son roman le plus connu, Olga i Lina (1881), qui rappelle Nana de Zola, il faut citer quelques autres œuvres dans lesquelles s'affirme la lente percée du réalisme : Le Bureau d'enregistrement (U registraturi, 1888), le troisième grand roman d'Ante Kovačić (1854-1889) ; les romans de Ksaver Šandor –Dalski (1854-1935), mais surtout un recueil de nouvelles, Les Vieux Toits (Pod starim krovovima, 1886) ; les nouvelles et les romans de Josip Kozarac (1858-1906), de Vjenceslav Novak (1859-1905), de Janko Leskovar (1861-1944). Toutes ces œuvres, et bien d'autres, jettent les fondements de la littérature moderne, en s'efforçant de substituer la liberté de la pensée à l'engagement national. Il faut souligner le rôle joué dans cette révolution par le poète Silvije Strahimir Kranjčević (1865-1908), qui allie une sensibilité impressionniste au culte de Heine et de Byron. Après lui, Antun Gustav Matoš (1873-1914), critique, poète, prosateur, imposa comme critère dans la littérature croate de son temps l'esprit français et la virtuosité de l'expression. À la même époque, Ivo Vojnović, écrivain de Dubrovnik (1857-1929), publie La Trilogie de Dubrovnik (Dubrovačka trilogija, 1900), œuvre qui amorce la réforme du genre dramatique. Quant à Vladimir Nazor (1876-1949), il se distingue à la fois comme poète, prosateur et essayiste.
La poésie lyrique, libérée de l'utilitarisme nationaliste, s'élève jusqu'à l'universel et connaît un essor particulièrement brillant. Citons entre autres Tin Ujević (1891-1955), poète d'une grande érudition et d'une sensibilité surréaliste : La Lamentation du serf (Lelek sebra, 1920) ; Le Collier (Kolajna, 1926 ; etc.) ; l'expérience expressionniste d'Antun Branko Šimić (1898-1925) ; la génération de l'entre-deux-guerres, avec Gustav Krklec (1899-1977), fin poète paysagiste ; Dobriša Cesarić (1902-1980), qui revient aux « bonnes vieilles formes » d'autrefois ; Dragutin Tadijanović (1905-2007), et ses rapsodies en vers libres.
Une pluralité de styles
L'œuvre monumentale de Miroslav Krleža (1893-1981) reste le point de référence incontournable pour la littérature croate du xxe siècle. Homme de gauche resté à Zagreb, il se refuse à publier sous l'Occupation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la littérature croate de la Résistance se distingue. En témoigne le fameux poème d'Ivan Goran Kovačić (1913-1943), La Fosse commune (Jama, 1943). Le réalisme socialiste, lui, trouvera peu d'écho auprès des écrivains. Survient la rupture avec le Kominform, en 1948. Dès le début des années 1950, la pluralité des écoles et des tendances donne lieu aux ouvrages d'auteurs en plein essor créateur, tels Petar Šegedin (1909-1998), Vladan Desnica (1905-1967), Vjekoslav Kaleb (1905-1996), Mirko Božić (1919-1995), Ivan Raos (1921-1987) et Ranko Marinković (1913-2001), auteur de Cyclope (Kiklop, 1965). Incontournables sont les poètes comme Jure Kaštelan (1919-1990), Vesna Parun (née en 1922), Dragutin Tadijanović (1905-2007), aussi bien que Marijan Matković (1915-1985), auteur dramatique. Deux revues littéraires, Cercles (Krugovi, publiée entre 1952 et 1958) et Raison (Razlog, publiée entre 1961 et 1968), diversifient encore la vie littéraire. Poètes et traducteurs, Ivan Slamnig (1930-2001) et Antun Šoljan (1932-1993) mettent en scène dans leurs romans les antihéros du milieu urbain, tandis que Slobodan Novak (1924-2016) place ses protagonistes dans des lieux écartés. Parmi les poètes se distinguent Slavko Mihalić (1928-2007), Milivoj Slaviček (1929-2012), Vladimir Gotovac (1930-2000). Favorisant les préoccupations philosophiques, la critique littéraire et la poésie, les années 1960 voient apparaître les œuvres de Zvonimir Mrkonjić (né en 1938), de Danijel Dragojević (né en 1934). Parmi les romanciers des années 1970 et 1980 se détachent Ivan Aralica (né en 1930), Nedjeljko Fabrio (1937-2018), Irena Vrkljan (1930-2021), Dubravka Ugrešić (1949-2023), tandis qu'Ivo Brešan (1936-2017) et Slobodan Šnajder (né en 1948) apparaissent comme d'importants auteurs dramatiques. Les innovations poétiques amorcées par Josip Sever (1938-1989) et poursuivies dans les années 1970 vont de pair avec le surgissement de la prose fantastique. La théorie et la critique littéraire profitent des travaux de Stanko Lasić (1927-2017), Viktor Žmegač (1929-2022), Milivoj Solar (né en 1936), Velimir Visković (né en 1951), Vladimir Biti (né en 1952). Predrag Matvejević (1932-2017) est, entre autres, l'auteur de Bréviaire méditerranéen (Mediteranski Breviar, 1987), qui connaît un succès international, et de L'Autre Venise (Druga Venecija, 2002). Les années 1980 ont vu une nouvelle génération d'auteurs se rassembler autour de la revue Quorum, tandis qu'au début de la décennie suivante, la guerre et le démantèlement de la Yougoslavie ont profondément modifié les conceptions d'identité nationale et de langue.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Emmanuelle CHAVENEAU : docteur en géographie
- Christophe CHICLET
: docteur en histoire du
xx e siècle de l'Institut d'études politiques, Paris, journaliste, membre du comité de rédaction de la revueConfluences Méditerranée - Ivo FRANGES
: professeur de littérature croate moderne à la faculté des lettres de Zagreb, directeur de
Croatica , revue pour l'histoire de la littérature croate - Mladen KOZUL : master de science (sciences humaines et philologie) à l'université de Zagreb (Croatie), lecteur de serbo-croate à l'université Paris-IV-Sorbonne
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
CROATIE, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
AUTRICHE
- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR
- 34 129 mots
- 21 médias
...Babel. Le hongrois, à partir du xvie siècle, se substitue progressivement, à l'intérieur du royaume, au latin comme langue administrative, mais, en Croatie, différents dialectes serbo-croates se haussent également au rang de langue de culture. Les villes royales et les Saxons de Transylvanie parlent... -
BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE
- Écrit par Jean AUBOUIN et Michel ROUX
- 7 514 mots
- 1 média
-
DÉMOCRATIES POPULAIRES
- Écrit par Michel LESAGE et Henri MÉNUDIER
- 8 474 mots
- 10 médias
...nationalisme serbe, le poids des anciennes solidarités historiques et économiques avec les pays voisins, tout concourt à faire éclater la Yougoslavie en 1991. La Croatie et la Slovénie proclament unilatéralement leur indépendance, mais la Serbie veut sauvegarder les intérêts des minorités serbes dans ces... -
ÉCLATEMENT DE LA YOUGOSLAVIE
- Écrit par Olivier COMPAGNON
- 313 mots
- 1 média
Mosaïque de peuples née du règlement de la Première Guerre mondiale, intégrée au bloc communiste à partir de 1945 malgré les tentations sécessionnistes de Tito, la république socialiste fédérale de Yougoslavie ne résiste pas à l'effondrement du bloc de l'Est. Au terme d'élections...
- Afficher les 23 références
Voir aussi
- EUROPE, histoire
- MINORITÉS
- RÉVOLUTIONS DE 1848
- EUROPE DE L'EST
- KRAJINA
- PÉTRARQUISME
- ŠENOA AUGUST (1838-1881)
- KUMIČIĆ EUGEN (1850-1904)
- AVAR
- ILLYRIE
- DAYTON ACCORDS DE (nov. 1995)
- CROATO-BOSNIAQUE ou CROATO-MUSULMANE FÉDÉRATION
- GUNDULIĆ IVAN (1588-1638)
- GUERRE CIVILE
- TPIY (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie)
- MESIĆ STIPE (1934- )
- PANNONIEN BASSIN
- PAVELIĆ ANTE (1889-1959)
- ZADAR
- SLAVON
- VIEUX SLAVE
- SERBES
- CROATES
- VITEZOVIĆ PAVAO RITTER (1652-1713)
- VOJNOVIĆ IVO (1857-1929)
- ALEXANDRE Ier KARAGEORGEVIĆ (1888-1934) roi de Yougoslavie (1921-1934)
- MARULIĆ MARKO (1450-1524)
- MIOŠIC ANDRIJA KAČIĆ (1704-1760)
- ILLYRIEN MOUVEMENT
- GAJ LUDEVIC (1809-1872)
- MATOŠ ANTUN GUSTAV (1873-1914)
- HONGRIE, histoire jusqu'en 1945
- GLAGOLITIQUE ALPHABET
- CROATE LITTÉRATURE
- PANNONIE PROVINCE DE
- TRUMBITCH ANTE (1864-1938)