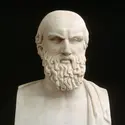CULPABILITÉ
Article modifié le
La culpabilité collective
On voit qu'il est impossible de poser le problème de l'origine de la culpabilité dans l'individu sans rencontrer le social préexistant à celui-ci dans sa dimension historique, c'est-à-dire cette dialectique même « qui scande les enfantements de notre société » et qui ressortit à une psychanalyse de la culture. Comme en biologie, l'ontogenèse est ici une réduplication de la phylogenèse. Ainsi se justifie l'« audacieux empiètement » par lequel Freud se permet d'étudier à l'échelle de « l'espèce humaine tout entière » certains phénomènes inhabituels et pathologiques observés d'abord dans le psychisme individuel, notamment le phénomène de la culpabilité, qui constitue à ses yeux « le problème capital du développement de la civilisation ». Marcuse a bien vu que, pour Freud, le passage nécessaire à la perspective phylogénétique a un point de départ clinique : l'auteur de Totem et tabou repère, dans le sentiment de culpabilité, une sévérité surmoïque qui semble hors de proportion avec des pulsions ou actions individuelles effectivement condamnables, comme si quelque chose, dans l'intensité de l'expérience personnelle de la culpabilité, venait d'ailleurs, d'une expérience universelle, et reflétait l'influence indéclinable d'« événements génétiques », situés dans l'histoire archaïque de l'espèce.
Mais, quand, par le biais du mythe darwinien de la horde primitive, Freud veut donner une valeur figurée à ce qui possède ainsi une extension universelle, il n'a pas vraiment à sortir de la sphère individuelle, car l'historicité du sujet se trouve ancrée originairement dans l'historicité de la culture, l'une ayant à traverser, de la même manière que l'autre, les strates d'un passé qui a, dans les deux cas, les mêmes modalités de survivance. C'est pourquoi la cure a pour corrélat épistémologique indispensable une approche psychanalytique de la culture et même du politique. « Le comportement d'un enfant névrosé, écrit Freud, présente, lors des complexes d'Œdipe et de castration, une multitude de réactions, qui, considérées chez l'individu, paraissent déraisonnables et ne deviennent compréhensibles que si on les envisage sous l'angle de la phylogenèse, en les reliant aux expériences faites par les générations antérieures. »
Le prototype de ces expériences peut être reconstruit, à travers le mythe du meurtre primordial, comme nouant entre eux les trois moments de la fascination exercée par le chef de la horde (possesseur des femmes et maître de la puissance signifiante), de l'éviction de ce père omnipotent et, enfin, de l'apparition d'une angoisse collective de culpabilité. Comme l'a mis en évidence Pierre Kaufmann, l'originalité de Freud, dans Totem et tabou, et plus nettement encore dans Moïse et le monothéisme, est d'avoir vu dans l'appropriation narcissique du langage par le groupe l'acte essentiel d'une violence parricide et « d'avoir rendu cette émergence du langage, en tant qu'elle consacre l'usurpation d'un pouvoir fascinant, solidaire de l'angoisse de conscience, matrice des interdits ». La reconstruction mythique de ce drame fondateur qu'est l'appropriation collective du langage correspond à la remémoration, dans la cure de l'Homme aux rats, de la scène infantile où le scandale d'une explosive rhétorique de l'injure avait déclenché le processus de la névrose obsessionnelle. Pour l'organisation sociale comme pour les structures subjectives individuelles, le langage à l'état naissant prend la forme d'une conquête usurpatrice immédiatement constitutive d'une irrémissible culpabilité, « cette culpabilité, note P. Kaufmann, où se perpétue la hantise qu'a le sujet de sa dépendance amoureuse envers sa victime ». L'instance toute-puissante, bien qu'évincée, continue, en effet, de fasciner et d'interdire. Le monopole qu'elle exerça par rapport à l'articulation signifiante se diffuse et se redistribue sans cesse entre les différents acteurs sociaux et entre les groupes, selon les types historiques de sociabilité et de pouvoir qui se constituent par déplacement, inversion, sublimation ou dénégation de l'angoisse commune relative à cette puissance préhistorique de fascination. À mesure que l'on passe, la figure du père étant occultée, de la société familiale à la société élargie, l'agressivité dirigée jadis contre celui-ci se retourne contre les semblables, chacun pouvant évoquer pour l'autre quelque chose de l'omnipotence paternelle. Mais le risque d'une violence généralisée se trouve limité par des prohibitions sociales dont la rigueur tient à un renforcement, par la civilisation, du sentiment de culpabilité, ce renforcement attisant l'antagonisme entre le progrès culturel et le développement individuel et se traduisant généralement, pour chacun, par une « perte de bonheur ».
L'hypothèse phylogénétique qui fait de l'éviction du père omnipotent la condition originaire de l'apparition du langage humain – elle-même sanctionnée, comme contrepartie, par l'émergence de la culpabilité – ne constitue pas, chez Freud, un ajout hasardeux à la théorie ontogénétique centrée sur la crise œdipienne. Celle-ci, en effet, n'est pas – et par là se trouvent sans objet les accusations portées par le freudo-marxisme et par les auteurs de l'Anti-Œdipe – véritablement constituante du psychisme. Elle n'est que la trace de l'insertion de l'histoire du sujet dans l'histoire de l'organisation sociale. Le mythe phylogénétique a, en réalité, comme le souligne P. Kaufmann, le statut épistémologique d'une « reconstruction proprement théorique de l'ontogenèse » qui répond à une nécessité à la fois spéculative et pratique, car elle prend acte du fait que, dans la cure, « l'analyse d'un langage individuel se reconnaît dépendante des contraintes héritées, en tout être de langage, de l'entrée de l'Homme dans le langage » – du fait que les vicissitudes de la cure tiennent à ce qu'elle « se heurte à la solidité d'organisations dont la trame n'a pas été nouée par l'individu, mais par la constitution même du sujet parlant ».
L'idée de l'héritage collectif d'une culpabilité originaire trouve à s'exprimer de manière privilégiée dans la catégorie de la dette, dont les liens étymologiques et sémantiques avec celle de la faute sont attestés dans plusieurs langues. « Vous me demandez quand j'en aurai fini avec les dettes ? », rétorque Panurge à Pantagruel dans le Tiers Livre. Et il lui explique que « les dettes constituent une sorte de liaison et d'union des cieux et de la terre, un moyen unique de conservation de la race humaine ... [Sans elles] il n'y aurait entre les éléments ni symbolisation, ni interaction, ni aucune transmutation ». Cette théorie de la dette, présente même dans des sociétés que R. Benedict appellerait des shame cultures, notamment dans le brahmanisme (pour lequel la dette est constitutive de l'être humain, qui en est affecté dès l'instant où il vient au monde), indique que la culpabilité de l'individu se ramène à ce qui le fait redevable envers la loi introduite par le langage à l'orée des temps historiques. Une telle dette est, comme celle dont hérita l'Homme aux rats, impossible à payer, car il s'agit, Lacan le répète, de « la dette symbolique dont le sujet est responsable comme sujet de la parole » : le réseau des symboles dont l'homme s'est emparé est, en effet, si total qu'ils enveloppent sa vie avant même sa naissance et qu'ils « définissent la loi des actes qui le suivront jusque là même où il n'est pas encore et au-delà de sa mort même ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Charles BALADIER : éditeur en philosophie, histoire des religions, sciences humaines; ancien élève titulaire de l'École pratique des hautes études
Classification
Média
Autres références
-
AMOUR
- Écrit par Georges BRUNEL et Baldine SAINT GIRONS
- 10 184 mots
- 5 médias
Une des hypocrisies majeures de l'époque présente réside dans la prétention d'ignorer laculpabilité qui résulte de toute tentative pour « réaliser » l'amour. S'il existe assurément une « santé » de l'érotisme face aux conduites morbides des idéalistes, reste que la... -
DETTE, anthropologie
- Écrit par Charles MALAMOUD
- 10 461 mots
- 1 média
...effet, des prières insérées dans les kūśmāṇḍamantra que le Taittirīya Āraṇyaka, avec une remarquable clairvoyance, fait dire au récitant. Cette culpabilité vague que l'on reconnaît et que l'on cherche à préciser par des conjectures anxieuses, ces fautes que l'on admet tout en s'efforçant de les... -
ESCHYLE (env. 525-456 av. J.-C.)
- Écrit par Jacqueline de ROMILLY
- 4 669 mots
- 3 médias
On a donc raison d'avoir peur, de guetter le sens des actes. Et l'on doit d'autant plus trembler que ces mêmes dieux d'Eschyle, une fois la faute commise, ne limitent pas leur colère à l'auteur de cette faute. Par un nouveau trait de cruauté, qui nous gêne beaucoup plus qu'il ne gênait Eschyle, la ... -
FOLIE (histoire du concept)
- Écrit par Alphonse DE WAELHENS
- 4 755 mots
- 1 média
...ambiguïté, qu'on appellerait mieux collusion, sur les rapports de la folie et de la faute. La psychiatrie du xixe siècle, sans bannir toute idée de culpabilité à propos de la folie, tend à dissiper cette ambiguïté dans la mesure où elle cherche, d'une part, à installer partout le plus rigoureux déterminisme,... - Afficher les 13 références
Voir aussi
- PÈRE
- OBSESSION ET NÉVROSE OBSESSIONNELLE
- FAUTE
- CULTURE & CIVILISATION
- HORDE PRIMITIVE, théorie psychanalytique
- NÉVROSE
- RÉSISTANCE, psychanalyse
- TRANSGRESSION, psychanalyse
- SADISME ET MASOCHISME
- ANGOISSE
- INHIBITION, psychanalyse
- INTERDIT, psychanalyse
- ATCHO ALBERT (1903- )
- CURE, psychanalyse
- LANGAGE, psychanalyse
- DODDS ERIC ROBERTSON (1893-1979)
- HESNARD ANGELO LOUIS MARIE (1886-1969)
- PSYCHANALYSE HISTOIRE DE LA
- FREUDIENNE THÉORIE