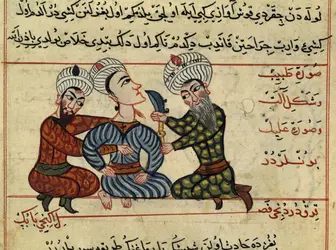- 1. Deux modèles : Burckhardt, Guizot
- 2. Le monogramme de sociabilité et sa manifestation
- 3. Civilisation et culture littéraire : le vulgaire « illustre »
- 4. Civilité et relativité culturelle. Le pacte social
- 5. Ordre politique, Lumières et « Kultur »
- 6. La civilisation conçue comme actualisation de la culture
- 7. L'exemple de l'art
- 8. Rayonnement et « agalma »
- 9. Le for intérieur du social, foyer latent du rayonnement des civilisations
- 10. Origine de la brillance
- 11. Bibliographie
CULTURE Culture et civilisation
Article modifié le
Origine de la brillance
Ainsi retrouvons-nous, généralisée, l'hypothèse avancée par Freud, touchant le narcissisme du langage naissant : « Chez nos enfants et chez les adultes névrosés, comme chez les primitifs, écrivait-il dans Moïse et le monothéisme, nous retrouvons le phénomène mental que nous avons appelé « croyance en la toute-puissance des pensées ». Il s'agit là, à notre avis, d'une surestimation de l'influence que nos facultés mentales – les facultés intellectuelles dans le cas présent – sont capables d'exercer sur le monde extérieur en le modifiant [...]. Toute la magie des mots découle de cette foi [...] comme aussi la conviction du pouvoir lié à la connaissance et à l'énonciation de quelque nom. Nous estimons que la toute-puissance de la pensée exprimait le prix que l'homme attachait au développement du langage qui amena de si extraordinaires progrès des activités intellectuelles. »
Mais nous pouvons faire un pas de plus. « La psychanalyse des individus nous apprend, poursuit Freud, que les impressions les plus précoces recueillies à une époque où l'enfant ne fait encore que balbutier provoquent un jour, sans même resurgir dans le conscient, des effets obsédants. Nous sentons qu'il doit en aller de même quand il s'agit des événements les plus précoces vécus par l'humanité. L'un des effets dus à ces événements serait justement l'apparition du concept d'un seul Dieu tout-puissant ; il s'agit là, il est vrai, d'un souvenir déformé mais malgré tout réel. »
On sait que, dans le langage du mythe adopté par Totem et tabou, l'événement majeur dont a pris origine ce concept de Dieu tout-puissant est celui de la « dévoration » du chef de horde par les frères coalisés. Le recours au mythe, c'est-à-dire la personnification en un récit dramatique des éléments d'un discours, pouvait apparaître indispensable en l'occurrence, pour autant que le langage discursif ne saurait pourvoir à la représentation de ses propres origines. Les dimensions principales de l'analyse n'en sont pas moins claires : si le langage est une puissance – tel est, on vient de le voir, la perception qu'en ont l'enfant et le primitif –, son acquisition doit être ressentie comme une usurpation et, si celle-ci est collective, comme un partage entre les membres du groupe de la substance même de son possesseur initial, s'effectuant en outre par « dévoration », dans le style du cannibalisme primitif naturel à l'assimilation d'une puissance. Mort, l'omnipotent reste cependant aimé ; cet amour entre en conflit avec l'évidence de l'acte accompli ; d'où une culpabilité collective, qui trouve son expression dans l'inscription totémique, matrice des codes futurs.
Mais si le groupe s'est ainsi formé, selon la version freudienne du pacte social, de l'identification des membres de la horde à l'omnipotent dessaisi, nous ne pouvons ni dans la marque de cette communauté, ni dans la figure de l'ancêtre qui la hante et dont cette marque dérive, méconnaître l'insistance du rayonnement qui émanait de lui. Aussi bien, lorsqu'il se « réincarne » par déplacement sur l'image substitutive du « grand homme », s'impose-t-il par ce même éclat solaire dont l'ordalie propre aux temps primitifs et l'invective de Schreber à son Dieu raniment le vestige.
Mais le mythe freudien apporte aussi à la précédente esquisse des œuvres de civilisation une dimension nouvelle.
Notre attention s'était portée d'abord sur l'expression que trouve un type singulier de socialisation dans le style de cohésion de l'œuvre. Nous avions reconnu en outre pour caractéristique d'une telle manifestation le rayonnement dont l'œuvre, en tant qu'œuvre de civilisation, est hic et nunc le véhicule. Cette irradiation pouvait nous apparaître en première analyse comme l'éclosion au jour de la conscience collective du « pacte » dont la collectivité même est issue, la production de ses titres d'origine. Ainsi, en effet, l'entendait Alberti, dans le prologue de son De re aedificatoria. Texte exemplaire, non seulement parce que l'évocation qu'il apporte des origines de la civilisation intervient en un temps où précisément l'humanisme en élabore le concept, mais aussi parce qu'il illustre de la façon la plus saisissante la mise en forme originaire de la société naissante dans l'œuvre de civilisation, architecturale en l'occurrence : « Au dire de certains, c'est l'eau et le feu qui ont été les causes originelles de la réunion des hommes en communauté. Pour nous, au contraire, considérant combien un toit et des murs leur sont non seulement utiles, mais indispensables, nous nous convaincrons qu'ils ont contribué au premier chef à réunir et à maintenir rassemblés les êtres humains. » La cohésion de l'édifice manifeste, hic et nunc, la cohésion de la société à l'état naissant. N'avons-nous pas là un principe général ? Distinguons, en effet, dans la représentation d'Alberti entre la forme et la matière. La matière, en l'occurrence, est celle de l'architecture. Mais si la cohésion par laquelle est illustrée l'énergie d'association semble ici trouver une expression privilégiée dans la solidité du bâti – en sorte que le monument ne s'impose pas seulement par ses chances de conservation, mais en tant que symbole –, celle-ci n'en a pas le privilège. Simplement aurions-nous à en distribuer les figures selon le degré de cohésion des formes concernées. Le problème étant alors de discerner à quel titre chacune d'elles peut prétendre à une fonction de liaison substitutive du pacte social et à un mode original de rayonnement, qu'il s'agisse de la langue, de la fête, des arts, des rites ou des goûts, des moyens ou des styles de la production...
Mais une nouvelle suggestion vient de nous être faite. Dans les termes du mythe, si leurs œuvres de civilisation témoignent, par leur brillance, d'une société se saisissant et jouissant d'elle-même à l'état naissant, c'est que la société ne s'est elle-même intégrée en une totalité que pour s'être assimilé la puissance de rayonnement d'un pouvoir plus primitif. Qu'est-ce à dire, dans la perspective de l'expérience collective la plus concrète, sinon que chaque société ainsi constituée dans une exigence d'autonomie – ainsi que l'indique Aristote au seuil de sa Politique – est sous la hantise du fondement de sa propre genèse ? Et comment, en effet, ne se poserait-elle pas collectivement la question que tout enfant s'est posée et dont l'énigme nous désigne le lieu de son « for intérieur » ? Tel est l'enseignement de Totem et tabou : tout mythe d'origine renvoie à la distinction du fondement auquel reviendrait le pouvoir de justifier l'existence collective. « Pourquoi je... », se demande l'obsessionnel, et chaque homme avec lui. « Pourquoi nous... » se demande la collectivité. Le langage, une fois encore, nous tiendra lieu de modèle. L'omnipotence qualifiant un ordre de signes dont le rapport aux choses ne serait pas arbitraire, l'omnipotent agit à distance, rayonne et fascine. L'entrée dans le langage sera donc usurpation de l'omnipotence, mise hors jeu de l'omnipotent. Mais du côté de l'enfant (le petit Hans de Freud, par exemple) et aussi bien du côté de la collectivité, la fascination ne s'éteint pas, simplement elle subit une mutation, se convertit en intérêt. Disons donc de chaque civilisation qu'elle décrit une distribution caractéristique des intérêts collectifs : on l'entendra en ce sens qu'une société polarisée sur l'énigme de son propre fondement tend à faire rayonner en ses œuvres le chiffre de la sociabilité dont ce pouvoir fondateur serait censé être source. Que chaque civilisation, au demeurant, tienne l'énergie de son rayonnement de la hantise de cette omnipotence abolie nous permet de comprendre le passage à la limite qui, de la spécificité d'un type de sociabilité, nous oriente vers l'illusion « cosmopolitique » d'une civilisation universelle ; de même que le filtrage qu'impose à cette énergie l'environnement naturel donne assise à l'analyse concrète des modalités de la civilisation matérielle, qui le spécifient.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre KAUFMANN : professeur honoraire de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Médias
Autres références
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...siècle par le terme d'affectivité est en réalité propre à toute humanité, c'est-à-dire, dans la mesure où il n'y a pas d'humanité sans culture – sans institution symbolique d'humanité –, propre à toute culture. L'affectivité, pour autant qu'elle désigne « la chose même » à débattre,... -
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
...archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines et vise à comprendre les modes de vie et leurs transformations dans le temps. L'idée des « origines des cultures humaines » est relativement aisée à conceptualiser dans ses dimensions matérielles : la culture commence avec la fabrication... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
...réflexion sur la culture et sur la société, cette dualité devant conduire à deux courants de pensée complémentaires et parfois opposés. Lorsque la notion de culture rejoignit celle de civilisation (sans qu'une hiérarchie fût présupposée entre l'une et l'autre), l'ethnologie repensa son objet en fonction... -
ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 847 mots
- 3 médias
...les Gwama ou les Majangir. Certains pratiquent même une agriculture semi-nomade, en changeant régulièrement de lieux d’implantation. La plupart ont une culture purement orale et échappent à l’alphabétisation, tandis que les villages sont souvent multiethniques et les pratiques religieuses mélangées, au... - Afficher les 96 références
Voir aussi