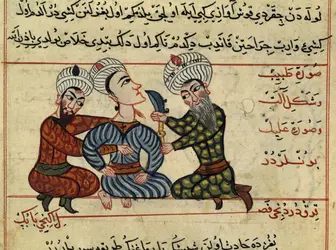- 1. Deux modèles : Burckhardt, Guizot
- 2. Le monogramme de sociabilité et sa manifestation
- 3. Civilisation et culture littéraire : le vulgaire « illustre »
- 4. Civilité et relativité culturelle. Le pacte social
- 5. Ordre politique, Lumières et « Kultur »
- 6. La civilisation conçue comme actualisation de la culture
- 7. L'exemple de l'art
- 8. Rayonnement et « agalma »
- 9. Le for intérieur du social, foyer latent du rayonnement des civilisations
- 10. Origine de la brillance
- 11. Bibliographie
CULTURE Culture et civilisation
Article modifié le
Le monogramme de sociabilité et sa manifestation
Référons-nous plus précisément à la lettre du texte de Thucydide. La constitution est d'emblée considérée comme une pratique (« χρώμεθα γὰρ πολιτεία̩ »), dont le nom de « démocratie » désigne, de la façon la plus générale, la fonction de distribution, et dont l'égalité devant la loi – au regard des intérêts privés –, le critère du mérite – au regard de la hiérarchie des dignités – règlent l'application. Mais ce qui surtout importe, c'est la façon dont le système des rapports de sociabilité ainsi défini vient à s'articuler dans sa réalisation. De l'expression nominale de la πολιτεία, Thucydide passe en effet à l'expression verbale ; il reprend d'un mot le thème de la πολιτεία, mais cette fois sous la forme du πολιτεύειν, terme qui viserait de façon générale toute activité des membres de la cité, et cela en deux domaines : s'agissant d'abord globalement de l'organisation politique, il se complète de l'indication d'une activité dirigée vers la communauté : « Ἐλευθέρως δέ τά τε πρὸς τὸ κοινον̀ πολιτέυομεν κ́αι... » (c'est dans un esprit de liberté que nous agissons comme citoyens en ce qui concerne la chose publique). D'autre part, en étroite connexion avec son emploi précédent, il désignera un style de communication : « [πολιτεύομεν] καὶ ἐς τὴν προς̀ ἀλλήλους τω̃ν καθ'ἠμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν » (et aussi envers la suspicion réciproque dans la vie quotidienne). Par exemple, poursuit Thucydide, « nous sommes sans colère contre celui de nos concitoyens qui agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommage, se présentent au-dehors comme blessantes ». Mais cet esprit de concorde trouve une expression positive et plus sensible : « Nous avons ménagé à l'esprit des délassements sans nombre soit par des jeux et des sacrifices périodiques, soit dans l'intérieur de nos maisons par une élégance dont le charme journalier dissipe les tristesses de la vie. »
Dirons-nous que le type de sociabilité propre à la cité athénienne régit les mouvements de la vie collective ? D'un registre à l'autre, le rapport n'est pas en vérité de cause à effet mais d'un ordre latent à sa manifestation. Le « type » de sociabilité qu'est la πολιτεία recouvre à la fois les activités « tournées vers le public » et les activités interindividuelles. Ce type, le πολιτέυειν l'actualise, l'effectue dans l'un et l'autre domaine. Mais on ne peut laisser alors de s'interroger : cette actualisation des maximes de sociabilité ne porte-t-elle pas d'effet par elle-même ? Songeons par comparaison à la sphère de l'art. Un degré donné d'intensité, un effet de perspective, l'insertion dans un contexte nous offrent la figuration de la qualité dont est marquée la présence actuelle en tant que telle. La peinture n'exhibe pas l'essence de la chose mais son style d'actualisation ; ou encore, si l'on veut, elle nous découvre que l'essence n'est précisément rien d'autre qu'un certain style d'actualisation. L'actualisation des maximes de sociabilité ne relèverait-elle pas d'une interprétation analogue ? Ainsi est amenée l'hypothèse selon laquelle la notion de civilisation recouvre l'ensemble des effets spécifiques que comporte la manifestation hic et nunc d'un monogramme de sociabilité – dans notre exemple la manifestation dans la Grèce du ve siècle de la πολιτεία athénienne.
Hypothèse triviale si elle se bornait à poser la dépendance des productions collectives vis-à-vis d'un régime social. Mais ce qui est en jeu, ce n'est pas la fonction totalisante d'une structure, ce sont les traits caractéristiques – supposé qu'ils soient assignables – dont l'expérience collective est marquée du fait de la manifestation sensible de cette structure immanente ; le fait que la société non seulement s'y reconnaît, mais s'y célèbre et, à travers les œuvres où s'exprime cette jouissance qu'elle prend d'elle-même, lègue à la postérité la capacité de jouir de cette jouissance, à la manière dont le spectateur jouit de la jouissance du peintre, ou l'amour de la jouissance de son objet. Ainsi, lisant le discours de Périclès, retrouvons-nous dans la sobriété pathétique de son témoignage cet émerveillement qu'eut d'elle-même la société d'Athènes et dont ses marbres ou ses textes nous livrent le chant coagulé. Ce chant que Périclès entendit lui-même de la bouche des choreutes d'Eschyle : « Adieu, vivez heureux au milieu des dons de la richesse ; vivez heureux, habitants de cette cité, assis aux côtés de la vierge de Zeus, lui rendant son amour et apprenant chaque jour la sagesse ! Ceux que Pallas abrite sous son aile sont respectés de son père. »
Si les suggestions qui précèdent sont recevables, « culture » et « civilisation » ne s'opposent donc pas comme des régimes antithétiques de la vie collective, mais représentent à son égard deux niveaux ou deux dimensions d'analyse. La πολιτεία athénienne constitue un paradigme pour la société athénienne du ve siècle ; c'est à ce titre, selon la singularité de son type, qu'elle se manifeste dans la singularité d'un style de civilisation. Aussi bien une description comparée des civilisations aura-t-elle à se préoccuper, au premier chef, de la propension dont chacune d'elles se trouve avoir ou non vocation à ériger en norme universelle son propre monogramme de socialisation. « Modèle pour les autres, et non leur incitateur, voilà ce que nous sommes », énonce Périclès, comme si la civilisation d'Athènes avait eu en effet pour spécificité – mais en quel sens ? – d'être pour toute civilisation un modèle.
Plutôt que de nous interroger sur des « critères de la civilisation », dont l'assignation présupposerait ce qui est précisément en question, à savoir leur universalité, nous aurions donc à nous demander comment la représentation que se donnent d'elles-mêmes certaines civilisations est appelée à se traduire de leur point de vue en des normes universelles. Mais la culture ne saurait être neutre à cet égard. En manière d'exemples, envisageons, tour à tour, le témoignage que nous a laissé Grégoire de Tours sur la destruction du paradigme romain et celui de Dante sur l'érection du paradigme théologique de la civilisation. Nous verrons celle-là provoquer une régression de la culture, celle-ci en commander la promotion idéale. Ainsi, en d'autres termes, nous mettrons-nous en état d'assister aux mutations qu'opèrent en des systèmes symboliques, ressortissant à la culture, les modifications intervenues dans les rapports de sociabilité.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre KAUFMANN : professeur honoraire de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Médias
Autres références
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...siècle par le terme d'affectivité est en réalité propre à toute humanité, c'est-à-dire, dans la mesure où il n'y a pas d'humanité sans culture – sans institution symbolique d'humanité –, propre à toute culture. L'affectivité, pour autant qu'elle désigne « la chose même » à débattre,... -
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
...archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines et vise à comprendre les modes de vie et leurs transformations dans le temps. L'idée des « origines des cultures humaines » est relativement aisée à conceptualiser dans ses dimensions matérielles : la culture commence avec la fabrication... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
...réflexion sur la culture et sur la société, cette dualité devant conduire à deux courants de pensée complémentaires et parfois opposés. Lorsque la notion de culture rejoignit celle de civilisation (sans qu'une hiérarchie fût présupposée entre l'une et l'autre), l'ethnologie repensa son objet en fonction... -
ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 847 mots
- 3 médias
...les Gwama ou les Majangir. Certains pratiquent même une agriculture semi-nomade, en changeant régulièrement de lieux d’implantation. La plupart ont une culture purement orale et échappent à l’alphabétisation, tandis que les villages sont souvent multiethniques et les pratiques religieuses mélangées, au... - Afficher les 96 références
Voir aussi