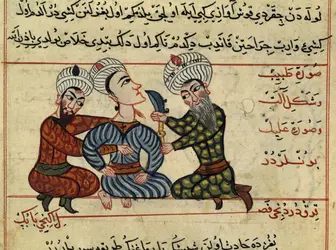- 1. Deux modèles : Burckhardt, Guizot
- 2. Le monogramme de sociabilité et sa manifestation
- 3. Civilisation et culture littéraire : le vulgaire « illustre »
- 4. Civilité et relativité culturelle. Le pacte social
- 5. Ordre politique, Lumières et « Kultur »
- 6. La civilisation conçue comme actualisation de la culture
- 7. L'exemple de l'art
- 8. Rayonnement et « agalma »
- 9. Le for intérieur du social, foyer latent du rayonnement des civilisations
- 10. Origine de la brillance
- 11. Bibliographie
CULTURE Culture et civilisation
Article modifié le
Civilisation et culture littéraire : le vulgaire « illustre »
« Le culte des belles-lettres, écrivait Grégoire de Tours dans sa Préface à son Historia Francorum, est en décadence et même il se meurt dans les villes de Gaule. Aussi, tandis que de bonnes et mauvaises actions s'accomplissaient, que la barbarie des peuples se déchaînait, que les violences des rois redoublaient, que les églises étaient attaquées par les hérétiques et protégées par les catholiques... on ne pouvait trouver un seul lettré assez versé dans l'art de la dialectique pour décrire tout cela en prose ou en vers métriques. »
De l'effondrement violent de la sociabilité – crise de « civilisation », suspension des rapports proprement « civils » – résulte donc l'éclipse d'une culture ; mais Grégoire de Tours nous fait alors assister à l'émergence d'une nouvelle culture : « Un rhéteur qui philosophe n'est compris que du petit nombre mais [...] celui qui parle la langue vulgaire se fait comprendre de la masse » (Historia Francorum, livre I).
Mais nous disposons, à l'autre extrême du Moyen Âge, d'une contre-épreuve touchant les rapports de la civilisation et de la culture.
D'un côté, c'est de l'une des formulations les plus radicales qui aient été données de l'exigence universelle et absolue de réduction de la violence qu'est issue chez Dante la notion de l'ordre « civil », notion spéculative en tant qu'elle reçoit son fondement de l'universalité de l'amour divin, notion politique en tant que ce modèle théologique trouve sa réplique dans l'universalité de l'Empire – héritière de l'universalité romaine. « La miséricordieuse providence du Roi éternel – écrit Dante en sa sixième Lettre –, qui, tout en donnant par sa bonté, l'être perpétuel aux choses célestes, n'abandonne point notre vie ici-bas, qu'il ne saurait mépriser, disposa que les affaires humaines seraient gouvernées par le sacro-saint Empire des Romains, pour que sous la sérénité d'une si haute garde le genre humain fût en repos et qu'en tous lieux, selon ce que requiert nature, l'on vécût civilement. » Toutes les ressources de la théologie et de la logique du De monarchia concourront à opposer cet idéal de « vie civile » à la fureur guerrière.
Mais, d'un autre côté, la restauration du modèle de la communauté appelle l'instauration d'un modèle de la communication. Ce sera l'objet du De vulgari eloquentia de justifier, à ce titre, la suprématie du « parler illustre » d'Italie sur la diversité des dialectes issus de la contingence des lieux et de l'arbitraire des hommes : « Car une langue varie successivement d'âge en âge et ne peut en aucune façon demeurer ; force est bien qu'elle varie en maintes variétés chez ceux qui habitent à l'écart et sans être joints, comme varient en maintes variétés les us et coutumes, qui ne sont rassis ni par nature ni par concorde mais naissent d'humain gré et de convenance locale. » Mais chaque langage particulier est emporté dans le mouvement universel qui ordonne la partie au tout. Et « puisque le vulgaire des Italiens, nous dit le De vulgari eloquentia, sonne en tant de formes diverses, mettons-nous en quête d'une langue entre toutes sans reproche, le parler illustre d'Italie ; et pour que notre chasse puisse trouver une voie bien découverte, arrachons d'abord de la forêt les broussailles emmêlées et les routes ». « En toute espèce de choses, poursuit Dante, il se doit trouver une certaine chose à quoi puissent être comparées toutes choses de ladite espèce, et d'après quoi nous puissions peser les autres et prendre leurs mesures. » Cela « d'après ce qui est le plus simple en leur espèce ». En l'occurrence, donc, de même que la vertu est critère pour l'homme en général de ce qu'il est bon ou mauvais, la loi pour l'homme en tant qu'il agit comme homme citoyen, de même, « dans ce que nous appelons actions italiennes, les signes les plus nobles ne sont le propre d'aucune cité d'Italie, mais ils sont communs à tous ».
Le signe d'une appartenance à une communauté italienne, tel sera donc le critère du parler que nous cherchons. Mais voici l'essentiel : que cette appartenance nous soit effectivement sensible, à travers quatre qualités qui sont celles de l'illustre, du cardinal, du royal et du courtois : l'illustre, qui consacre la puissance et la gloire de l'enseignement ; le cardinal, qui signifie la guidance ; le royal, qui manifeste la capacité de présence en divers lieux et parties ; le courtois, qui atteste l'observance de la règle dans une assemblée. Elles ont, en effet, ces qualités, les meilleurs titres à nous retenir, pour cette raison qu'elles font valoir dans le parler italien le sceau d'instauration d'une communauté, au premier chef cette qualité qui nous le désigne comme illustre : « Mettons à découvert, écrit Dante, pour quelle raison nous désignons comme illustre un certain vulgaire. Par le terme d'illustre, en vérité, j'entends quelque chose qui illumine, et qui, illuminé, resplendit : et nous appelons de la sorte illustre un homme soit quand, illuminé de quelque puissance, il illumine les autres de justice et de charité, soit quand, excellemment enseigné, il enseigne excellemment ; comme Sénèque et Numa Pompilius. Et le vulgaire dont je parle apparaît haut levé en puissance et enseignement, et lève haut les siens en honneur et en gloire. » Entrons plus profondément dans l'analyse du langage. Les signes par lesquels nous communiquons nous présentent un double versant. « Il fallut que le genre humain, pour communiquer d'être à être les choses conçues, eût quelque signe rationnel et sensible ; en effet, devant recevoir de raison et en raison faire entrer sa teneur, ce signe ne pouvait être que rationnel ; et comme rien ne se saurait transporter d'une raison à l'autre sinon par le moyen des sens, il fallait que ce signe fût sensible. Car s'il était seulement rationnel, il ne pourrait passer d'un lieu en l'autre ; s'il était seulement sensible, il ne pourrait rien recevoir de raison ni rien déposer en raison. Or ce signe en vérité est proprement le noble sujet de quoi je parle : car il est chose sensible en tant qu'il est son, mais rationnel en tant qu'on le voit signifier choses et autres selon notre gré. »
Le véhicule de la splendeur est donc le son, par la transmission duquel nous donnons à autrui la participation de notre propre pensée, et la splendeur est la marque sur le mot de cette participation, le témoignage de la communauté qu'il institue, tandis que le sens demeure arbitraire et relatif.
Imaginons cependant de prêter un statut historique à la communauté qui se reflète en ce « miroir de parlure » qu'est le vulgaire illustre, c'est-à-dire de la dissocier, et avec elle le vulgaire illustre, de son modèle théologique. Tous les éléments se trouveraient rassemblés pour une systématique de la civilisation, de la culture et de leurs rapports. Car le lien social faisant loi, pour relatif qu'il soit, pour les rapports qui forment le tissu de la communication, on concevrait que la splendeur du langage lui renvoie sa propre image, dans une jouissance exaltante de soi. Or, pour accéder à cette version profane et relativiste du modèle dont le génie même de Dante nous a ainsi tracé les lignes de force, il n'est que de se laisser guider par l'évolution des concepts.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre KAUFMANN : professeur honoraire de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Médias
Autres références
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...siècle par le terme d'affectivité est en réalité propre à toute humanité, c'est-à-dire, dans la mesure où il n'y a pas d'humanité sans culture – sans institution symbolique d'humanité –, propre à toute culture. L'affectivité, pour autant qu'elle désigne « la chose même » à débattre,... -
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
...archéologique se concentre sur l'étude des produits des activités hominidés/humaines et vise à comprendre les modes de vie et leurs transformations dans le temps. L'idée des « origines des cultures humaines » est relativement aisée à conceptualiser dans ses dimensions matérielles : la culture commence avec la fabrication... -
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
...réflexion sur la culture et sur la société, cette dualité devant conduire à deux courants de pensée complémentaires et parfois opposés. Lorsque la notion de culture rejoignit celle de civilisation (sans qu'une hiérarchie fût présupposée entre l'une et l'autre), l'ethnologie repensa son objet en fonction... -
ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 847 mots
- 3 médias
...les Gwama ou les Majangir. Certains pratiquent même une agriculture semi-nomade, en changeant régulièrement de lieux d’implantation. La plupart ont une culture purement orale et échappent à l’alphabétisation, tandis que les villages sont souvent multiethniques et les pratiques religieuses mélangées, au... - Afficher les 96 références
Voir aussi