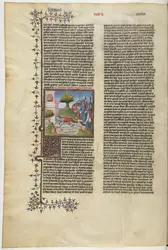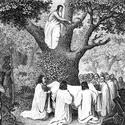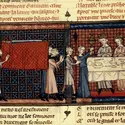ARTHURIEN CYCLE
Article modifié le
Les origines du genre
Une floraison littéraire d'une telle richesse a attiré depuis longtemps l'attention des érudits. On s'est efforcé d'en expliquer la genèse et l'évolution. Pourquoi les exploits d'un héros étranger, du roi d'une terre conquise par les Normands ont-ils pris la place qu'occupaient autrefois les pairs de Charlemagne ? Les romans français se trouvent-ils à la source de la littérature arthurienne européenne ? Faut-il croire que les autres pays n'ont fait que remanier des textes français ? On serait tenté de reprocher aux spécialistes de n'avoir jamais pris une vue panoramique du problème. Les celtisants ne comprennent pas toujours le français médiéval ; les spécialistes du moyen-anglais ont des connaissances assez vagues de la langue irlandaise du Moyen Âge. En outre, nous retrouvons souvent dans toute cette littérature des motifs qui appartiennent au domaine du folklore, par exemple dans le Chevalier Vert ou le Château des Pucelles.
Deux hypothèses principales ont été avancées : selon la plus classique, voici comment les Français ont recueilli la tradition celtique. Après la conquête normande de l'Angleterre, les Français, qui avaient construit des châteaux sur les frontières actuelles du pays de Galles, eurent des contacts répétés avec les Gallois. Rien de plus naturel, pour les romanciers anglo-normands, que d'emprunter les thèmes littéraires de leurs voisins. Ajoutons que le chroniqueur Giraldus Cambrensis (le Gallois) nomme un certain Bledhericus, famosus fabulator, c'est-à-dire un conteur gallois dont le nom se trouve dans le roman français de Tristan, sous la forme Bréri, ainsi que dans d'autres romans arthuriens français. Ferdinand Lot, Joseph Lot et, plus récemment, Jean Marx ont insisté sur l'importance des rapports directs entre Gallois et Normands.
Mais comment expliquer que le poème gallois de Kulwch et Olwen n'ait pas de rapport apparent avec les autres épisodes des Mabinogion ? Que les poèmes en moyen-anglais ont, pour la plupart, des sources françaises et non des sources galloises ?
La seconde hypothèse, avancée par des savants gallois, met en lumière l'intervention d'Armor et des ménestrels. Joseph Bédier, dans son édition du Tristan de Thomas, l'a décrite de façon magistrale. Après la bataille d'Hastings, « toute la civilisation normande se trouva brusquement transplantée telle quelle dans les châteaux d'outre-Manche, et les jongleurs armoricains y suivirent leurs patrons : jongleurs armoricains, mais plus qu'à demi romanisés, mais vivant au service de seigneurs français et contant pour leur plaire ».
Il paraît donc probable que les récits celtiques ont été livrés aux conteurs français par l'intermédiaire des ménestrels bretons, qui étaient bilingues, ou même trilingues. Mais c'est grâce aux auteurs français que le cycle arthurien s'est répandu dans l'Europe entière. On a beaucoup disputé de l'importance de la contribution celtique. Chrétien de Troyes, par exemple, a-t-il tout inventé, ou trouve-t-on dans ses œuvres une large part d'inspiration celtique ? Ne nous transmet-il pas des mythes dont il n'a pas saisi tout le sens ? Le royaume de Gorre, un pays entouré par un fleuve dangereux que l'on ne traverse que par le Pont de l'Épée ou le Pont sous l'Eau, évoque l'Autre Monde des Celtes. Le beau verger, ceint d'une muraille « invisible comme l'air, mais résistante comme l'acier », et d'une palissade où sont plantées les têtes coupées des vaincus, verger qui est le théâtre de la « Joie de la Court » dans Érec, fait songer, lui aussi, à la mythologie celtique. L'Île Noire, ou l'Île de Voire, l'Insula Vitrea de Glastonbury, n'est-il pas un autre souvenir celtique que conserve La Mort le Roi Artu ? Jean Frappier départage les tenants des origines françaises du cycle arthurien des partisans de la souche celtique : c'est, en effet, des rapports entre deux civilisations, l'une celtique et l'autre française, et grâce à l'intermédiaire des conteurs bretons, qu'est né le roman arthurien.
Reste la question de la chronologie. Rien n'est plus difficile que de dater d'une façon précise une œuvre médiévale. La chronologie des œuvres de Chrétien de Troyes est établie avec une certaine exactitude, ainsi que la date du cycle de la « Vulgate ». Quant aux versions tardives des romans en prose, on les situe de deux façons. F. Bogdanow croit à l'existence d'un Roman du Graal, composé postérieurement au cycle de la « Vulgate », mais qui n'est conservé que sous la forme de fragments en langue française, anglaise, espagnole et portugaise. D'autres critiques ont émis une hypothèse selon laquelle ces fragments n'ont jamais formé un cycle homogène, mais représentent des tentatives d'auteurs différents à des époques différentes pour combler les lacunes du déroulement de l'histoire arthurienne. Pour éclairer certaines obscurités, ces auteurs auraient imaginé des épisodes supplémentaires. Ainsi Arthur, à la fin de La Mort Artu, jette dans un lac son épée Excalibur. On nous montre comment il l'a trouvée, toujours dans un lac. La question des sources a retenu l'attention des chercheurs à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle. On a cru que les textes parvenus jusqu'à nous ne représentaient que les fragments épars d'une série de cycles aujourd'hui perdus ; on a donc imaginé de vastes rédactions, dont il ne subsiste que les disjecta membra. Mais à partir des Études de Ferdinand Lot sur le Lancelot en prose, de Vinaver sur le Tristan en prose, de Pauphilet et de Frappier sur La Queste du Saint Graal et La Mort le Roi Artu, de Jeanne Lods sur le Perceforest, on a examiné de façon plus attentive les textes que nous possédons. Entre autres, les mérites littéraires des textes en prose furent ainsi mis en valeur. On a souligné que le cycle arthurien a continué d'évoluer, de se développer. Les textes les plus récents ne sont plus considérés comme les textes les moins beaux. L'histoire littéraire d'Arthur n'apparaît plus comme un rassemblement fragmentaire, mais comme une floraison. On ne parle plus de « variantes banales d'aventures » (Gaston Paris), mais de la genèse d'un roman, d'un « prolongement rétroactif » non dépourvu d'intentions esthétiques.
L'architecture complexe du roman en prose, la sonorité des romans en vers, et même les imprimés plus récents ne cessent de retenir l'attention des érudits. La Société internationale arthurienne leur propose une académie, où l'étude de la littérature inspirée par l'épopée du vieux roi breton s'enrichit tous les jours.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Cedric E. PICKFORD : docteur ès lettres, officier des palmes académiques, professeur de littérature française du Moyen Âge à l'université de Hull (Royaume-Uni)
Classification
Média
Autres références
-
CYCLE ARTHURIEN DANS LA FANTASY
- Écrit par Anne BESSON
- 2 463 mots
Les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers constituent un important champ d'expression du merveilleux littéraire et iconographique. Elles forment, à côté des mythes et des contes, une des sources principales de la fantasy, ce genre né à la fin du xixe siècle d'un besoin de réenchantement...
-
CELTES
- Écrit par Christian-Joseph GUYONVARC'H , Pierre-Yves LAMBERT et Stéphane VERGER
- 15 831 mots
- 5 médias
...conservés dans deux manuscrits, le Livre blanc de Rhydderch (xiiie s.) et le Livre rouge de Hergest. Plusieurs de ces contes sont à rattacher au cycle arthurien, en particulier les trois « romans » d'Owein, Gereint et Peredur (Yvain, Érec et Perceval). Ces romans arthuriens sont les témoins d'une tradition... -
CHRÉTIEN DE TROYES (1135 env.-env. 1183)
- Écrit par Yasmina FOEHR-JANSSENS
- 1 242 mots
- 1 média
...avec certitude. Le nom « Crestien » apparaît dans le Guillaume d'Angleterre, dont le ton et le décor diffèrent pourtant de celui des autres romans. Chrétien construit en effet ses intrigues autour d'un axe spatio-temporel récurrent, la cour légendaire du roi Arthur. Il s'inspire en cela du ... -
FERGUS
- Écrit par Jean-Pierre BORDIER
- 344 mots
Parmi les nombreux romans arthuriens en vers rédigés en français entre la mort de Chrétien de Troyes (peu après 1190) et le Meliador de Froissart (1370-1390), Fergus (vers 1225) a l'originalité de prendre pour héros le fils d'un paysan ; le jeune Fergus pousse la charrue dans le champ de son...
-
FROISSART JEAN (1337 env.-apr. 1404)
- Écrit par Hubert HARDT
- 655 mots
- 2 médias
Poète et chroniqueur français. Entre 1361 et 1369, Froissart séjourna en Angleterre au service de Philippa de Hainaut, devenue reine par son mariage avec Édouard III. Après la mort de celle-ci, il se retira à Valenciennes. Ordonné prêtre, il obtint une cure près de Mons. Il fréquenta la cour des...
- Afficher les 25 références
Voir aussi
- TABLE RONDE ROMANS DE LA
- BROCÉLIANDE
- GIRART D'AMIENS (fin XIIIe s.)
- GILDAS
- QUÊTE DU SAINT-GRAAL ou QUESTE DEL SAINT-GRAAL LA
- GERBERT DE MONTREUIL (XIIIe s.)
- NENNIUS (IXe s.)
- WACE MAÎTRE (1120?-? 1180)
- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE
- RAOUL DE HOUDENC ou DE HOUDAN (XIIIe s.)
- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge
- ANGLAISE LITTÉRATURE, des origines au romantisme
- MABINOGION LES
- CELTIQUES LITTÉRATURES