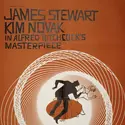STIJL DE
Article modifié le
La peinture
De Stijl fut initialement une congrégation de peintres, auxquels se sont joints ensuite des architectes ; ce sont les peintres qui ont posé les premières pierres de ce principe général. Et si, parmi eux, Mondrian fut le seul à l'avoir radicalement actualisé (lorsqu'il parvint au néo-plasticisme, en 1920), Van der Leck et Huszár travaillèrent eux aussi à son élaboration (le cas de Van Doesburg est plus complexe).
On sait que Van der Leck fut le premier à avoir su élémentariser la couleur (Mondrian lui doit ses couleurs primaires, comme il le dira lui-même dans le dernier numéro du Stijl, hommage posthume à Van Doesburg), mais il ne put jamais parvenir à l'intégration de tous les éléments de ses tableaux. Aussi abstraites qu'aient pu être certaines de ses toiles (et sous l'influence directe de Mondrian il ira presque, de 1916 à 1918, jusqu'à l'abstraction totale), il en est toujours resté à une conception illusionniste de l'espace, le fond blanc de ses tableaux se comportant comme une zone neutre, comme un réceptacle originel, antérieur en quelque sorte à l'inscription des figures. Le prétexte invoqué rétrospectivement par Van der Leck quand il quitte le groupe (la trop grande présence des architectes dans la revue) est en fait secondaire : à partir du moment où la question du fond fut réglée par les autres peintres du Stijl, il ne partagea plus leur langage (et ce n'est aucunement un hasard s'il retourne ostensiblement à la figuration en 1918, au moment de son départ).
Quant à Huszár, sa seule contribution picturale théorique au Stijl est précisément l'élémentarisation du fond ou, plutôt, de la relation figure/fond qu'il réduit à une opposition binaire (dans la plus remarquable de ces œuvres, une linogravure en noir et blanc, il est impossible de démarquer la forme du fond ; nous citerons parmi ses autres compositions la couverture de la revue De Stijl et Marteau et Scie, 1917, seule œuvre à y avoir été reproduite en couleurs, elle est conservée aujourd'hui au Gemeentemuseum de La Haye). Mais l'artiste s'est malheureusement arrêté là, incapable d'intégrer d'autres variantes dans son travail : parti de l'espace illusionniste de Van der Leck (comme en témoigne Composition II-Les Patineurs, 1917, Gemeentemuseum, La Haye), il y retourne au milieu des années 1920 avec de médiocres œuvres figuratives, trop souvent antidatées par les marchands, qui n'ont plus aucun rapport avec De Stijl.
Ayant parfaitement assimilé les leçons du cubisme lors de son premier séjour à Paris en 1912-1914, Mondrian pourra, beaucoup plus rapidement que les autres peintres, résoudre la question de l'abstraction et concentrer ses efforts sur celle de l'intégration. Son premier souci (après avoir opté pour les couleurs primaires) est d'unir la figure et le fond en un tout inséparable, mais sans se limiter à une solution binaire qui rendrait inutile le jeu de la couleur. L'évolution qui le conduira des trois tableaux de 1917 (Composition en couleur A, Composition en couleur B, Composition avec lignes, présentés d'ailleurs en triptyque lorsqu'ils furent exposés pour la première fois) au néo-plasticisme est beaucoup trop complexe pour pouvoir être analysée ici. Notons simplement que Mondrian n'est parvenu à éliminer de son vocabulaire le fond neutre, à la manière de celui de Van der Leck, qu'après avoir utilisé une grille modulaire dans neuf de ses tableaux (1918-1919). Il s'agissait pour lui d'élémentariser la division de ses toiles, c'est-à-dire de trouver un système irréductible de répartition des plans colorés, fondé sur un seul élément (d'où l'utilisation du module, de mêmes proportions que la surface du tableau qu'il divise). Très rapidement, Mondrian abandonna ce système, lui trouvant un caractère régressif ; fondé sur la répétition, il ne privilégiait qu'un seul type de rapport entre les parties du tableau (engendrement univoque). Cependant la grille modulaire lui avait permis de résoudre une opposition essentielle, laissée de côté par les autres peintres du Stijl, celle de la couleur et de la non-couleur. Le premier tableau néo-plastique proprement dit, Composition en rouge, jaune et bleu de 1920 (Stedelijk Museum, Amsterdam), abandonne toute trame régulière.
Van Doesburg, au contraire, eut besoin toute sa vie de la grille parce qu'elle constituait pour lui un garde-fou contre l'arbitraire du signe : malgré les apparences, malgré ses formulations parfois mathématiques, Van Doesburg resta paralysé par la question de l'abstraction (si une composition doit être abstraite, semble-t-il penser, qu'elle soit au moins justifiée par des calculs, que sa configuration géométrique soit motivée). Avant qu'il ne parvienne à la solution de la grille (par le biais de son art décoratif, notamment par ses vitraux), cette obsession avait longtemps fait hésiter Van Doesburg entre le système plastique de Huszár (avec Composition IX – Joueurs de cartes, 1917, succession Van Doesburg, La Haye) et celui de Van der Leck (Composition XI, 1918, Guggenheim, New York) puis elle l'avait conduit à présenter ses toiles comme la stylisation de motifs naturels (une vache, un portrait, une nature morte, ou un danseur par exemple, comme pour Rythme d'une danse russe, 1918, dont toutes les esquisses sont conservées, avec la toile, au musée d'Art moderne de New York). Même s'il essaie un moment d'appliquer ce type d'explication à ses œuvres modulaires (ainsi l'absurde présentation qu'il fit en août 1919 de Composition en dissonance [1918, musée de Bâle] comme étant la représentation abstraite d'« une jeune femme dans son atelier »), c'est au contraire pour son côté mécaniquement répétitif et totalement projectif (décidé à l'avance, appliqué sur le plan du tableau dont la matière et la taille importent peu) que Van Doesburg fut séduit par le système de la grille, c'est-à-dire, en fait, pour les raisons mêmes qui avaient motivé son abandon par Mondrian. Cela permet de comprendre la querelle de l'élémentarisme (mot fort mal choisi par Van Doesburg pour désigner son introduction de l'oblique, en 1924, dans le vocabulaire formel du néo-plasticisme), querelle qui amena Mondrian à quitter le Stijl l'année suivante : si Mondrian refusa violemment cette « amélioration » (selon l'expression de Van Doesburg) dont un des exemples les plus célèbres est Contre-Composition XVI en dissonances (Gemeentemuseum, La Haye), c'est bien moins parce qu'elle dérogeait à la règle formelle de l'orthogonalité (ses propres tableaux à losanges l'avaient déjà fait) que parce qu'elle détruisait d'un coup l'effort accompli pour parvenir à une intégration totale de tous les éléments du tableau (en glissant sur la surface de ses toiles, les lignes obliques de Van Doesburg éloignent de nouveau cette surface du plan du tableau, et l'on se retrouve devant le fond neutre de Van der Leck – c'est-à-dire, pour l'évolutionniste qu'était Mondrian, huit ans en arrière). En bref, bien qu'il soit un peintre tout à fait passionnant, Van Doesburg n'obéit pas dans l'ensemble de son œuvre picturale aux principes d'élémentarisation et d'intégration du Stijl ; mais il est d'autres domaines où il travaille avec beaucoup plus d'efficacité à la mise en œuvre de ces principes, à savoir l'art de l'intérieur et l'architecture.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yve-Alain BOIS : professeur d'histoire de l'art à l'université Harvard
Classification
Autres références
-
MONDRIAN / DE STIJL (expositions)
- Écrit par Guitemie MALDONADO
- 983 mots
- 1 média
La dernière exposition monographique et rétrospective consacrée en France à l'œuvre de Piet Mondrian (1872-1944) datait de 1969 ; présentée à l'Orangerie des Tuileries, elle avait également été la première dans ce pays où l'artiste, Hollandais d'origine, avait pourtant passé près de trente...
-
AFFICHE
- Écrit par Michel WLASSIKOFF
- 6 818 mots
- 12 médias
AuxPays-Bas, le mouvement De Stijl, né sous l'impulsion de Theo van Doesburg et de Vilmos Huszar, en 1917, est en lien avec Dada et s'affirme comme une autre source du constructivisme. Dans l'esprit du mouvement, Bart van der Leck crée des affiches commerciales pour les lignes maritimes... -
AMSTERDAM
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Élodie VITALE
- 2 815 mots
- 3 médias
...renaissance architecturale ne se manifeste finalement qu'au début du xxe siècle, avec le nouveau bâtiment de la Bourse, dû à l'architecte Berlage. Un peu plus tard, l'école d'art abstrait, le Stijlgroep, avec les architectes Oud et Rietveld et les peintres Mondrian, Van Doesburg et Van der Lek, connaît... -
CONSTRUCTIVISME
- Écrit par Andréi NAKOV
- 3 374 mots
- 2 médias
...que se constitue le premier groupe pro-constructiviste. Autour de Théo Van Dœsburg et Piet Mondrian qui, à partir de 1917, publient à Leyde la revue De Stijlsont réunis des peintres et architectes : G. T. Rietveld, Cor Van Eesteren, J. J. P. Oud. Les idées du groupe traduisent la même volonté d'austérité... -
DEL MARLE FÉLIX (1889-1952)
- Écrit par Michel FRIZOT
- 365 mots
- 1 média
La carrière du peintre Félix Del Marle s'organise autour de deux périodes principales, l'une futuriste, l'autre néo-plastique. Del Marle, très intéressé par le Manifeste de Marinetti publié le 20 février 1909 dans Le Figaro, fréquente à Paris les peintres futuristes Boccioni...
- Afficher les 21 références
Voir aussi