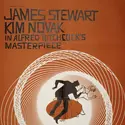STIJL DE
Article modifié le
L'architecture
La contribution du Stijl à l'architecture du siècle est quantitativement beaucoup moins importante qu'on ne le pense généralement : les deux petites maisons que Van't Hoff réalisa en 1916 (avant la fondation du mouvement) sont d'aimables pastiches de Wright ; les constructions de Wils se rapprochent plutôt de l'Art déco (Wils quitte d'ailleurs très vite le mouvement) ; quant à Oud, il appartient beaucoup plus à ce que l'on nomme le Style international qu'au Stijl proprement dit. Cette contribution architecturale du Stijl se résume à peu près aux projets de Van Doesburg et Van Eesteren exposés dans la galerie de Léonce Rosenberg à Paris, en 1923, et au travail de Gerrit Rietveld.
En ce qui concerne les projets Rosenberg, une sombre querelle d'attribution, due aux revendications de paternité de Van Eesteren, oppose depuis longtemps les partisans de l'architecte à ceux de Van Doesburg. Or il s'agit là d'une fausse question, ou plutôt d'une question mal posée : l'essentiel est en effet qu'il y ait une différence formelle très nette entre le premier de ces projets (un élégant Hôtel particulier, qui anticipe de quelques années sur le style international) et les deux derniers (une Maison particulière et une Maison d'artiste), et que cette différence soit la conséquence de l'intervention non du peintre (puisqu'il est cosignataire des trois projets) mais de la peinture : la première maquette était blanche, les deux autres polychromes. Le point de départ de ces deux derniers projets fut en effet la possibilité de penser en même temps l'articulation colorée du bâtiment et son articulation spatiale, et le slogan tapageur mais énigmatique de Van Doesburg selon lequel la couleur devient dans ces projets « matériau de construction » n'est pas un vain mot : c'est en effet la couleur qui permit l'élémentarisation de la surface murale elle-même en conduisant à l'invention d'un nouvel élément architectural, l'unité indivisible de l'écran. Le caractère propre des deux derniers projets Rosenberg, comme le montre Van Doesburg dans les célèbres dessins axonométriques réalisés à cette occasion, tient à la limitation du vocabulaire constructif de l'architecture à ce nouvel élément, l'écran ; celui-ci a deux fonctions plastiques contradictoires (de profil, c'est une ligne de fuite, de face un arrêt de l'extension spatiale en profondeur), ce qui engendre l'interpénétration visuelle des volumes et la fluidité de leur articulation : les murs, le plafond et le sol deviennent des surfaces sans épaisseur, que l'on peut dédoubler, déplier comme des paravents et faire glisser les unes sur les autres (une fois inventé, l'écran s'écartera de son origine chromatique : le seul élément « De Stijl » dans la maison-atelier que Van Doesburg se fit construire à Meudon juste avant sa mort est l'écran qui masque presque totalement une des façades, lui faisant comme une seconde peau).
C'est avec raison que Van Doesburg célébra la maison Schröder de Rietveld (1924) comme la seule application des principes élaborés de manière théorique dans les projets Rosenberg, à cette réserve près que l'usage de l'écran y a une portée beaucoup plus large, car elle s'appuie sur l'élémentarisation de ce qui resta toujours un problème insoluble pour Van Doesburg (et n'avait été traité dans ses projets que d'un point de vue constructif, fonctionnel, anatomique et donc naturel, sous la responsabilité hautement proclamée de Van Eesteren), à savoir l'ossature. Alors que l'élémentarisation de la surface murale avait conduit Van Doesburg et Van Eesteren à faire un usage intensif du plan horizontal en porte à faux (l'une des caractéristiques formelles des projets Rosenberg), l'invention de Rietveld consista à déplacer le porte-à-faux au niveau de l'ossature elle-même, l'élémentarisant en déjouant ironiquement, par une transformation souvent minime, ce qui fait le fondement de toute ossature, c'est-à-dire l'opposition porteur/porté. La maison Schröder est pleine de ces renversements qui viennent sans cesse pervertir la morale fonctionnaliste de l'architecture, le cliché qui voudrait que chaque signe n'ait qu'un sens (le plus célèbre est la fenêtre en coin qui, une fois ouverte, interrompt violemment l'axe constitué par la jonction de deux murs) ; tout le mobilier de Rietveld est construit sur le même modèle (dans la célèbre Chaise bleue et rouge de 1918, un des éléments verticaux est à la fois porté – il est suspendu – et porteur – il soutient l'accoudoir). Qu'il s'agisse d'architecture ou de mobilier, Rietveld conçoit ses œuvres comme des sculptures (et elles sont souvent très proches des meilleures sculptures de Georges Vantongerloo), c'est-à-dire comme des objets indépendants qui ont pour charge de « séparer, limiter et amener à échelle humaine une partie de l'espace illimité », comme il l'écrira dans un texte autobiographique en 1957 (contre Mondrian, pour qui la nature tridimensionnelle de l'architecture était une sorte de tare indélébile, mais aussi contre tous les premiers textes sur l'intérieur publiés dans De Stijl et centrés sur la nature clôturante de l'architecture).
Si Rietveld est le seul architecte proprement dit du Stijl, c'est qu'il a su opposer à la morale fonctionnaliste une autre morale, celle que Baudelaire nommait en son temps la morale du joujou. Tout est mis en œuvre pour flatter notre désir intellectuel de démonter pièce par pièce ses meubles ou ses constructions architecturales (il existe d'ailleurs une photographie d'époque montrant tous les éléments nécessaires à la réalisation de la Chaise bleue et rouge) ; mais, à l'instar de l'enfant baudelairien parti à la recherche de l'« âme » du jouet dans la désarticulation de ses éléments, nous n'apprendrions rien de cette opération de démontage (et nous ne saurions probablement pas reconstruire l'objet démonté), car c'est au contraire dans l'articulation de ces éléments, dans leur intégration que réside l'« âme » en question.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yve-Alain BOIS : professeur d'histoire de l'art à l'université Harvard
Classification
Autres références
-
MONDRIAN / DE STIJL (expositions)
- Écrit par Guitemie MALDONADO
- 983 mots
- 1 média
La dernière exposition monographique et rétrospective consacrée en France à l'œuvre de Piet Mondrian (1872-1944) datait de 1969 ; présentée à l'Orangerie des Tuileries, elle avait également été la première dans ce pays où l'artiste, Hollandais d'origine, avait pourtant passé près de trente...
-
AFFICHE
- Écrit par Michel WLASSIKOFF
- 6 818 mots
- 12 médias
AuxPays-Bas, le mouvement De Stijl, né sous l'impulsion de Theo van Doesburg et de Vilmos Huszar, en 1917, est en lien avec Dada et s'affirme comme une autre source du constructivisme. Dans l'esprit du mouvement, Bart van der Leck crée des affiches commerciales pour les lignes maritimes... -
AMSTERDAM
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Élodie VITALE
- 2 815 mots
- 3 médias
...renaissance architecturale ne se manifeste finalement qu'au début du xxe siècle, avec le nouveau bâtiment de la Bourse, dû à l'architecte Berlage. Un peu plus tard, l'école d'art abstrait, le Stijlgroep, avec les architectes Oud et Rietveld et les peintres Mondrian, Van Doesburg et Van der Lek, connaît... -
CONSTRUCTIVISME
- Écrit par Andréi NAKOV
- 3 374 mots
- 2 médias
...que se constitue le premier groupe pro-constructiviste. Autour de Théo Van Dœsburg et Piet Mondrian qui, à partir de 1917, publient à Leyde la revue De Stijlsont réunis des peintres et architectes : G. T. Rietveld, Cor Van Eesteren, J. J. P. Oud. Les idées du groupe traduisent la même volonté d'austérité... -
DEL MARLE FÉLIX (1889-1952)
- Écrit par Michel FRIZOT
- 365 mots
- 1 média
La carrière du peintre Félix Del Marle s'organise autour de deux périodes principales, l'une futuriste, l'autre néo-plastique. Del Marle, très intéressé par le Manifeste de Marinetti publié le 20 février 1909 dans Le Figaro, fréquente à Paris les peintres futuristes Boccioni...
- Afficher les 21 références
Voir aussi