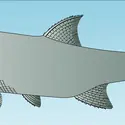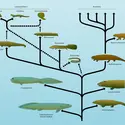DENTS
Article modifié le
Quelques problèmes généraux
Origine des dents jugales des Mammifères
Ce problème, qui est celui de l'origine de la plexodontie, a suscité de nombreuses théories.
Les théories « explicatives » s'appuient essentiellement sur l'anatomie comparée et sur l'embryologie. On a ainsi supposé que les nouvelles cuspides seraient apparues par « bourgeonnement », par « irritation fonctionnelle », par « concrescence », par « fusion de germes dentaires », soit de même génération, soit de générations successives (Bolk). Dans l'état actuel des connaissances, aucune de ces conceptions ne semble plus capable de rallier les suffrages.
Les théories « phylogénétiques » tentent de reconstituer l'évolution de la plexodontie en s'appuyant sur la paléontologie.
La théorie de la multituberculie, développée par M. Friant et R. Anthony (1932), propose de voir dans les molaires multicuspidées des Multituberculés un type (bunodonte) tout à fait généralisé, correspondant à un régime omnivore, et qui serait à l'origine des autres types de dents jugales de tous les Mammifères. Cette conception ne semble pas avoir résisté à l'épreuve du temps.
La théorie lépidomoriale de Stensiö et Ørvig (1961) a été d'abord développée pour rendre compte de l'origine des écailles placoïdes des Sélaciens. Stensiö et Ørvig ont montré que l'écaille placoïde, bien loin de constituer une unité structurale primitive, était au contraire une formation complexe, résultat d'un très long processus évolutif. Les éléments primordiaux de l'exosquelette seraient de minuscules cônes de dentine, les lepidomoria, différenciés à la limite dermo-épidermique au-dessus d'une anse vasculaire. Ces lepidomoria pourraient fusionner entre eux précocement pour former des écailles synchronomoriales plus complexes. Les synchronomoria à leur tour s'assembleraient en écailles cyclomoriales plus grandes, à partir desquelles on pourrait faire dériver l'écaille placoïde.
Comme la dent conique des premiers tétrapodes paraît clairement dérivée d'un type placoïde, elle serait donc passée au cours de son évolution première par les étapes successives décrites ci-dessus : sa simplicité ne serait qu'apparente. Dans cette perspective, l'apparition de la dent pluricuspidée des Mammifères ne serait qu'une manifestation (tardive) des potentialités morphogénétiques variées que la dent haplodonte (écaille placoïde) aurait héritées de son histoire antérieure complexe. Si la théorie lépidomoriale, basée sur des observations irréprochables, paraît extrêmement féconde pour l'étude des tissus durs des Vertébrés inférieurs, beaucoup pensent que l'application que l'on veut en faire pour rendre compte de la plexodontie des Mammifères est loin d'être pleinement convaincante.
Le néotrituberculisme, universellement accepté par les chercheurs, rend compte des faits connus et a apporté aussi une précieuse terminologie. Dû à Cope et Osborn (1874), modifié et complété par Gregory (1910) et Simpson (1936), le trituberculisme pose essentiellement le principe d'une différenciation progressive des dents jugales mammaliennes et se propose de mettre en évidence les homologies entre les diverses cuspides dentaires. Selon ces conceptions, il faudrait distinguer un stade primitif (trigonodonte), ou « trigone primordial », comprenant trois cuspides. Ce stade évolutif primitif est représenté par les molaires du Mammifère jurassiqueDryolestes. Ultérieurement, un « stade tribosphénique » se serait différencié : il est atteint chez le Mammifère paléocène Deltatheridium. Toutes les dents jugales mammaliennes pourraient dériver de ce schéma fondamental.
Si, en effet, chez les premiers Mammifères (non thériens), les cuspides des molaires sont alignées et non disposées en triangle (Triconodontes, Docodontes, Haramyidés), les molaires des Kuehneothériidés du Rhétien et des Symmétrodontidés du Jurassique et du Crétacé inférieur montrent trois cuspides disposées en triangle. Un stade intermédiaire entre cette structure trigonodonte et la molaire tribosphérique des Thériens (chez lesquels les cuspides sont plus nombreuses) pourrait être représenté par la structure observée chez les Eupantothériens (Jurassique-Crétacé inférieur). Dans ce groupe, en effet, si le protocône est absent sur les molaires supérieures, un talonide s'ajoute au trigonide sur les molaires inférieures.
Les découvertes paléontologiques ont mis en évidence une complication progressive et ménagée de la denture à travers toute la série Synapside. Très progressivement et simultanément, le passage se fait de l'homodontie à l'hétérodontie, de la polyodontie à l'oligodontie, de l'haplodontie à la plexodontie. Ainsi, dans une large mesure, les documents actuels réduisent-ils le hiatus morphologique entre dent reptilienne et dent mammalienne, qui avait frappé les théoriciens d'il y a quelques décennies.
Nombre de générations dentaires
Les polyphyodontes possèdent un grand nombre de dentitions successives, toutes semblables ; ce sont les Poissons (jusqu'à cent dentitions successives), les Reptiles (crocodiles et serpents : jusqu'à vingt-cinq dentitions successives). Les oligophyodontes sont essentiellement les Mammifères : le nombre de générations dentaires est réduit et les dentitions qui se succèdent ne sont pas semblables. Les diphyodontes sont les oligophyodontes à deux dentitions, une lactéale et une permanente (majorité des Mammifères actuels, tel l'homme). Les monophyodontes n'ont qu'une seule dentition. Parmi eux, les Édentés et quelques Chiroptères (chauve-souris) ont quand même une dentition lactéale qui régresse tôt et n'est jamais fonctionnelle (monophyodontie apparente). Au contraire, chez les Cétacés odontocètes (dauphins) et les Proboscidiens, seule la dentition lactéale est présente et fonctionnelle toute la vie. La dentition définitive n'existe jamais.
Chez les diphyodontes, certaines dents appartiennent à une dentition unique et ne sont pas remplacées : ce sont les dents monophysaires (ex. : les molaires de l'homme). De nombreux arguments morphologiques et paléontologiques permettent d'interpréter ces dents comme des dents lactéales qui auraient seulement subi un retard dans leur développement et leur éruption : ainsi, par exemple, les molaires humaines définitives auraient plus d'affinités morphologiques avec les molaires de lait qu'avec les prémolaires définitives.
Modes de croissance dentaire
Chez les polyphyodontes, la croissance de chaque dent est limitée et les dents sont remplacées au cours de toute l'existence. Chez les oligophyodontes, les dents peuvent croître selon trois modalités. Dans un premier cas, la croissance est limitée dans le temps, la couronne dentaire est basse (type brachyodonte), la racine est allongée et se ferme assez rapidement à sa base (Insectivores, Carnassiers, Primates). Chez divers herbivores, les dents jugales subissent une forte abrasion mécanique de la couronne, ceci est compensé par une croissance de la dent prolongée une partie de la vie, la racine est courte et reste ouverte (type hypsodonte) et la couronne est très haute (Ruminants, chevaux, éléphants, certains Rongeurs comme le porc-épic). Enfin, certaines dents à usure très rapide se développent toute la vie, la racine est réduite, ouverte (incisives de l'éléphant, des Rongeurs, « corne » du narval, canines des porcs, molaires de certains Rongeurs comme le castor, d'Édentés comme le paresseux ou de l'oryctérope, un Tubulidenté). Les modalités de croissance des dents apparaissent comme des caractères adaptatifs, sans doute aussi importants que l'évolution du dessin des crêtes coronales. En général, dans une lignée évolutive donnée, il y a passage d'un état brachyodonte primitif à un état hypsodonte évolué (lignée du cheval), sans que cela soit nécessairement réalisé selon une modalité « orthogénétique ». L'acquisition d'une croissance dentaire continue paraît être une nécessité mécanique impérative dans le cas de certains régimes alimentaires herbivores, dès lors que l'oligophyodontie remplace la polyphyodontie.
Régression dentaire. Anodontie
Dans certaines lignées appartenant à toutes les classes de Vertébrés, les tissus dentaires régressent ou même disparaissent complètement. Chez les lamproies et les myxines, des formations odontoïdes, d'origine uniquement épidermique et de nature cornée, sont disposées sur les parois de la gueule et sur la langue. Des Poissons comme l'esturgeon et l'hippocampe sont entièrement dépourvus de dents ; chez les Amphibiens, il en va de même des crapauds. Des Reptiles comme les tortues présentent un bec corné et sont totalement privés de dents, contrairement à leurs ancêtres du Trias. Chez les Oiseaux, on connaît l'existence de dents chez l'Archaeopteryx du Jurassique supérieur et chez les formes encore primitives de la fin du Secondaire (Ichthyornis et Hesperornis) ; les formes actuelles sont entièrement anodontes. Selon des expériences embryologiques, les cellules aviennes peuvent induire la différenciation de tissus dentaires : les gènes correspondants n'auraient donc pas été « perdus » au cours de l'évolution des Oiseaux post-crétacés, mais resteraient muets depuis 60 millions d'années ! Parmi les Mammifères, l'échidné dépourvu de dents présente un bec corné ; l'ornithorynque est aussi anodonte au stade adulte. Les Édentés et les Pholidotes ont des dents régressées par quasi-disparition ou disparition totale de l'émail ; les fourmiliers et les pangolins en manquent totalement. Les Cétacés présentent une intéressante évolution régressive des dents. Les formes primitives, comme Pappocetus de l'Éocène, étaient des diphyodontes hétérodontes, condition habituelle des Mammifères. Les Odontocètes actuels (dauphins, marsouins) sont revenus à la polyodontie (200 dents pour le dauphin) et à l'homodontie haplodonte (dents simples toutes semblables), situation fréquente chez les Reptiles et les Poissons. Toutefois, ces Cétacés sont monophyodontes ; le cachalot n'a que 40 à 50 dents et seulement à la mandibule, le narval n'a que deux incisives, la gauche du mâle formant l'énorme « dent de licorne » qui peut atteindre deux mètres. Enfin, les Cétacés à fanons ou mysticètes (baleine) sont anodontes, bien que des germes dentaires se développent avant la naissance, mais ils ne font jamais éruption. Les fanons sont des productions kératinisées issues de l'épiderme de la mâchoire supérieure : ils jouent un rôle de filtre et constituent donc une adaptation au régime planctonophage.
Ainsi, la tendance à la disparition des tissus dentaires se manifeste indépendamment dans certaines lignées, sans qu'il soit toujours possible de rattacher cette évolution à une adaptation nette à l'égard d'un régime alimentaire précis. Les organes cornés, qui jouent très souvent chez les anodontes un rôle analogue à celui de la denture et semblent venir, en quelque sorte, « compenser » sa perte, varient beaucoup dans les différents groupes, souvent en fonction des adaptations particulières, mais ils peuvent aussi fournir parfois d'excellents exemples de convergence morphologique, comme les becs de l'ornithorynque et du canard.
Évolution et signification des tissus dentaires
On a cru longtemps que le cartilage avait précédé tous les autres tissus durs au cours de l'évolution des Vertébrés : l'os, la dentine, l'émail seraient des tissus plus évolués et apparus ultérieurement. La paléontologie moderne s'inscrit en faux contre cette opinion, issue des idées haeckeliennes. Actuellement, on pense que tous les tissus durs mésodermiques sont d'ancienneté égale. Chez les Vertébrés les plus anciens, la présence simultanée de tous les tissus durs mésodermiques, ainsi qu'une certaine interpénétration de leurs caractéristiques (ce qui rend leur classification si difficile), semble indiquer qu'ils ont tous entre eux des rapports étroits ; au cours du déroulement ultérieur de l'évolution, on assisterait à une certaine divergence de ces tissus, qui atteignent chacun leur pleine identité, telle qu'on peut l'observer chez les Mammifères. Chacun de ces tissus (cartilage, os, dentine, cément) paraît alors adapté à un rôle bien particulier, mais cette apparente spécialisation ne doit pas faire illusion : dans une certaine mesure, les dents offrent un exemple de l'« opportunisme de l'évolution » (Simpson) qui a utilisé à une fonction particulière les tissus durs du squelette dermique. Certaines caractéristiques troublantes et très « actuelles » des dents humaines, telle l'hypersensibilité de la dentine mise à nu, ne sont peut-être que le témoignage de la fonction primitivement sensorielle de ce tissu (Tarlo). Les tissus dentaires ne sont certainement pas apparus chez les Vertébrés uniquement « pour » remplir les seules fonctions spéciales de préhension et de concassage des aliments, puisque toutes ces fonctions peuvent très bien s'accomplir en leur absence, comme le montrent les lignées anodontes.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Armand de RICQLÈS : professeur au Collège de France, chaire de biologie historique et évolutionnisme
Classification
Médias
Autres références
-
ACTINOPTÉRYGIENS
- Écrit par Philippe JANVIER
- 2 756 mots
- 9 médias
Au sein des vertébrés à mâchoires, ou gnathostomes, les actinoptérygiens (Actinopterygii Cope, 1887) sont, avec les sarcoptérygiens, l'un des deux groupes d'ostéichthyens. Ils comptent dans la nature actuelle 23 712 espèces de poissons, dont l'immense majorité sont des téléostéens....
-
AMPHIBIENS ou BATRACIENS
- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Philippe JANVIER et Jean-Claude RAGE
- 6 177 mots
- 19 médias
...proies qui viennent s'engluer sur le mucus abondant qui couvre la langue. Dans le plafond buccal antérieur s'ouvrent les choanes (narines internes). Chez les Amphibiens modernes (Lissamphibiens), les dents sont pédicellées, c'est-à-dire que chaque dent comprend deux parties ; la couronne repose sur un pédicelle... -
ANIMAUX MODES D'ALIMENTATION DES
- Écrit par René LAFONT et Martine MAÏBECHE
- 4 313 mots
-
ARCHAEOPTERYX
- Écrit par Eric BUFFETAUT
- 2 120 mots
- 4 médias
...squelette d’Archaeopteryx présente en revanche de nombreux caractères archaïques pour un oiseau, rappelant les dinosaures non aviens. La présence de dents sur les mâchoires est l’un d’entre eux, qui sépare ce genre de tous les oiseaux modernes, mais qui n’a rien d’unique si on considère les fossiles,... - Afficher les 33 références
Voir aussi