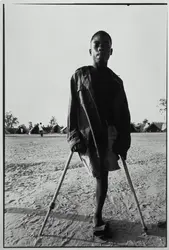DÉSARMEMENT
Article modifié le
La politique de maîtrise des armements
La maîtrise des armements ou arms control repose sur la dissuasion nucléaire, qu'elle conditionne en partie. Son développement est lié aux dangers de la course aux armements nucléaires, spécialement entre les États-Unis et l'U.R.S.S. qui en sont les principaux acteurs. Cette relation fondamentale entre la stratégie de la dissuasion et l'arms control implique une rupture profonde avec l'esprit classique du désarmement, quant à ses principes, quant à ses méthodes, quant à ses orientations.
Les principes
L'objectif essentiel consiste à régulariser la course aux armements afin qu'elle ne débouche pas sur la conquête par l'un des partenaires d'une avance décisive détruisant la situation de dissuasion réciproque. Il ne s'agit donc pas de renoncer à un système de maintien de la paix qui repose sur la capacité d'anéantissement mutuel, mais à l'inverse de le stabiliser et de le conforter. Il n'est pas question de réduire de manière significative le niveau des armements, mais de limiter la course aux armes de destruction massive (ou A.B.C. : atomiques, bactériologiques, chimiques), et surtout aux armes nucléaires. Le domaine des négociations, la portée des engagements se trouvent ainsi étroitement circonscrits. Ils ne prévoient pas en principe de destructions ou de réductions mais interdisent des fabrications ou des usages simplement virtuels.
Les méthodes
Les méthodes présentent deux caractéristiques fondamentales.
D'abord, les négociations ont un caractère profondément inégalitaire. Elles reposent sur l'entente soviéto-américaine, qu'il s'agisse de discussions bilatérales ou multilatérales. Les deux puissances ont pris conscience à la fois de leurs responsabilités et de leurs privilèges. Elles sont les premières intéressées à son maintien et tendent à imposer à autrui leur conception de sa stabilisation. Un symbole en est l'accord bilatéral du 22 juin 1973 qui consacre les deux États comme une sorte de super-Conseil de sécurité dans le domaine nucléaire. C'est pourquoi certains pays – la France et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité et également puissances nucléaires – ont refusé de participer à une entreprise qui leur paraît viser à consolider les avantages acquis des États-Unis et de l'U.R.S.S. Ces positions critiques initiales ont été rejointes par un certain nombre de pays non nucléaires.
Ensuite, la maîtrise des armements rompt avec la méthode globale, qui consiste à tracer un programme général et à chercher à le réaliser progressivement suivant des procédures préétablies et coordonnées. Elle entraîne à l'inverse une pluralité de négociations indépendantes, entre des cercles de participants plus ou moins étendus, autour des États-Unis et de l'U.R.S.S., suivant les questions traitées – négociations bilatérales avec les S.A.L.T. (strategic arms limitation talks), réunion d'une conférence spéciale pour l'Antarctique, recours à un comité spécial dans le cadre des Nations unies pour les fonds marins, utilisation du Comité de Genève dans d'autres cas, etc. Les questions ne sont pas non plus, sauf exception, traitées en fonction d'un ordre de priorités systématiquement conçu, mais en raison de l'actualité ou de la proximité d'un péril qu'il s'agit de prévenir – ainsi la nucléarisation de l'espace extra-atmosphérique, le développement des réseaux antimissiles (A.B.M., Anti-Ballistic Missiles), la mise au point de techniques permettant de modifier l'environnement à des fins militaires. Cet empirisme, lié au dynamisme partiellement incontrôlé des armes de destruction massive, renforce le réalisme et l'intérêt concret des négociations, s'il peut en brouiller les perspectives d'ensemble. On peut cependant distinguer des orientations générales.
Les orientations
La maîtrise des armements s'oriente alors dans deux directions principales.
La limitation de la compétition entre États-Unis et U.R.S.S. dans le domaine des armes de destruction massive, d'abord. Elle comporte deux techniques complémentaires, la limitation territoriale et la limitation fonctionnelle.
La limitation territoriale résulte de traités multilatéraux, même si l'accord soviéto-américain conditionne leur existence et leur efficacité. Elle vise à éviter la dissémination des armes nucléaires dans certains espaces, que l'on souhaite maintenir à l'écart de la course aux armements. Les traités ne portent pas exclusivement sur la limitation des armements mais peuvent contenir des clauses relatives au statut des espaces ou au régime juridique des activités qui s'y déroulent. Ainsi le traité sur l'Antarctique (Washington, 1er déc. 1959) ; le traité sur l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (27 janv. 1967) ; le traité sur la dénucléarisation des fonds marins (11 févr. 1971). Ils illustrent clairement la différence entre désarmement et maîtrise des armements puisqu'ils ne prohibent que des utilisations virtuelles, non des utilisations actuelles. Le transit de fusées porteuses d'armes dans l'espace, la mise sur orbite des satellites d'observation, le stationnement de sous-marins lanceurs sur le fond des mers ne sont pas interdits. Or ils constituent des éléments indispensables au maintien de la dissuasion nucléaire.
La limitation fonctionnelle consiste à renoncer à l'expérimentation, au développement ou à l'usage de certaines armes en elles-mêmes et non par rapport à un secteur géographique déterminé.
Les négociations et accords S.A.L.T. constituent l'essentiel de l'entreprise. Liés initialement au développement de réseaux antimissiles, ils se sont étendus à l'ensemble des instruments de la dissuasion, qu'ils ont pour but de rationaliser et de codifier. Un premier accord (S.A.L.T. I) a été conclu le 26 mai 1972 sur des points limités, et la discussion des S.A.L.T. II a rapidement commencé. Le traité S.A.L.T. II a été signé le 18 juin 1979, mais il ne fut pas ratifié, en liaison avec la dégradation générale des rapports américano-soviétiques. Après en avoir d'abord respecté les dispositions, les États-Unis ont déclaré en 1986 qu'ils ne seraient plus liés par les plafonds qu'il comportait. Ils les ont effectivement dépassés à partir de novembre 1986. Entre-temps, d'autres accords avaient été conclus, sur la prévention des guerres nucléaires (22 juin 1973), sur la limitation des essais nucléaires souterrains (3 juill. 1974), sur certains points touchant à la poursuite des S.A.L.T. (accords de Vladivostok, 24 nov. 1974)...
Les traités multilatéraux sont moins nombreux en ce domaine. On peut mentionner la convention sur la prohibition des armes biologiques et à toxines (10 avr. 1972) ou la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires (18 mai 1977). Mais le plus connu est le traité de Moscou sur l'interdiction partielle des essais nucléaires (25 juill. 1963). Largement ratifié, il concerne autant la non-prolifération que la limitation des armements stricto sensu.
L'ensemble de ces accords soulève le problème du contrôle. Mais autant la nature des interdictions que l'évolution technique ont simplifié et facilité celui-ci au moins durant cette période. Le contrôle est en théorie aisé, au moins pour les puissances mondiales, lorsque la limitation concerne des espaces libres, et l'utilisation de satellites de surveillance ou de sismographes permet de vérifier à distance, sans atteinte à la souveraineté territoriale, le respect des engagements. La question est beaucoup plus délicate lorsqu'ils concernent une course aux armements qualitative, en laboratoire.
La non-prolifération ensuite constitue le second aspect de la maîtrise des armements. La multiplication du nombre des puissances nucléaires ne peut qu'accroître les risques de conflit. Aussi est-il souhaitable que le plus grand nombre possible d'États renonce à se doter d'armes nucléaires. Divers traités le prévoient pour les puissances vaincues après la Seconde Guerre mondiale : traités de paix de 1947 pour l'Italie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, accords de Paris de 1954 pour la R.F.A. D'autres pays en ont pris l'initiative, comme les pays latino-américains avec le traité de Tlatelolco (14 févr. 1967, en vigueur État par État). Mais l'instrument essentiel, à vocation générale, est le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (T.N.P.). Il interdit aux pays nucléaires d'aider les non-nucléaires à le devenir, et prévoit que ceux-ci y renoncent. Un contrôle exercé par l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne est envisagé. Ce traité a d'abord connu un relatif succès, puis a fait l'objet d'une certaine contestation de la part des pays non nucléaires. L'explosion, le 18 mai 1974, d'une bombe indienne a montré la fragilité de l'entreprise. Le problème se pose donc en des termes nouveaux, compte tenu de l'expansion de l'énergie nucléaire civile comme de la vulgarisation de la technique des bombes atomiques. L'accord des puissances nucléaires sur la nécessité d'éviter la prolifération est acquis, mais les risques sont accrus par leur compétition commerciale, même s'ils cherchent à l'ordonner (Club de Londres). L'Inde a notamment bénéficié de l'assistance involontaire du Canada, fournisseur de centrales nucléaires à vocation pacifique. De son côté, le Pakistan a pu trouver assistance auprès de la Chine. Cuba, Israël, Inde et Pakistan ont refusé de signer le T.N.P.
Ainsi, l'arms control, contesté au nom de l'égalité, voit son efficacité également critiquée. La course aux armements n'a été que partiellement freinée, les négociations américano-soviétiques ont durablement marqué le pas, tant la méfiance et les résistances internes furent fortes. L'ampleur des armements conventionnels a été peu affectée par les négociations M.B.F.R. (Mutual Balanced Force Reduction) organisées de 1973 à 1989 entre les pays membres du pacte de Varsovie et les membres de l'O.T.A.N., moins la France. Les ventes d'armes restent largement encouragées par les pays producteurs. C'est dans ce contexte que la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur le désarmement a ouvert une nouvelle étape.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean François GUILHAUDIS : professeur à l'université Pierre-Mendès-France, Grenoble
- Serge SUR : professeur de droit public à l'université de Paris-II-Panthéon-Assas
Classification
Médias
Autres références
-
BEVAN ANEURIN (1897-1960)
- Écrit par Roland MARX
- 556 mots
- 1 média
L'un des plus importants chefs travaillistes britanniques entre 1930 et 1960, Aneurin Bevan fut l'un des plus fermes avocats d'une véritable socialisation de la Grande-Bretagne. Fils de mineur, il doit lui-même abandonner la mine, à cause d'une maladie des yeux. Adversaire virulent de la prudence...
-
BRZEZINSKI ZBIGNIEW (1928-2017)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 612 mots
- 1 média
Politologue américain, spécialiste des relations internationales des États-Unis, Zbigniew Brzezinski fut le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter de 1977 à 1981.
Zbigniew Kazimierz Brzezinski est né le 28 mars 1928 à Varsovie (Pologne). Son père, membre éminent du...
-
CLAUSEWITZ KARL VON (1780-1831)
- Écrit par André GLUCKSMAN
- 4 636 mots
...La nécessité de se référer à l'épreuve de force pour l'emporter sur l'adversaire détermine le « but militaire » de la guerre : désarmer l'ennemi. « Le désarmement est par définition le but proprement dit des opérations de guerre. » La volonté stratégique de désarmer l'adversaire est celle qui parle... -
CORÉE DU NORD
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Valérie GELÉZEAU et Jin-Mieung LI
- 8 978 mots
- 8 médias
...cela, Pyongyang adhère au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) le 12 décembre 1985. Cette affaire, connue depuis 1987, rebondit en 1991. Afin de dénucléariser la péninsule, le Sud accepta le retrait des armes nucléaires américaines, lequel s'est discrètement achevé le 18 décembre 1991. Le 31, les... - Afficher les 24 références
Voir aussi
- SDN (Société des nations)
- POLITIQUE ET STRATÉGIE NUCLÉAIRES
- DISSUASION NUCLÉAIRE
- ESSAIS NUCLÉAIRES
- ARMEMENTS CONTRÔLE DES
- ABM (Anti-Ballistic Missiles) TRAITÉ
- EUROPE, politique et économie
- ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (ADM)
- PACIFIQUE ÉQUILIBRE
- MINES ANTIPERSONNEL
- START (Strategic Arms Reduction Talks)
- PAIX, maintien de la paix et règlement des différends
- SALT (Strategic Arms Limitation Talks)
- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS
- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES
- TNP (Traité de non-prolifération)
- IDS (initiative de défense stratégique) ou SDI