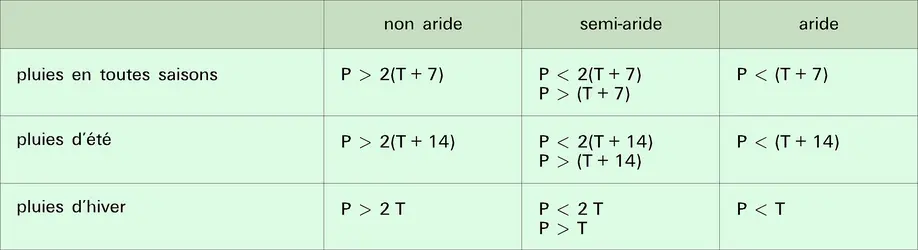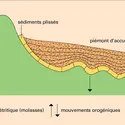DÉSERTS
Article modifié le
L'homme dans le désert
L'homme n'est pas adapté au désert : abandonné sans eau par une chaleur de 50 0C, il mourra en une journée ou deux ; même s'il bénéficie de trois litres d'eau par jour, il ne pourra survivre plus d'une semaine. Pourtant, toutes les grandes zones désertiques du globe sont peuplées par l'homme depuis la préhistoire. Les différences observées entre les populations du désert concernent surtout les techniques d'adaptation aux conditions climatiques. Il est certain qu'une peau fortement pigmentée donne une meilleure protection contre les rayons solaires ultraviolets, mais les individus à la peau légèrement pigmentée supportent bien la vie en pays chauds s'ils évitent une exposition trop directe au soleil. Le corps humain peut aussi effectuer quelques corrections physiologiques lors de son acclimatation : les glandes sudoripares diminuent leur sécrétion, les reins ralentissent la perte des sels ; mais aucun mécanisme ne peut réellement empêcher la perte de l'eau.
Les genres de vie
Les besoins en eau d'un homme travaillant dans le désert s'élèvent à neuf litres par jour, utilisés pour la cuisine et la boisson. La recherche continuelle de l'eau a obligé les habitants à vivre en nomades, mais leurs accoutumances particulières ont donné lieu à une certaine diversité de modes de vie. Les tribus les plus primitives pratiquent des formes anciennes de nomadisme : la chasse et la cueillette.
Ainsi les Bindibus errent nus, par petits groupes, à travers d'immenses régions dans le centre et l'ouest de l'Australie ; leurs déplacements dépendent des pluies ; ils ne possèdent presque pas d'outils et exploitent au jour le jour les maigres ressources du désert. Mais ce genre de vie ne peut être adopté que dans des régions assez giboyeuses ou relativement fertiles, et s'il fut jadis pratiqué au Sahara c'est que ce désert n'était pas aussi rigoureux qu'il l'est à présent. Les Boschimans, réfugiés dans le Kalahari après la colonisation européenne, se déplacent eux aussi par petites troupes partageant eau et nourriture, mais chaque troupe possède un territoire de chasse bien défini, où la raréfaction du gibier met leur existence même en danger. Parmi les tubercules qu'ils déterrent, celui du Bi est extrêmement recherché en raison de sa richesse en eau.
Les plantes sauvages continuent à tenir une place importante dans l'alimentation de nombreuses tribus du désert, mais la cueillette est laissée aux femmes, les hommes s'occupant surtout des troupeaux de chevaux, de chameaux, d'ânes, de lamas ou de yacks, suivant les régions. Le transport, la nourriture, le cuir et la laine leur sont ainsi assurés, de même que le commerce. Le nomade pasteur exploite les pâturages naturels et, ne constituant pas de réserve de fourrage, il devra effectuer les mêmes déplacements saisonniers que les animaux sauvages.
Les transports commerciaux occasionnent de grands déplacements, qui rassemblent en caravanes un grand nombre d'hommes et d'animaux. Le commerce caravanier saharien du sel, pratiqué par les Touaregs, est encore important, car l'Afrique occidentale manque de sel ; or, nous l'avons vu, les besoins en sel de tout être vivant en pays chaud sont considérables. C'est ainsi qu'au printemps et à l'automne, de grandes caravanes appelées azalaï (rassemblement de chameaux) se rendent aux salines du Sahara central pour échanger le mil contre le sel. Mais le commerce le plus largement diffusé à travers le désert saharo-sindien est longtemps resté celui des esclaves.
À toutes ces activités, élevage, négoce et caravane, les nomades ajoutent parfois la culture, mais dans des conditions très particulières. Ils peuvent posséder des palmiers dans une oasis qu'un métayer (autrefois un esclave) entretient à leur place. Certains même se servent de la charrue et sèment blé, orge ou pastèques quand les oueds ont coulé, mais il ne s'agit pas d'un travail régulier et ils peuvent rester plusieurs années sans semer.
De cette absence de véritable culture résulte l'absence de maison, mais les pasteurs nomades ne vivent pas dans l'état de dénuement des Bindibus et des Boschimans. Leurs vêtements et leurs tentes, de types différents suivant les groupes ethniques, les protègent des facteurs climatiques.
Le rôle devenu plus important des frontières, la « pacification » des tribus guerrières et la concurrence des camions ont beaucoup contribué à la sédentarisation des nomades, qui reste cependant un phénomène assez lent ; toutefois, elle peut croître brusquement dans les zones périphériques de steppe à l'occasion d'une crise économique ou d'une modification du système d'élevage. Pour beaucoup de nomades, humiliés dans leur orgueil de classe et, dans l'ensemble, appauvris, l'abandon de la vie pastorale s'accompagne d'un chômage total. Mais certains, en se fixant dans les oasis, s'initient très rapidement à la culture et apprennent l'irrigation. Ceux-là comprennent que seule la vie sédentaire permettra à leurs enfants de s'instruire.
Mise en valeur
On ne peut plus nier, actuellement, le rôle direct de l'homme dans la formation de certains déserts. La culture intensive et le déboisement exposent le sol à l'érosion. Quand la productivité des terrains plats, puis des pentes, est détruite, l'homme remplace la culture par l'élevage du gros bétail. Puis les bergers nomades, avec leurs chèvres et leurs moutons, achèvent la dégradation d'une région qui fut fertile. C'est ainsi que le Néguev, négligé pendant douze siècles, devint un désert. Dans les régions semi-arides, dernières étapes dans le processus de dégradation progressive avant la destruction totale de la végétation et de la couche de terre fertile, l'utilisation extrêmement extensive du milieu correspond très bien à sa pauvreté. Mais les gouvernements sont amenés à intervenir dans cette utilisation primaire lors des plans de mise, ou de remise en valeur de certaines contrées déshéritées, car, pour reconstituer la couverture végétale, il faut avant tout la protéger contre les troupeaux.
L'irrigation joue un rôle essentiel dans toute mise en valeur de régions arides. Un des exemples les plus spectaculaires de la transformation d'un pays désertique grâce à l'irrigation reste l'Imperial Valley dans le désert de Sonora, aux États-Unis, où l'eau du Colorado a été détournée. Dans ce paradis de l'agriculture, la richesse du sol en minéraux et un ensoleillement permanent s'ajoutent à l'irrigation pour fournir des rendements remarquablement élevés. Là où la culture est rendue possible, il faut acclimater toutes sortes de végétaux et les essais pratiqués portent sur 65 000 variétés. La luzerne (Medicago sativa), plante fourragère, a rencontré un grand succès dans de nombreuses régions nouvellement irriguées, avant d'être remplacée par du coton en raison des possibilités de vente de ce produit. Mais il ne faut jamais perdre de vue la fragilité des sols désertiques, dont l'érosion peut être accélérée par la culture de plantes qui ne leur sont pas adaptées.
Dans certaines régions, la mise en valeur à l'aide de barrages vient s'ajouter à l'exploitation par des moyens traditionnels. En Égypte, les grands barrages, comme celui d'Assouan, ont permis d'obtenir une troisième récolte. Dans le nord-est de l'Inde, les barrages ont amélioré l'exploitation de contrées déjà irriguées par un système de canaux très anciens ; ils ont aussi permis la mise en culture de nouvelles terres (7 600 km2 dans la vallée de Ihélam grâce à 6 090 km de canaux). Mais l'irrigation d'un désert est un travail délicat, car il faut prévoir les crues et le drainage des eaux en aval. En Irak, de telles prévisions ayant été négligées, l'eau, en stagnant et en s'évaporant, a abandonné ses sels minéraux qui ont stérilisé le sol.
L'utilisation, pour l'irrigation, des nappes d' eau souterraine se pratique depuis des siècles. Au Sahara, le pompage se faisait au moyen de foggaras, galeries souterraines conduisant l'eau de la nappe vers la surface à irriguer, éloignée parfois de plusieurs kilomètres et située à un niveau inférieur. Sur la côte pacifique du Pérou, les Indiens, qui avaient construit des centaines de kilomètres de canaux pour amener l'eau de la cordillère des Andes, savaient aussi exploiter les ressources d'eau souterraine. Le creusement de puits artésiens est à la base de la mise en valeur moderne de beaucoup de régions désertiques (culture commerciale du palmier au Sahara). Mais le creusement inconsidéré de nouveaux puits a entraîné une série de désastres : en Algérie, autrefois, l'oasis de Ghaman a été ruinée par le forage de Sidi Rached, qui fut asséché par le développement de Tamema, lequel dépérit à son tour au profit de Sidi Amram. En effet, les nappes d'eau souterraine s'épuisent sans pouvoir se renouveler, et, quand les plans de mise en valeur sont basés uniquement sur le forage de puits, l'exploitation ne peut être envisagée que pour une courte durée. On peut se demander si cette forme d'exploitation peut être considérée comme un progrès pour l'agriculture.
La seule source d'eau inépuisable est l'Océan. Dans les pays du Golfe, la mise en valeur des déserts fait des progrès considérables. En effet, beaucoup de déserts sont littoraux, comme ceux d'Arabie, du Chili et du Pérou où il faut paradoxalement amener l'eau depuis le versant continental des Andes alors que la mer est toute proche.
Des expériences entreprises depuis plusieurs décennies, notamment en Israël, ont montré qu'il était possible d'utiliser des eaux salées, ou saumâtres (de 10 à 13 grammes par litre), pour l'irrigation de certaines cultures ; ne s'y prêtent, toutefois, que des sols sableux, dont la texture, à l'inverse de celle des sols argileux, s'oppose à la fixation des sels dissous et permet leur lessivage rapide.
Le problème de l'énergie électrique dans les régions arides est également très important, car elle est nécessaire au pompage de l'eau et aux travaux agricoles ou domestiques. Celui du combustible est toujours aigu dans ces régions malgré la faible densité de la population ; les branches mortes de Prosopis, enfouies dans le sable, fournissent un bois de chauffage très apprécié. Mais la transformation en bois de chauffage des arbres et arbustes représente un véritable danger pour la végétation ; pour cette raison, les derniers acacias du Hoggar et du Tassili-n-Ajjer périssent sous la hache des nomades. L'énergie éolienne, utilisée directement ou transformée en électricité, a déjà permis de réduire le travail des animaux, dont l'entretien nécessite des cultures fourragères qui ont pu être remplacées par des cultures alimentaires. L'énergie solaire progresse régulièrement dans ses applications domestiques, notamment pour le pompage de l'eau.
Une des grandes richesses du désert reste celle des gisements miniers : argent dans le nord du Mexique, cuivre dans le Nevada, diamants en Afrique du Sud, fer dans le Sahara. Dans certains bassins désertiques, des minéraux enfouis sous forme de composés solubles, comme le sel, le gypse, le borax, les nitrates et les phosphates, représentent une valeur minière importante. C'est le pétrole qui a provoqué l'installation des communautés les plus récentes dans les régions arides et en particulier au Moyen-Orient et en Arabie. Des villes se sont créées, qui contrastent avec les vieilles cités arabes, et aux manœuvres indigènes sont venus se joindre les ouvriers spécialisés d'autres pays.
Si l'homme peut s'enrichir dans le désert, il n'a pas le droit d'oublier, à une époque où la population du globe s'accroît « dangereusement », quelle perte de ressources alimentaires pour l'espèce humaine représentent les surfaces dénudées des régions arides. Même dans nos pays au climat tempéré, l'homme ne devrait pas arracher un seul arbre sans envisager l'avenir et se demander s'il ne contribue pas ainsi à accélérer le processus irréversible qu'est la désertification.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Roger COQUE : professeur des Universités, professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
- François DURAND-DASTÈS : professeur à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot
- Huguette GENEST : Muséum national d'histoire naturelle
- Francis PETTER : docteur vétérinaire, docteur ès sciences, sous-directeur au Muséum national d'histoire naturelle
Classification
Médias
Autres références
-
ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations continentales
- Écrit par Roger COQUE
- 5 057 mots
- 12 médias
...dunes, formes d'accumulation éolienne très répandues sur les continents. Leur épanouissement le long des côtes basses et, surtout, dans les déserts tient aux conditions particulièrement favorables offertes à leur activité. On signalera, d'abord, l'importance des volumes de sable disponibles... -
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 24 463 mots
- 27 médias
Lesdéserts africains évoquent des espaces vides, minéraux, inhabités mais en réalité l'absence d'occupation humaine n'est ni totale ni spécifique des milieux arides. Sauf dans quelques secteurs hyperarides (désert de Libye, Tanezrouft), la végétation n'est pas totalement absente,... -
AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD
- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN
- 29 789 mots
- 28 médias
...m), le moyen Veld (entre 600 et 1 200 m) et le bas Veld (inférieur à 600 m). Ces plateaux, de plus en plus secs et de moins en moins élevés vers l'ouest, s'abaissent jusqu'au bassin désertique du Kalahari et le sud du désert du Namib, via les vastes étendues du Grand Karoo. Partout la couverture... -
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN
- 41 845 mots
- 25 médias
...sud-atlasique, daté du Villafranchien, fracture cet ensemble dans sa partie sud et marque la limite méridionale du domaine atlasique. Au-delà commence l'immensité du désert, composé d'unités généralement peu élevées mais très diversifiées : Hammada du Guir, piedmonts encroûtés interrompus au centre par le plateau... - Afficher les 53 références
Voir aussi
- ACACIA
- NAPPE PHRÉATIQUE
- ÉVAPORATION, hydrologie
- ÉVAPOTRANSPIRATION
- SÉCHERESSE
- IRRIGATION
- ESTIVATION
- CHÉNOPODIACÉES
- RONGEURS ou SIMPLICIDENTÉS
- GÉOPHYTE
- EAU, écophysiologie
- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie
- EAUX SOUTERRAINES
- OUED
- GENRE DE VIE
- PIÉMONT, géomorphologie
- REGS
- THERMOCLASTIE
- SHEET-WASH
- RILL-WASH
- SHEET-FLOOD
- RUISSELLEMENT
- PÉDIMENT
- PÉDIPLAINE
- SEBKHA
- TAKYR
- YARDANG
- SIF, plur. SIOUF
- SABLE
- BIO-RHEXISTASIE
- GLACIS, géomorphologie
- HAMADAS
- GARA, plur. GOUR, géomorphologie
- INSELBERG
- MORPHOGÉNIQUES SYSTÈMES
- GHOURD
- LUNETTE, géomorphologie
- GARAA
- ERG, géomorphologie
- CORRASION
- DUNES
- BARKHANE
- ARIDE DOMAINE
- CLIMATS
- ENDORÉISME
- BUTTE TÉMOIN
- ALIZÉS
- DÉSERTS VIE DANS LES
- ÉROSION & SÉDIMENTATION ÉOLIENNES
- FAUNE
- ORYX
- DROMADAIRE
- HYDRIQUE ÉQUILIBRE
- VÉGÉTALE BIOLOGIE
- BIOMES
- BINDIBUS
- FLORE
- HALITE
- CROÛTES SOLS À
- ADDAX
- SALSODISOLS ou SOLS SALSODIQUES ou SOLS HALOMORPHES
- HIVER
- CARAVANES
- PLUVIAUX & INTERPLUVIAUX
- BUISSON
- AFRIQUE, géographie
- ADAPTATION BIOLOGIQUE
- ÉCOPHYSIOLOGIE
- ANTHROPISATION
- CACTUS
- ÉPHÉMÉROPHYTES
- DÉSERTIFICATION