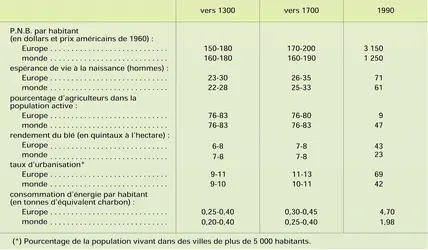DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Histoire
Article modifié le
Développement et sous-développement des Tiers Mondes
Nous l'avons signalé, le terme de développement est relativement récent. Son emploi résulte des travaux des Nations unies sur le sous-développement. Cette organisation a renoncé à l'expression de pays sous-développés pour adopter celle de pays en voie de développement (developing countries). En réalité, le sous-développement recouvre une situation contrastée au point qu'il faut parler non plus du Tiers Monde, mais des Tiers Mondes.
Pour les Nations unies, il s'agit de l'Afrique, moins l'Afrique du Sud, de l'Amérique, à l'exception des États-Unis et du Canada, de l'Océanie, moins l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de l'Asie, à l'exception du Japon, et du Moyen-Orient, sauf Israël. Les seuls pays d'Europe qui appartiennent aux pays « en voie de développement » sont, d'après cette classification, les composantes de l'ancienne Yougoslavie et la Turquie. La catégorie définie par les Nations unies est trop disparate pour permettre l'analyse. L'émergence de la Chine, de l'Inde et dans une moindre mesure celle du Brésil, au début des années 2000, tout en laissant subsister de très grands écarts de revenu en leur sein, renforce un peu plus encore cette disparité.
De manière plus précise, la Banque mondiale distingue les pays à faible revenu (dont le R.N.B. par habitant est inférieur à 905 dollars en 2006) de ceux à faible revenu intermédiaire (dont le R.N.B. par habitant est compris entre 906 et 3 595 dollars), ceux à haut revenu intermédiaire (dont le R.N.B. par habitant est compris entre 3 596 et 11 115 dollars), et enfin ceux à haut revenu (11 116 dollars et plus). Le premier groupe comprend tous les pays d'Afrique noire, sauf l'Angola, le Cap-Vert, Djibouti, le Lesotho, la Namibie, le Gabon, le Congo et le Cameroun. Il comprend également les grands pays d'Asie, à l'exception notamment du Japon, de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Thaïlande, de la Corée du Sud et la Chine. Les pays d'Amérique latine n'y figurent plus, hormis Haïti. Ce groupe ne comprend aucun pays d'Europe ni du Moyen-Orient. Au total, il englobe cinquante-trois pays et plus de 3 milliards d'habitants. Les deux catégories de pays à revenu intermédiaire comprennent le Maghreb, les autres pays d'Afrique noire, le Moyen-Orient, sauf les émirats pétroliers, le reste de l'Asie et la presque totalité de l'Amérique latine, l'Europe centrale et orientale. Elles représentent plus de 1 milliard d'habitants. Les pays les moins riches de cette catégorie ont un revenu en moyenne cinq fois supérieur à celui des pays du premier groupe.
On a donc assisté, au cours des vingt dernières années, à l'éclatement de l'entité constituée par le Tiers Monde, au point d'ailleurs que la notion soit de moins en moins usitée. S'il existe bien grossièrement une fracture économique entre le Nord et le Sud, entre les zones tempérées et les autres régions, le groupe des pays sous-développés est devenu composite avec, en moyenne, un recul économique de l'Afrique, une stagnation en Amérique latine et une forte progression en Asie qui laisse toutefois subsister de larges poches de pauvreté.
Révolutions manquées
Un point frappe l'observateur. Les derniers grands pays à être entrés dans le train du développement de la première moitié du xxe siècle sont le Japon et la Russie, avant la Première Guerre mondiale. Pourquoi l'Argentine et le Brésil, d'une part, l'Inde et la Chine, d'autre part, n'ont-ils suivi le mouvement qu'avec plusieurs décennies de retard ? Nous avons noté l'obstacle de la colonisation. Il faut y ajouter des difficultés que n'ont pas connues, en leur temps, les pays européens.
En premier lieu, il convient de citer le facteur climatique. La carte des pays riches se superpose à celle des régions tempérées. Les techniques agricoles mises au point en Angleterre au xviiie siècle n'étaient pas transposables sous d'autres climats. Ce handicap est renforcé par la densité du peuplement. Pour les pays d'Asie, la densité de la population dans les campagnes était très supérieure, au début du siècle, à celle qui prévalait dans les campagnes européennes au moment de la révolution industrielle : environ 3 habitants à l'hectare dans les premiers, contre 1,5 en Angleterre. Or, l'un des facteurs de la révolution agricole a été l'application sur des terres peu peuplées d'innovations mises au point en Hollande. La rentabilité de ces innovations était liée à la taille des exploitations. L'argument de la différence des densités de peuplement doit certes être nuancé par la différence des cultures : riz d'un côté, blé, avoine, orge, seigle de l'autre. Mais la différence entre les cultures renforce la difficulté d'une diffusion du progrès technique agricole. L'avènement de la révolution verte, dans les années 1960, a prouvé a contrario la nécessité de recherches entièrement nouvelles adaptées aux conditions géographiques et sociales de l'Asie.
Un deuxième obstacle au développement, à partir du début du xxe siècle, tient au contraste technologique et éducatif. Alors que la révolution industrielle a été marquée par des innovations empiriques et réalisée par une main-d'œuvre sans qualification, les contraintes sont différentes à partir des années 1900. La mise au point d'un outil industriel exige une formation préalable des individus et, par conséquent, un investissement éducatif beaucoup plus important. L'Allemagne avait montré l'exemple en mettant sur pied un système d'enseignement technique dès la seconde moitié du xixe siècle. Mais un tel investissement était hors de portée de pays colonisés dont les ressources restaient soit insuffisantes, soit exportées vers les métropoles.
Un obstacle supplémentaire, déjà mentionné, a barré la route du développement aux grands pays à partir du début du xxe siècle : la faiblesse des coûts de transport et des protections douanières, qui donne une véritable prime à l'exportation de produits de base et à l'importation de produits manufacturés. À cet égard, le Japon est l'exception qui confirme la règle. Son isolement géographique et son indépendance politique lui ont permis, malgré la faiblesse de sa protection douanière, de rester à l'abri des entrées de produits manufacturés, ce qui ne fut pas le cas de la Chine et de l'Inde avant que ces deux pays ne parviennent à faire leur insertion dans le commerce mondial au début des années 2000.
Un dernier élément va renforcer le retard du développement de certaines colonies. Il s'agit de la crise de 1929, qui provoque la dépression économique dans les métropoles et réduit subitement les débouchés des cultures d'exportation et des matières premières extraites dans les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.
La fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par un grand optimisme sur la capacité des régions du Sud à amorcer un processus de développement. Les experts de la Société des Nations écrivent en 1943 : « Il se peut que, après la guerre, étant donné l'expansion des industries mécaniques et la simplification des procédés de fabrication, le développement industriel des régions retardataires soit si rapide qu'il rende extrêmement difficile et pénible l'adaptation des autres pays à de nouvelles conditions de concurrence. » Le développement devient un enjeu politique entre les pays socialistes et les pays occidentaux. Sous l'impulsion des États-Unis sont mis en œuvre des programmes qui apportent une aide financière pour le financement du capital dans les pays sous-développés. Dans la logique des modèles de croissance, qui dominent alors la théorie économique en Occident, l'accent est mis sur le rôle de l'investissement. Le problème essentiel du développement est conçu comme celui d'une « accumulation primitive », qui permettrait d'atteindre un niveau de production comparable à celui des pays occidentaux les moins développés et susciterait les débouchés nécessaires à la révolution industrielle. Les pionniers de ce courant de pensée sont P. Rosenstein-Rodan, R. Nurkse, W. Rostow et A. Lewis.
Un autre courant, animé par R. Prebisch, F. Perroux, G. Myrdal et A. O. Hirschman, met au contraire l'accent sur la spécificité des problèmes de développement qui se posent dans les régions du Sud. Celles-ci sont marquées par le dualisme d'un secteur traditionnel et d'un secteur moderne tourné vers l'extérieur, et par la dépendance. R. Prebisch note, en particulier, la détérioration des termes de l'échange (rapport du prix des exportations au prix des importations) qui frappe les pays du Tiers Monde de 1952 à 1962 et met en doute l'efficacité d'une aide financière des pays riches dans un tel contexte. Apparaît alors le slogan trade but not aid, qui vise à convaincre les pays donateurs d'ouvrir leurs marchés et de stabiliser les prix des matières premières. En 1962 fut décidée la création du premier organisme intégré aux Nations unies et dont la finalité est le développement du Tiers Monde par l'amélioration des rapports économiques internationaux : la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D.). Son action est complétée, à partir de 1965, par celle du Programme des Nations unies pour le développement (P.N.U.D.).
La possibilité d'un véritable décollage économique dans le cadre du libre-échange et de la domination des sociétés occidentales fut remise en cause par le courant tiers-mondiste. Celui-ci allait énoncer la thèse d'une exploitation des pays pauvres par le commerce international (A. Emmanuel, L'Échange inégal) et attribuer le sous-développement des pays colonisés à la dépendance. Ses auteurs principaux (S. Amin, G. Frank) préconisent la rupture avec le marché mondial et avec le capitalisme. Leurs idées trouvent un écho au cours des années soixante dans les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance politique. Un certain nombre d'entre eux cherchent à mettre en œuvre un développement autocentré sur le mode soviétique, c'est-à-dire fondé sur la rupture des relations économiques avec l'Occident et l'alliance avec les pays socialistes. Les plus radicaux cherchent une confrontation avec les pays riches. L'accord de Téhéran (février 1971) sur l'augmentation du prix du pétrole brut, les coups de force de l'O.P.E.P. sont pour eux des exemples qui devraient être étendus à l'ensemble des marchés de matières premières.
La réalité infirmera cruellement leurs prévisions, puisque le quadruplement du prix du pétrole entre 1973 et 1980 va aggraver les difficultés des pays sous-développés non exportateurs de pétrole et accentuer l'éclatement du Tiers Monde. Au même moment, l'économie du développement voit la renaissance d'un courant libéral. Celui-ci critique les théories de la domination. Ses principaux auteurs (B. Balassa, P. Bauer, I. Little) considèrent que le sous-développement a des causes purement internes. En accord avec leurs idées, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international suscitent, dans les années 1980, la mise en œuvre de programmes de privatisation, de libéralisation et d'ouverture des pays sous-développés au marché mondial.
Quelques années plus tard, ces plans dits d'ajustement structurels seront tenus en partie pour responsables des crises traversées à la fin des années 1990 par les pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Le fameux consensus de Washington (recommandant ces politiques d'ouverture et de libéralisation économique et financière) accouchera d'une véritable crise de légitimité pour les institutions jumelles de Bretton Woods.
Les objectifs que se sont fixés les États membres des Nations unies en 2000 lors du sommet du Millénaire sont censés engager le monde sous de meilleurs auspices. Il s'agit, entre autres, de réduire de moitié l'extrême pauvreté, d'assurer l'éducation primaire pour tous et de combattre le sida.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Jacques FRIBOULET : professeur d'économie à l'université de Fribourg (Suisse)
Classification
Médias
Autres références
-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, notion de
- Écrit par Emmanuelle BÉNICOURT
- 1 649 mots
La notion de développement économique a pris de l'importance au tournant de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de nouvelles nations issues de la décolonisation et la mise en place d'institutions multilatérales, comme l'O.N.U. et ses agences, le Fonds monétaire international...
-
ACEMOĞLU DARON (1967- )
- Écrit par Olivier MARTY
- 1 148 mots
- 1 média
C’est toutefois dans le champ de l’étude dudéveloppement qu’Acemoğlu sera le plus reconnu. Dans un article de 2001 coécrit avec Simon Johnson et James Robinson, il établit un lien entre la qualité des institutions et la prospérité à long terme des nations. L’étude défend l’idée que les institutions... -
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 24 463 mots
- 27 médias
L’Afrique présente une grande diversité humaine et des niveaux dedéveloppement économique très inégaux. La diversité socio-économique du continent reflète, en premier lieu, celle des écosystèmes. Les sociétés rurales, encore très proches de la nature, vivent en symbiose avec des milieux... -
AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle
- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART
- 9 999 mots
- 2 médias
...hydraulique, à passer à deux, trois ou même quatre récoltes par an. La productivité de la terre (production à l'hectare) a ainsi été décuplée en certains lieux. Les techniques de la révolution verte étant intensives en travail, les emplois et les revenus agricoles ont beaucoup augmenté, créant un pouvoir d'achat... -
AMÉRIQUE LATINE, économie et société
- Écrit par Jacques BRASSEUL
- 13 727 mots
- 22 médias
...comme Douglass North (Prix Nobel en 1993) d'expliquer l'évolution divergente de l'Amérique latine et de l'Amérique anglo-saxonne depuis leur découverte. Pourquoi ces deux parties du continent qui ont une histoire proche, découvertes et peuplées par des Européens à partir de 1492, sont-elles si différentes,... - Afficher les 82 références
Voir aussi
- TIERS MONDE
- EUROPE, histoire
- ÉCONOMIE DE MARCHÉ
- DOUANIÈRE POLITIQUE
- AJUSTEMENT STRUCTUREL
- PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB)
- INDICATEUR, économie
- NIVEAU DE VIE
- DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
- MANUFACTURIÈRE PRODUCTION
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- AFRIQUE, économie
- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)
- RÉVOLUTION VERTE
- SOUS-DÉVELOPPEMENT
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- INDE, histoire : l'époque coloniale
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION & LE DÉVELOPPEMENT (BIRD)
- EXPORTATIONS
- AIDE ÉCONOMIQUE
- URBANISATION
- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU
- NORD-SUD RELATIONS
- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- HISTOIRE ÉCONOMIQUE
- PROGRÈS ÉCONOMIQUE
- INNOVATION TECHNOLOGIQUE