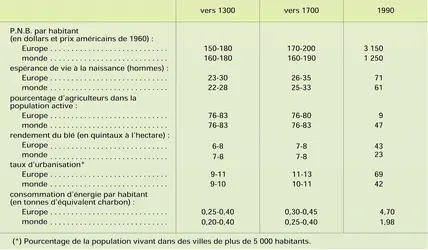DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Histoire
Article modifié le
Les perspectives du développement
La disparité des résultats économiques est grande au sein des régions du monde en développement. Pour l'ensemble de l'Asie, et à l'exception des régions ravagées par les conflits armés, les bases du développement construites dans les 1950-1960 ont résisté aux chocs conjoncturels des années 1970-1980. La plupart des pays d'Asie ont connu, à partir des années 1990, un véritable développement et, pour certains, un rattrapage de leur retard par rapport aux pays développés. La Chine se situe depuis le milieu des années 2000 au 6e rang mondial en termes de P.I.B., au 5e rang mondial en termes d'exportations, au 4e rang mondial en termes de publications scientifiques... Le bilan est plus contrasté en Amérique latine, où des pays comme le Mexique, le Chili ou la Bolivie semblent avoir surmonté les difficultés des années 1970 sans remettre en cause les fondements de leur expansion économique, alors que d'autres, comme le Pérou ou Haïti, paraissent sombrer dans une profonde crise politique et économique. Mais l'ensemble de l'Amérique latine est confronté à la juxtaposition de l'extrême pauvreté et de l'extrême richesse. Pour l'Afrique, le bilan est dans l'ensemble négatif. Les espoirs nés de l'indépendance n'ont pas été confirmés, et les années 1980 ont été considérées, de ce point de vue, comme une décennie perdue. Les perspectives sont d'autant plus sombres que le continent est confronté à l'épidémie de sida, qui a atteint la population d'Afrique noire dans sa force de travail et laisse démunis les enfants et les vieillards.
Au vu de ce bilan, quelles sont les voies du développement ? Mais, d'abord, existe-t-il une issue autre que le développement ? Au vu des dégâts causés à la nature par le processus de révolution industrielle et des bouleversements qu'il provoque dans les structures économiques et sociales, ne vaut-il pas mieux renoncer à l'accumulation de la richesse sociale ? Formulée, au début des années 1970 par le Club de Rome, la question semble prendre en compte les préoccupations écologiques. Mais une bonne connaissance des réalités des pays en développement impose une réponse négative. La rupture d'équilibre introduite par l'explosion démographique dans les sociétés traditionnelles fait du développement économique une nécessité vitale pour les pays pauvres. D'abord pour sortir de la révolution démographique et en assumer les conséquences. Sans développement, l'inflation urbaine continuera, démunie des ressources financières qui permettraient de corriger ses conséquences négatives : chômage, hypertrophie de l'économie souterraine, qui peut représenter jusqu'à 50 p. 100 des activités, criminalité, pollution, bidonvilles. Au-delà de 500 000 habitants, les avantages économiques d'une plus grande taille des villes disparaissent. Or, les villes les plus peuplées du monde sont pour les deux tiers d'entre elles celles des pays en développement : 22 millions d'habitants à Mexico, 19 millions à São Paulo, 18 millions à Djakarta, 17 millions à Delhi..... Sans développement, il ne sera pas possible de payer les dépenses de formation pour les jeunes, qui constituent plus d'un tiers de la population des pays pauvres. Sans développement, ces pays n'arriveront pas à nourrir et à soigner la population, l'aide des pays occidentaux ne pouvant être sur ce sujet que secondaire.
Quelles sont alors les voies du développement ? Les spécialistes semblent d'accord sur cinq priorités. Première priorité : l'agriculture. Comme le montre l'exemple de l'Asie, la réussite de l'industrialisation dépend du niveau de vie des populations rurales. Le développement de l'agriculture vivrière est crucial, non seulement parce que celle-ci doit fournir l'alimentation et les revenus nécessaires à l'investissement, mais parce qu'il évite un surcroît de chômage et une trop grande dépendance par rapport aux pays développés.
La deuxième priorité est le freinage démographique. Plus que des campagnes de sensibilisation, l'amélioration du niveau de vie et l'éducation des femmes sont les conditions d'un résultat dans ce domaine.
La troisième priorité est l'investissement humain. Celui-ci se heurte au monopole des pays développés sur la technologie et sur la recherche fondamentale. Un tel monopole provoque l'exode des cerveaux des pays pauvres. Mais l'exode n'est pas inévitable, comme le montre l'exemple de l'Inde, qui abrite aujourd'hui des centres de recherche avancés. Encore faut-il qu'il ne soit pas favorisé, du côté des pays riches, par une politique de « chasseur de têtes » et, du côté des pays pauvres, par des restrictions budgétaires ou des gaspillages qui interdisent tout investissement éducatif.
La quatrième priorité est la réforme de l'État. Toute l'histoire du développement prouve l'exigence d'une stratégie cohérente mise en œuvre par un État ayant l'appui de la population. Ce fut le cas du Japon sous la révolution Meiji au xixe siècle. Au xxe siècle, il faut citer l'exemple de la Corée du Sud, qui a certes bénéficié de l'aide américaine, mais a également su choisir un mode de développement adapté à ses ressources humaines et aux exigences de l'époque. Si l'histoire du développement a montré la supériorité de l'économie de marché sur la planification centralisée, elle a également révélé la nécessité d'une intervention de l'État qui doit créer non seulement le contexte institutionnel et juridique indispensable à l'économie de marché, mais aussi les instruments de politique budgétaire et monétaire favorables au développement. Comme le disait John Maynard Keynes dans La Fin du laissez-faire, « l'important, pour l'État, n'est pas de faire ce que les individus font déjà et de le faire un peu mieux ou un peu plus mal, mais de faire ce que personne d'autre ne fait pour le moment ». De ce point de vue, la stabilité politique et la cohésion sociale sont deux conditions du développement dont l'absence explique pour partie les difficultés de l'Afrique noire.
La dernière priorité est la rupture de l'isolement. Comme l'ont montré les pays asiatiques, le processus de développement ne peut se réaliser aujourd'hui à l'écart du marché mondial. Celui-ci apporte les innovations et les informations indispensables à la modernisation des techniques, et un marché d'appoint pour les produits manufacturés. Cependant, cette stratégie de développement doit être maîtrisée par les pays qui la conduisent ; à cet égard, les grands pays sous-développés ne peuvent éviter un certain protectionnisme, sauf à voir leurs consommateurs acheter massivement des produits importés, comme l'a illustré au début des années 1990 l'exemple des pays de l'ex-bloc communiste. Par ailleurs, si cette stratégie a fonctionné sans dommages collatéraux pour les pays développés quand elle a été menée par de petits pays, l'insertion de la Chine et de l'Inde dans le commerce mondial bouleverse les grands équilibres mondiaux.
Il ressort de cette analyse qu'il n'existe pas de modèle en matière de développement valable pour toutes les régions, quels que soient leur taille et leur niveau de revenu. Les pays en développement doivent nécessairement adapter les enseignements tirés des sciences sociales et des comparaisons internationales. Les échecs en la matière ont souvent pour origine l'inadaptation des politiques suivies aux réalités culturelles et humaines des régions considérées. On peut affirmer, de ce point de vue, que l'aide technique et financière des pays riches n'a pas été à la hauteur des enjeux. Elle a trop souvent favorisé l'imitation des modèles occidentaux plus que la mise en œuvre de recherches ou d'expériences, en agriculture notamment, correspondant aux besoins fondamentaux des pays pauvres. L'indépendance, conquise dans les textes, n'a pas encore forcément pénétré les esprits. Le développement ne peut résulter en fin de compte que du sens des responsabilités et de l'esprit d'initiative des élites dirigeantes des pays en développement. Même si la bonne volonté des pays développés se traduisait par une aide en rapport avec leur richesse réelle, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, l'aide ne peut être que subordonnée aux efforts des pays qui la perçoivent.
Nombre de pays en développement reprochent à juste titre aux pays occidentaux les modalités d'un système monétaire international qui les pénalise par les variations erratiques de change et de taux d'intérêt. Mais la corruption, le gaspillage, l'absence de stratégie, les « effets de démonstration » (imitation effects) qui font préférer la consommation à l'épargne sont autant de facteurs qui entravent le développement et qui sont de la responsabilité des pays considérés. À ce niveau, la question du développement n'est plus simplement économique. Elle devient politique et morale. Toute politique de développement suppose des choix privilégiant le devenir de la communauté au détriment de la satisfaction de certains intérêts particuliers.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Jacques FRIBOULET : professeur d'économie à l'université de Fribourg (Suisse)
Classification
Médias
Autres références
-
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, notion de
- Écrit par Emmanuelle BÉNICOURT
- 1 649 mots
La notion de développement économique a pris de l'importance au tournant de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de nouvelles nations issues de la décolonisation et la mise en place d'institutions multilatérales, comme l'O.N.U. et ses agences, le Fonds monétaire international...
-
ACEMOĞLU DARON (1967- )
- Écrit par Olivier MARTY
- 1 148 mots
- 1 média
C’est toutefois dans le champ de l’étude dudéveloppement qu’Acemoğlu sera le plus reconnu. Dans un article de 2001 coécrit avec Simon Johnson et James Robinson, il établit un lien entre la qualité des institutions et la prospérité à long terme des nations. L’étude défend l’idée que les institutions... -
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 24 463 mots
- 27 médias
L’Afrique présente une grande diversité humaine et des niveaux dedéveloppement économique très inégaux. La diversité socio-économique du continent reflète, en premier lieu, celle des écosystèmes. Les sociétés rurales, encore très proches de la nature, vivent en symbiose avec des milieux... -
AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle
- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART
- 9 999 mots
- 2 médias
...hydraulique, à passer à deux, trois ou même quatre récoltes par an. La productivité de la terre (production à l'hectare) a ainsi été décuplée en certains lieux. Les techniques de la révolution verte étant intensives en travail, les emplois et les revenus agricoles ont beaucoup augmenté, créant un pouvoir d'achat... -
AMÉRIQUE LATINE, économie et société
- Écrit par Jacques BRASSEUL
- 13 727 mots
- 22 médias
...comme Douglass North (Prix Nobel en 1993) d'expliquer l'évolution divergente de l'Amérique latine et de l'Amérique anglo-saxonne depuis leur découverte. Pourquoi ces deux parties du continent qui ont une histoire proche, découvertes et peuplées par des Européens à partir de 1492, sont-elles si différentes,... - Afficher les 82 références
Voir aussi
- TIERS MONDE
- EUROPE, histoire
- ÉCONOMIE DE MARCHÉ
- DOUANIÈRE POLITIQUE
- AJUSTEMENT STRUCTUREL
- PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB)
- INDICATEUR, économie
- NIVEAU DE VIE
- DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
- MANUFACTURIÈRE PRODUCTION
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- AFRIQUE, économie
- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)
- RÉVOLUTION VERTE
- SOUS-DÉVELOPPEMENT
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- INDE, histoire : l'époque coloniale
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION & LE DÉVELOPPEMENT (BIRD)
- EXPORTATIONS
- AIDE ÉCONOMIQUE
- URBANISATION
- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale
- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU
- NORD-SUD RELATIONS
- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- HISTOIRE ÉCONOMIQUE
- PROGRÈS ÉCONOMIQUE
- INNOVATION TECHNOLOGIQUE