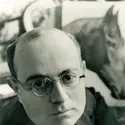DIALECTIQUE, notion de
Article modifié le
Une saisie de la réalité
Si la dialectique affirme dès lors sa singularité vis-à-vis de la logique, c'est surtout avec Georg Wilhelm Friedrich Hegel qu'elle prend son réel essor (Phénoménologie de l'esprit, 1807 ; Science de la logique, 1812). Hegel cherche à comprendre la réalité ; et il conçoit la dialectique comme le mouvement constitutif de cette réalité. Si Hegel s'attache à l'idée de « mouvement dialectique », c'est parce qu'il considère la dialectique comme une synthèse compréhensive des relations conflictuelles et contradictoires. La dialectique hégélienne recherche l'unité, la conciliation entre les opposés. Mais elle ne se réduit pas à la synthèse d'une conjonction disjonctive, qui formaliserait des catégories extrinsèques à la réalité étudiée. Le mouvement dialectique part de la réalité, opère en elle, en considérant ses changements ; il est son intelligibilité. La dialectique de Hegel rend compte d'une mise en relation de soi avec le monde et avec l'autre, qui permet de se déterminer soi-même dans un rapport réfléchi à eux ; elle est constitutive de la raison, qui s'accomplit dans la réalité ; elle est le mouvement du réel lui-même. La dialectique de Karl Marx se présente comme le « contraire direct » de celle de Hegel, ne s'attachant plus à découvrir l'idée ou le concept mais son devenir au sein même du réel.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher propose néanmoins, dans sa Dialectique (1836), une vision davantage tournée vers la construction d'une communauté, par un partage du discours grâce au langage. Il envisage la dialectique comme structure relationnelle du langage, qui permet un accès au savoir par l'activité philosophique. Un tel cheminement n'est possible que si la dialectique est envisagée dans un processus dialogique du savoir, qui repose sur la communication, c'est-à-dire sur un dialogue, où les échanges règlent les conflits, qui sont le point de départ du processus dialectique. La vérité recherchée initialement par l'application dialectique du langage se change alors en rationalité communicationnelle. La dialectique s'ouvre ainsi à un dialogue fécond, et plus particulièrement au dialogisme.
Si la dialectique est art du dialogue, elle peut effectivement être saisie dans un contexte communicationnel et requérir des modalités de co-construction d'arguments. La fondation de la raison, visée par la dialectique, peut engendrer une « raison communicationnelle », comme l'entend Jürgen Habermas dans sa Théorie de l'agir communicationnel (1981), et reposer sur une reconnaissance « entre nous », constituée en commun.
Développant cette construction duale, Francis Jacques fonde une théorie du dialogisme, qui revisite les fondements platoniciens de la dialectique et trouve sa source dans la compétence interrogative de chacun des interlocuteurs en présence. La construction du dialogue n'est plus ici au service de la vérité absolue, comme le préconise Platon dans le Plilèbe. Francis Jacques donne toute sa force à une interrogation qui procède avant tout d'un « nous » de réciprocité co-construit, féconde le dialogue et favorise l'innovation sémantique, comme il l'indique dans « Entre conflit et dialogue ? » (1988). Il prolonge ainsi la question de Platon concernant la plénitude du sens que la dialectique s'applique à trouver et précise que « l'idée d'une rationalité linguistique et communicationnelle a perdu la conviction d'un logos unique ». L'art du dialogue devient celui de co-référer pour créer du sens ensemble, en commun, en favorisant le passage de l'intersubjectivité à l'interlocution.
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marie GAUTIER : doctorat de philosophie et de communication, chargée d'enseignement de logique, pragmatique, philosophie de l'art, université de Paris-III et Institut catholique de Paris
Classification
Autres références
-
ABÉLARD PIERRE (1079-1142)
- Écrit par Jean JOLIVET
- 1 336 mots
- 1 média
L'œuvre conservée d'Abélard comprend essentiellement : a) deux séries de gloses sur les classiques dela dialectique connus à l'époque (Isagoge de Porphyre ; Catégories et Interprétation d'Aristote ; divers traités de Boèce), qui datent de la première partie de sa vie ; vers 1136,... -
ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)
- Écrit par Miguel ABENSOUR
- 7 899 mots
- 1 média
Ultérieurement, cette orientation de l'interprétation vers le matérialisme produira chez Adornol'idée de dialectique négative en tant que dialectique du non-identique. Seule en effet une dialectique matérialiste est de nature à rester fidèle à ce qui est sans intention, dans la mesure où, se... -
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
...Socrate historique, qui, comme on sait, n'a rien écrit. Il semble en tout cas que Socrate ait innové sur trois points : 1. Il met au point une méthode, la dialectique, qui, grâce à un jeu progressif de questions, démasque les faux savoirs de l'adversaire ; instrument de mise à l'épreuve et de critique, la... -
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
...d'éviter, quand nous soutenons un argument, de rien dire nous-mêmes qui y soit contraire » (I, 1, 100 a 18 sqq.). Cette méthode est ce qu'Aristote appelle la dialectique, parce qu'elle fixe les règles de la pensée dialoguée. À la différence du monologue rhétorique, celle-ci trouve dans la présence critique... - Afficher les 50 références
Voir aussi