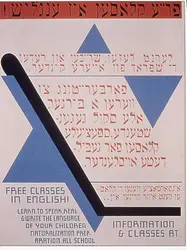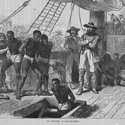DIASPORA
Article modifié le
Diaspora grecque
Le terme « Grecs » était donné par les Occidentaux depuis la fin du Moyen Âge aux adeptes du « rite grec » de l'Église orthodoxe. Ce terme s'appliquait surtout à la population citadine grécophone de la région égéenne qui ne cessait de fonder des communautés en Anatolie, en Afrique du Nord et en Italie. Ces Grecs émigrèrent en plus grand nombre à partir du xive et du xve siècle pour fuir le « joug ottoman » ; c'était, d'une part, une petit nombre de Grecs instruits qui s'enfuirent en Europe occidentale et en Russie au lendemain de la prise de Constantinople (1453) et, d'autre part, des tribus albanaises et maniotes (ou maïnotes) du Péloponnèse, compromises avec les Vénitiens dans leur lutte contre les Ottomans, qui partirent en Italie du Sud, en Sicile et en Corse (Cargèse). Le mouvement se poursuivit pendant les deux siècles suivants, avec la conquête par les Ottomans du Péloponnèse (xvie siècle), de Chypre (1571) et de la Crète (1669).
Les premières migrations eurent un caractère spécifique : des nobles, savants et militaires s'installèrent en Italie et dans d'autres pays d'Europe, répondant aux possibilités d'accueil qu'offraient, pour les uns, les cours des princes et le climat intellectuel de la Renaissance, pour les autres, les pratiques militaires de l'époque (stradiots) ; les établissements ruraux constituaient le débouché des migrations massives, telle celle des Maniotes en Corse, au xviie siècle, et dans les maremmes de Pise et de Sienne. Ces migrations ont été possibles grâce à la structure sociale des populations émigrées, qui permettait leur mobilisation massive, d'une part, et leur cohésion, de l'autre, dans le pays d'accueil. La composition des populations émigrées pour des motifs non économiques contraste avec celle des populations émigrées pour des raisons commerciales ; ainsi les registres paroissiaux de Venise au xvie siècle montrent que la colonie grecque de cette ville était composée, pour l'essentiel, de galeotti (sorte de galériens) et de marins. Naples, Livourne, Ancône et Trieste sont, avec Venise, les principaux points de la migration grecque en Italie : les colonies, dotées de privilèges, se livrent au commerce d'importation et d'exportation ainsi qu'à des opérations de banques et d'assurance maritime. Tandis que pendant les deux premiers siècles les émigrants provenaient surtout des possessions vénitiennes en Grèce, à partir du xviie siècle la migration résultant de l'activité commerciale touche les régions sous domination ottomane.
À cette époque, l'Église orthodoxe fit, avec l'assentiment du pouvoir ottoman, un grand effort de grécisation de tous les peuples des Balkans et d'Anatolie imprégnés de civilisation byzantine (Romania) et se donnant volontiers le nom de « Roméi » ou de « Romani » (Romains). Ainsi une grande masse de nouveaux Grecs, les Sarakatsans du Centre et du Sud balkaniques, renforça les anciens courants d'émigration des Grecs citadins et en créa de nouveaux, abandonnant rapidement le nom de Roméi pour adopter celui d'« Hellènes » (xviiie s.) et renforçant les restes de toutes les anciennes colonies grecques de la Méditerranée et de la mer Noire ; ils pénétrèrent dans les villes et bourgs propres au négoce jusqu'au-delà du Danube, puis s'installèrent dans les grandes villes de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale et suivirent les traces des colons occidentaux en Asie, en Afrique et aux Amériques. Des communautés grecques, dont l'origine ethnique (albanaise, sarakatsane, slave, moldo-valaque ou anatolienne) est difficile à discerner, sont établies dès la fin du xviiie siècle au Siam, aux Indes (Calcutta, Dacca, Bombay, Karachi...) et, dès le milieu du xviiie siècle, en Iran, en Mésopotamie, en Arabie, en Éthiopie, dans toutes les villes d'Égypte, au Soudan et ailleurs en Afrique. En 1767 commence l'émigration de Péloponnésiens et de Corses vers l'Amérique (Floride). La Russie profite de ce mouvement migratoire pour repeupler l'Ukraine et éliminer les nomades, alliés de l'empire ottoman. Une importante population grecque essentiellement albanophone, venant de Constantinople, de Smyrne et de toutes les grandes villes des Balkans et de l'Archipel, fit d'Odessa, fondée en 1794, le plus grand port de la mer Noire. Au xixe siècle, les mêmes albanophones, des Albanais d'Albanie et des Sarakatsans, aidèrent Mohamed Ali à faire d'Alexandrie un des grands ports de la Méditerranée.
Les colonies dans les centres commerciaux disposaient, pour la plupart, de privilèges accordés par les autorités ; elles avaient leur propre Église, sauf dans le cas de colonies rurales enclines à l'assimilation ; elles entretenaient, du fait de leur fonction commerciale, des liens avec leur pays d'origine : ces liens, renforcés par le sentiment d'appartenance à un univers religieux différent de celui du pays d'accueil, caractérisent la diaspora grecque dont le cosmopolitisme n'est pas total. Les Grecs ne viennent pas dans les pays étrangers en apportant des éléments culturels leur permettant l'assimilation, bien que celle-ci ait parfois eu lieu, par exemple en Hongrie. Attachés à leur pays, ils finissent souvent par y retourner et prennent toujours une part active aux manifestations organisées en sa faveur : financement de l'enseignement, des éditions, des œuvres de bienfaisance. Venise et Vienne fournissent l'essentiel des éditions grecques pendant la domination ottomane et sont, avec Budapest et Bucarest, les principaux centres de migration intellectuelle. L'acculturation, loin d'avoir entraîné l'assimilation, est devenue un élément de différenciation dans l'univers culturel dont les émigrants étaient tributaires et a joué un rôle de catalyseur dans le pays d'origine dont certains secteurs économiques et culturels étaient directement liés à la diaspora. Ces liens commerciaux et culturels ont en quelque sorte créé un univers grec qui dépasse les frontières du pays.
La fondation de l'État grec, en 1827, entraîna l'émigration vers l'Amérique de populations rurales grecques attachées à leur mode de vie tribal et refusant l'intégration forcée au nouveau pouvoir central. Tout au long du xixe siècle, le mythe de la fortune facilement amassée attira ces populations dont l'économie fermée était déséquilibrée par une économie marchande de plus en plus envahissante. Ainsi, à la veille des guerres balkaniques, il y avait, outre les 3 millions de Grecs de Grèce, 5 millions de Grecs (orthodoxes de rite grec) en Turquie balkanique et en Turquie anatolienne, 400 000 en Russie, 100 000 en Roumanie et en Bulgarie, 200 000 en Égypte et dans l'Afrique en général, et 200 000 en Amérique. Après la Première Guerre mondiale, l'échange de populations entre la Grèce et la Turquie (1922) entraîna une nouvelle vague d'émigrants, incapables de s'adapter aux conditions de vie en Grèce, en Europe occidentale (Paris, Marseille), en Égypte, au Brésil, en Australie, au Canada et aux États-Unis. Les communautés des États-Unis, notamment celles de New York, de Chicago, et de San Francisco, acquirent entre les deux guerres une force économique et un poids politique qui orientèrent considérablement la vie politique de la Grèce après la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la guerre civile (de 1945 à 1949), 12 000 réfugiés politiques grecs furent accueillis par les pays de l'Est (Tchécoslovaquie, Pologne, Allemagne de l'Est, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, U.R.S.S.).
À la fin des années 1950, l'émigration grecque changeait de direction et de nature. Une faible mécanisation de l'agriculture, la paupérisation des paysans, l'exode rural apportèrent sur le marché du travail une masse considérable de main-d'œuvre qui ne pouvait être absorbée ni par l'industrie grecque ni par les centres traditionnels d'émigration transatlantique. Ainsi, à partir de 1960, les Grecs émigrèrent vers les pays du Marché commun, Allemagne fédérale principalement. Depuis les années 1970, l'émigration a diminué et on assiste même à des retours au pays.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Spyros ASDRACHAS : chargé de conférences à l'École pratique des hautes études
- Vicken CHETERIAN
:
director of programmes , Cimera - Kamel DORAÏ : chercheur C.N.R.S., docteur en géographie, Institut français du Proche-Orient, Damas, Syrie, et Mingrinter, Poitiers, France
- Thibaut JAULIN : doctorant à l'université d'Aix-Marseille-III (sciences politiques)
- Claudine LOMBARD-SALMON : docteur ès lettres, chargée de recherche au C.N.R.S.
- Raoul VANEIGEM : écrivain
- Emmanuel ZAKHOS-PAPAZAKHARIOU : docteur de troisième cycle
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Média
Autres références
-
ANTHROPOLOGIE DES DIASPORAS
- Écrit par Anne-Christine TRÉMON
- 1 792 mots
L’anthropologie des diasporas a connu un développement considérable depuis les années 1990. Cet essor a été favorisé par l’extension sémantique du terme « diaspora », qui bien au-delà des diasporas paradigmatiques juive et arménienne, s’est progressivement appliqué aux descendants de populations noires...
-
DIASPORAS URBAINES
- Écrit par Anne-Christine TRÉMON
- 1 588 mots
- 1 média
Ce qui caractérise la ville – coprésence d’étrangers, effervescence de la vie sociale, intensité des relations avec d’autres localités – tient, entre autres, à la présence de diasporas.
Dès l’apparition des premières villes, des communautés de marchands forment des réseaux interconnectés...
-
ARMÉNIE
- Écrit par Jean-Pierre ALEM , Françoise ARDILLIER-CARRAS , Christophe CHICLET , Sirarpie DER NERSESSIAN , Encyclopædia Universalis , Kegham FENERDJIAN , Marguerite LEUWERS-HALADJIAN et Kegham TOROSSIAN
- 23 772 mots
- 13 médias
Sur environ 7 millions d'Arméniens, près de la moitié vit endiaspora. Survivants des massacres de 1894 et 1915, rescapés des guerres de 1917-1921, ils se sont fixés essentiellement au Moyen-Orient et en France. C'est au Moyen-Orient qu'ils ont conservé leur cohésion grâce à leurs institutions calquées... -
EXIL LITTÉRATURES DE L'
- Écrit par Albert BENSOUSSAN
- 3 314 mots
- 6 médias
Ladiaspora juive venue d'Orient situe son exil à une autre échelle, celle de l'identité : Albert Cohen, natif de Corfou, éduqué à Marseille, avocat à Genève, inventera pour le xxe siècle la métaphore absolue où les écrivains juifs de langue française se reconnaîtront, en installant... -
HISTOIRE ATLANTIQUE
- Écrit par Clément THIBAUD
- 3 729 mots
- 2 médias
Parallèlement,l'histoire atlantique s'est emparée du concept de diaspora, très utilisé dans les sciences humaines. Les historiens anglophones, comme Paul Gilroy (L'Atlantique noir, modernité et double conscience, 2003), soulignent l'importance des diasporas africaines dans la formation... -
IRAN - Géographie
- Écrit par Bernard HOURCADE
- 5 178 mots
- 5 médias
...économique chronique, la capitale est en effet la seule région du pays à avoir un embryon de culture internationale et une dynamique industrielle moderne. La diaspora iranienne joue un rôle incontestable, mais limité à une élite urbaine, pour compenser la faiblesse des relations culturelles internationales... - Afficher les 11 références
Voir aussi
- DIASPORA JUIVE
- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT
- MINORITÉS
- VENISE RÉPUBLIQUE DE
- JUDÉO-ROMAINE PREMIÈRE GUERRE (66-70)
- DIASPORA CHINOISE
- ASIE DU SUD-EST
- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES
- EXODE DE POPULATIONS
- PALESTINIENS
- COMMERCE, histoire
- ARMÉNIENS
- OLP (Organisation de libération de la Palestine)
- DIASPORA GRECQUE
- GRECQUES CONTEMPORAINES POPULATIONS
- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789
- CHRISTIANISME PRIMITIF
- ARMÉNIE RÉPUBLIQUE D'
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- ROME, l'Empire romain
- DACHNAK (Fédération révolutionnaire arménienne)
- HAUT-KARABAGH ou HAUT-KARABAKH