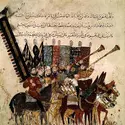DICTIONNAIRE
Article modifié le
Historique
En France, les débuts de la lexicographie ont devancé de plusieurs siècles les premiers dictionnaires monolingues français. En Europe occidentale, ce long parcours est jalonné d'échanges entre les premiers répertoires de langues anciennes, du latin en particulier. Ainsi s'est constitué un important patrimoine de savoirs communs qui a permis aux dictionnaires de devenir, avant le xviie siècle, un champ privilégié d'expériences internationales.
Dès les vie et viie siècles se développent les gloses, marginales ou interlinéaires, portées sur les manuscrits pour expliciter, en latin plus simple ou en langue vernaculaire, les mots difficiles ou rares. Réunies en listes approximativement alphabétisées, présentées à la suite ou indépendamment du texte source, elles constitueront des glossaires, tel celui de Reichenau (xe siècle), par exemple, avec près de 5 000 items tirés de la Bible.
À partir du xiie siècle, les productions lexicographiques s'orientent vers deux nouveaux types de regroupements :
– les vocabulaires thématiques, où sont présentés, par centres d'intérêt, les mots latins et leur explicitation en une autre langue. Ces « nominalia » ou nomenclatures sont conçues pour l'enseignement, et certains modèles, associés à des méthodes de langues vivantes ou à des manuels de conversation, prolongeront leur existence jusqu'au xviiie siècle ;
– les lexiques, constitués par compilation de gloses textuelles puis de glossaires. Ils atteindront le volume des premiers dictionnaires en empruntant beaucoup à la tradition des répertoires monolingues latins développés dans toute l'Europe au cours du Moyen Âge.
L'ensemble de ces ouvrages, en particulier l'Elementarium de Papias, les Derivationes d'Hugutio de Pise et surtout le Catholicon alphabétique de Johannes Balbi dit Jean de Gênes (1290, imprimé en 1460), a beaucoup aidé les réalisations ultérieures. Les plus importantes productions glossographiques de l'Europe médiévale avec mentions françaises, les Abavus et Aalma datant des xiiie et xive siècles et désignées par leur lemme initial, ont mis à profit les données linguistiques et le discours grammatical, lexicographique et encyclopédique élaborés par leurs devanciers.
La lexicographie moderne prend son essor au xvie siècle avec la multiplication des répertoires plurilingues et surtout l'apparition de grands dictionnaires philologiques des langues classiques. Les multilingues, destinés, selon leur format et leur contenu, aux savants ou aux voyageurs et aux commerçants, introduisent le français à l'occasion d'une réédition. Ils proposent un nombre croissant de langues (flamand, italien, espagnol, anglais, allemand et français pour l'essentiel), leur nombre allant de pair avec la réduction du contenu des articles. Le Dictionarium d'Ambrogio Calepino (2 langues en 1502, 11 en 1588) en est un bon exemple. Les dictionnaires philologiques sont dus à de célèbres érudits et, avec eux, s'affirme le concept de « dictionnaire général » d'une langue. Les perfectionnements appliqués au traitement des langues littéraires anciennes, et d'abord au latin, ont ouvert la voie aux premiers grands répertoires des principales langues européennes.
Pour le français, l'artisan en fut sans conteste Robert Estienne, auteur d'un Thesaurus linguae latinae (1532) de réputation internationale (encore revu et réédité en Italie en 1771 par Forcellini). La version bilingue à l'usage des étudiants, le Dictionaire françoys-latin (1539) est le premier relevé important d'entrées françaises, dix mille items environ en ordre alphabétique, avec de nombreux développements en français à côté des équivalents latins. Au fil des rééditions, les ajouts sans correspondants latins seront définis et commentés en français. Le remaniement dû à Jean Nicot, paru sous le titre Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne (1606), réduit encore le bilinguisme au profit du français, preuve de l'intérêt porté par un large public aux commentaires étymologiques et encyclopédiques en langue vulgaire.
Les premiers répertoires européens monolingues de langues nationales sont le Tesoro de Covarrubias (1611) pour l'espagnol, et le Vocabolario de l'Accademia della Crusca (1612) pour le toscan. Inspirée par ces modèles, la lexicographie monolingue du français fait ses débuts officiels à la fin du xviie siècle sous le double aspect qui est encore le sien : dictionnaires de langue et dictionnaires encyclopédiques. Dès 1636, la toute récente Académie française avait été chargée d'un dictionnaire de la langue illustré par les meilleurs auteurs. Mais le français littéraire connaissant encore des changements profonds et répétés, il s'avéra aussi difficile de choisir des modèles que des méthodes satisfaisantes pour les traiter alors que s'affrontaient des conceptions grammaticales divergentes. Ce fut donc un dictionnaire normatif qu'elle publia en 1694. Fondé sur la langue des « honnêtes gens » et non sur celle des « meilleurs écrivains », il offrait à l'homme cultivé de l'époque une image sélective d'un « bon usage » que certains qualifieront d'aristocratique. Il proposait des définitions générales souvent abstraites, des exemples créés mais non des citations (les académiciens n'étaient-ils pas eux-mêmes des autorités reconnues ?) pour une nomenclature de quinze mille vedettes environ. Par ces options, l'ouvrage allait déterminer les caractères distinctifs des dictionnaires de langue prescriptifs synchroniques. Les huit éditions de 1694 à 1932, et la neuvième en cours, resteront fidèles à ce modèle, comme les très nombreux répertoires à visées scolaires qui s'en inspireront ensuite, explicitement ou non.
Pendant la seconde moitié du xviie siècle, la lenteur du travail académique a laissé place à des projets différents et parfois concurrents qui parurent les premiers. Le Dictionnaire des mots et des choses de Pierre Richelet (1680) peut être tenu pour le prototype du dictionnaire général. Premier dictionnaire intégralement monolingue en français, ses définitions sont dans l'ensemble originales. Dictionnaire descriptif, il s'ouvre aux réalités de la société contemporaine en introduisant des marques d'usage, il accueille des mots populaires ou « bas », des usages marginaux et de nombreux termes des arts et des sciences traités à la manière encyclopédique. Il propose aussi des citations d'auteurs alors célèbres. Ses qualités en feront la référence obligée des répertoires du même type.
Dans son Dictionnaire universel (1690), Antoine Furetière, académicien lui-même, sera plus ambitieux encore puisqu'il entend réaliser l'« encyclopédie de la langue ». Il réduit la part de la langue commune pour se démarquer de l'Académie, et il accorde toute son attention aux langues de spécialité, aux termes techniques, aux mots rares même anciens, qu'il traite en « philosophe » érudit. Son ouvrage représente le prototype du dictionnaire encyclopédique extensif, annonciateur des grands répertoires de l'avenir.
Avec une nomenclature double de celle de l'Académie (Richelet) ou triple (Furetière), des définitions développées enrichies de compléments explicatifs, critiques, voire anecdotiques, ces deux ouvrages proposent, chacun à sa manière, un large tableau des connaissances de l'époque. À l'aube du siècle des Lumières, on comprend que ces répertoires aient acquis rapidement la faveur du public. Souvent remaniés et augmentés, ils serviront de base aux compilations mi-lexicographiques, mi-encyclopédiques du xviiie et d'une grande partie du xixe siècle. Parmi celles-ci, une place particulière revient au Dictionnaire universel françois et latin dit de Trévoux (3 tomes en 1704, 8 tomes en 1771), remaniement anti-janséniste du Furetière par les jésuites de Trévoux, bel exemple de l'utilisation du dictionnaire comme instrument délibéré de militantisme idéologique.
À côté des volumineuses productions précédentes, l'activité dictionnairique du xviiie siècle présente deux aspects nouveaux : pour le contenu, des relevés terminologiques des arts et des sciences ; pour le format, des répertoires de taille plus modeste. Les deux étant souvent associés.
Toutes les sciences et techniques du temps vont recevoir leur dictionnaire, lexique ou vocabulaire, par exemple, le Dictionnaire général des termes propres à l'agriculture de Liger (1703), le Dictionnaire de commerce de Savary Des Bruslons (1723) ou le Dictionnaire universel de la géographie commerçante de Peuchet (1798). Les répertoires universels ultérieurs mettront à profit ces très importantes mines de données, comme dans l'Encyclopédie de Diderot les vocabulaires des « Descriptions des arts et métiers » commanditées par l'Académie des sciences.
À l'approche de la Révolution et en réaction contre l'inflation des nomenclatures, des titres, des formats et des coûts, vont se multiplier les dictionnaires abrégés, manuels, de poche ou portatifs, et les vocabulaires dont la vogue persistera pendant la première moitié du xixe siècle. C'est sous une forme ainsi réduite que le Dictionnaire de l'Académie connaîtra un rayonnement et un succès incontestés, notamment auprès du public scolaire.
La tendance au gigantisme réapparaît au cours du xixe siècle. Les célèbres Gattel (de 1813 à 1857) ou Boiste (de 1800 à 1857, dont le Pan-Lexique de 1834), nés portatifs, s'enfleront progressivement jusqu'à quadrupler au moins leur volume initial. Pour satisfaire la lexicomanie dominante, certains auteurs se vanteront d'offrir cent cinquante mille entrées (monstres et inutilités compris), excès qui finiront par être justement critiqués chez Landais (1834) ou Bescherelle (1843), par exemple. Avec son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (1866-1890), Pierre Larousse imposera à ce type de lexicographie les exigences de qualité qui sont de mise aujourd'hui. À sa suite, les nombreux remaniements ou éditions condensées ne s'en départiront plus.
Délaissés à l'avantage des « dictionnaires de choses », les « dictionnaires de mots » prirent, à la veille de la Révolution, un essor qui se confirmera au cours du xixe siècle. Ils cesseront d'être le « squelette » évoqué par Voltaire lorsque les citations, puisées aux sources les plus riches de la langue littéraire, viendront peu à peu nourrir leurs colonnes et remplacer, ou compléter, les exemples succincts et anonymes. En Angleterre, faute de pouvoir faire appel à l'autorité d'une académie, Samuel Johnson (1755) avait dû emprunter aux grands écrivains de nombreuses citations. Il démontrait ainsi qu'un ouvrage non encyclopédique pouvait être d'une lecture enrichissante, voire passionnante, et il fera école. En France, les bouleversements politiques ne permettront pas de réaliser avant Littré de larges inventaires fondés sur les richesses de la langue des auteurs anciens et modernes, et ils resteront à l'état de projets (Pougens, 1794).
Au cours de la seconde moitié du xixe siècle, les dictionnaires de langue commencent à tirer avantage des toutes jeunes sciences du langage. Les répertoires spéciaux (dictionnaires de prononciation, de synonymes, étymologiques, analogiques ou idéologiques) en seront les premiers bénéficiaires. Les dictionnaires généraux suivront. Celui d'Émile Littré (1863-1877), le plus célèbre, est surtout le plus représentatif du renouveau méthodologique sinon scientifique de la lexicographie. L'auteur applique à la description de la plus riche masse documentaire assemblée jusqu'alors une méthode naturaliste d'inspiration positiviste, et il fait preuve d'un talent rare pour analyser les sens et les définir clairement. Les principaux documents relatifs à l'histoire, à la signification et à l'emploi des mots y sont réunis. Mais cela, appliqué à un français qu'il dit « contemporain », arbitrairement limité à la période 1600-1800 environ. Dans leur Dictionnaire général, Hatzfeld, Darmesteter et Thomas amplifieront l'œuvre de Littré en ajoutant un siècle d'usages (le terme final correspond à la date de rédaction, 1890) et en appliquant une philologie plus exigeante encore. Il est vrai qu'ils pouvaient alors mettre à profit les progrès décisifs réalisés après 1870 par la phonétique, la morphologie et la sémantique historiques. Les deux ouvrages connaîtront un succès non démenti pendant plus d'un demi-siècle.
En 1950 paraît le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, projet de « nouveau Littré » dû à Paul Robert. L'ouvrage modernise les modèles précédents en associant, à chaque entrée alphabétique, des corrélations linguistiques (dérivés, composés) et conceptuelles (mots analogues, synonymes, antonymes). Le Grand Larousse de la langue française (1971-1978) emprunte bon nombre de ses données à la partie linguistique du Grand Larousse encyclopédique (1960-1975). Plus proche ainsi de la civilisation technico-scientifique contemporaine, il est aussi moins marqué que le Robert par la culture littéraire. Ces répertoires dominent une importante production de dictionnaires usuels de format réduit, qui donnent naissance à leur tour à des « petits » auxquels ils transmettent l'essentiel de leurs qualités.
La parution du Littré, essentiellement consacré au français classique, puis celle du Dictionnaire de l'ancienne langue française de Frédéric Godefroy (1880) ont sans doute contrarié la poursuite du projet de Dictionnaire historique mis en chantier à partir de 1836 par l'Académie française (arrêté en 1894 à la lettre A). À l'étranger, des entreprises similaires ont été conduites à leur terme pour l'allemand et pour l'anglais, on l'a vu. En France, le Trésor de la langue française des XIXe-XXe siècles, réalisé par le C.N.R.S. sous la direction de Paul Imbs et de Bernard Quemada (1971-1994), a mis en œuvre une conception et une méthodologie nouvelles. Premier ouvrage de lexicographie historique à être réalisé avec l'assistance de l'ordinateur, il est fondé sur une très grande richesse documentaire qui a permis d'affiner les analyses et la distribution des sens et des emplois.
À date récente, deux catégories de répertoires ont pris un essor particulier. À la suite des recommandations officielles qui ont fait pénétrer le dictionnaire dans les classes de français, une importante production de dictionnaires d'apprentissage est venue alimenter ce nouveau marché. Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de ces répertoires, tenus pour des manuels pédagogiques, ont été étudiées par des didacticiens de la langue. Par ailleurs, l'ampleur des besoins en matière de terminologie, en écho aux mouvements des sciences et des techniques, entraîne le renouveau et la multiplication des répertoires plurilingues de termes spécialisés. Très productive aujourd'hui, la terminographie définit en parallèle la spécificité des unités de dénomination dont elle traite et les méthodes propres à leur mise en forme dictionnairique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Bernard QUEMADA : directeur de recherche émérite au C.N.R.S., directeur d'études honoraire à l'École pratique des hautes études
Classification
Média
Autres références
-
ARABE (MONDE) - Littérature
- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH , Hachem FODA , André MIQUEL , Charles PELLAT , Hammadi SAMMOUD et Élisabeth VAUTHIER
- 29 248 mots
- 2 médias
...masque plus le dépérissement d'une connaissance désormais figée et le tribut trop lourd payé au merveilleux. Plus intéressants, et plus sérieux, sont les dictionnaires géographiques, avec al-Bakrī (mort en 1094) – par ailleurs le seul à prolonger, dans un autre ouvrage, quelques-uns des traits de l'école... -
BAYLE PIERRE (1647-1706)
- Écrit par Élisabeth LABROUSSE
- 942 mots
Le Dictionnaire historique et critique de Bayle (1696) figure très souvent dans les inventaires de bibliothèques privées du xviiie siècle. Bayle fut en effet un des inspirateurs des Lumières. Dans cet ouvrage, l'auteur manifeste une prodigieuse érudition, mais les longues « remarques » personnelles...
-
CHAMBERS EPHRAÏM (1680 env.-1740)
- Écrit par Louise LAMBRICHS
- 320 mots
Publiciste et encyclopédiste anglais, né à Kendal, dans le Westmorland et mort à Islington, dans le Middlesex. D'origine modeste, Ephraïm Chambers fit ses études dans sa ville natale, puis entra comme apprenti chez un cartographe qui le poussa à se cultiver. En 1728, il lança, par souscription, l'ouvrage...
-
DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE
- Écrit par Bernard VALADE
- 189 mots
L'article 26 des premiers statuts de l'Académie française, fondée en 1635, prescrivait que la Compagnie rédigerait un Dictionnaire afin de « donner des règles certaines à notre langue ». La première édition parut en 1694. Ses deux volumes comprennent environ 15 000 mots, classés par...
- Afficher les 30 références
Voir aussi