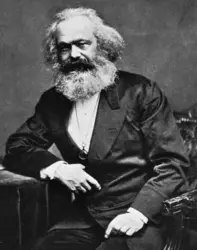ÉCONOMIE (Histoire de la pensée économique) Marxisme
Article modifié le
Les crises du capitalisme
On ne trouve pas dans les œuvres de Marx de véritable explication des crises et de la disparition inéluctable du capitalisme. Toutefois, on y trouve deux cadres théoriques et nombre d'analyses concrètes de crises particulières, susceptibles de servir de matériaux à une telle explication. Ce sont ces matériaux que tous les marxistes utilisent, sans leur accorder le même poids et sans les combiner de la même manière. Ainsi, on peut regrouper leurs théories en deux grands ensembles qui se distinguent par le cadre théorique qui leur sert d'ancrage : la baisse tendancielle du taux de profit et la reproduction élargie.
La baisse tendancielle du taux de profit
Marx formule la loi de la baisse tendancielle du taux de profit en deux temps (livre III, tome II, chap. xiii et xiv). Premier temps, il énonce la « nature de la loi ». Le taux d'exploitation (Pl/W) étant supposé constant et la composition organique (C/W) ne cessant d'augmenter du fait du développement des forces productives, le taux de profit ne cesse de baisser :

Deuxième temps, il examine les « causes qui contrecarrent la loi ». Marx en énumère cinq, mais seules les deux premières importent : 1. Élévation du degré d'exploitation (Pl/W), en particulier à la suite d'une diminution de la valeur des biens de consommation ; 2. Diminution de la valeur des éléments constituant le capital constant (C). Et ces deux diminutions de valeur ne peuvent être dues qu'à une amélioration de la productivité du travail.
Toutes les théories des crises et du caractère transitoire du capitalisme élaborées à partir de cette loi, quel que soit l'accent mis par ailleurs sur les rôles du commerce extérieur, du capital financier, ou de la lutte des classes, se ramènent à l'argument suivant. Quand le taux de profit tombe au-dessous d'un certain niveau en raison du développement des forces productives, le capitalisme connaît une crise. Tant qu'il disposera de quelques moyens de le rehausser grâce à l'une des causes qui contrecarrent, il sortira de la crise. Sinon, il s'enfoncera dans celle-ci et disparaîtra. Et toutes ces théories ont les mêmes défauts. D'abord, elles sont incapables de déterminer le ou les seuils critiques du taux de profit. Ensuite, et surtout, elles reposent sur la loi de la baisse tendancielle, qui n'est pas fondée.
En effet, l'exposé de Marx sépare abusivement la nature de la loi des causes qui la contrecarrent. Du côté nature, le développement des forces productives est censé induire une hausse de la composition organique (C/W). Du côté causes, ce développement est censé augmenter la productivité du travail, et donc diminuer les valeurs unitaires des moyens de production (C) et des moyens de consommation (W). Ainsi, ce développement est contradictoirement supposé, d'un côté, augmenter nécessairement C/W et, d'un autre, diminuer simultanément C et W, laissant indéterminé le sens de variation de C/W. En plus, si on admet, côté nature, que ce développement augmente bien C/W, on sait, côté causes, qu'il diminue W et augmente donc Pl/W. Ainsi, ce développement peut au total entraîner une hausse du taux de profit au cas où l'augmentation de C/W est plus que compensée par celle de Pl/W.
Ce sont ces failles de la loi tendancielle que certains « marxistes légaux » de la fin du xixe siècle, tel Mikhaïl I. Tugan-Baranowsky, ont exploitées pour dissocier la question des crises et celle du caractère transitoire du capitalisme. Leur thèse est que le capitalisme connaît des crises, mais qu'il peut toujours les surmonter grâce à l'une des causes qui contrecarrent la loi, et qu'il peut aller ainsi ad vitam aeternam.
La reproduction élargie
Marx analyse la reproduction du capital pour déterminer les conditions auxquelles les capitaux trouvent de période en période les éléments productifs nécessaires pour reprendre leur activité à une échelle sans cesse plus grande. À titre pédagogique, il commence par la reproduction simple, où les capitalistes consomment tout leur profit. Puis il étudie la reproduction élargie, où ils accumulent une partie de leur profit, conformément à la définition du capital.
La dynamique du capitalisme participant au développement des forces productives et le niveau de ces dernières ayant pour indicateur la composition organique du capital (C/W), Marx élabore ses schémas de reproduction en subdivisant l'activité économique en deux grandes sections : la section I qui produit les moyens de production (C) ; la section II qui produit les moyens de consommation, que les travailleurs acquièrent avec leurs salaires (W). Ces deux sections produisent selon l'équation de la production :
MI = CI + WI + PlI,
MII = CII + WII + PlII.
Et les capitalistes dans les deux sections utilisent leur profit pour accroître leur capital constant (ΔC) ou variable (ΔW) et pour consommer (X) :
PlI = ΔCI + ΔWI + XI,
PlII = ΔCII + ΔWII + XII.
La reproduction élargie n'a lieu que si tous les capitalistes, quelle que soit la section où ils ont engagé leurs capitaux, peuvent trouver à chaque période les éléments productifs dont ils ont besoin pour renouveler et pour accroître leurs capitaux constants et variables et pour consommer. Cela implique que la production de la section I (MI) soit telle que :
MI = CI + CII + ΔCI + ΔCII
et que celle de la section II (MII) soit telle que :
MII = WI + WII + ΔWI + ΔWII + XI + XII.
Pour que ces deux dernières égalités et les deux séries d'égalités précédentes soient vérifiées, une seule condition doit être respectée :
WI + ΔWI + XI = CII + ΔCII.
Cette condition de reproduction peut être interprétée comme une sorte d'échange global entre les deux sections. Le produit de la section I étant constitué de moyens de production, les capitalistes de cette section retirent de ce produit les éléments nécessaires pour renouveler et accroître leur capital constant. Et, ce qui reste, ils l'offrent aux capitalistes de la section II afin d'obtenir des moyens de consommation pour renouveler et accroître leur capital variable et pour satisfaire leur consommation (WI + ΔWI + XI). Symétriquement, le produit de la section II étant constitué de moyens de consommation, les capitalistes de cette section retirent de ce produit les biens nécessaires pour renouveler et accroître leur capital variable et pour satisfaire leur consommation. Et, ce qui reste, ils l'offrent aux capitalistes de la section I afin d'obtenir des moyens de production pour renouveler et accroître leur capital constant (CII + ΔCII). Et les offres des deux sections doivent être égales pour que l'échange ait lieu.
Cet échange global recouvre en réalité une multitude d'échanges qui, conformément à la définition du capital, doivent s'effectuer par une circulation de monnaie. Marx bute là sur un cercle apparemment vicieux. Les capitalistes d'une section doivent avoir vendu une certaine part de leur produit contre de la monnaie pour effectuer certains achats auprès des capitalistes de l'autre section. Et cela n'est possible que si, préalablement, ces derniers ont eux-mêmes effectué certains achats auprès des premiers, c'est-à-dire que si, préalablement, ces derniers ont donc déjà vendu une certaine part de leur propre produit contre de la monnaie. Marx se pose alors la question : « d'où vient la monnaie ? ».
Cette question s'est trouvée au cœur de nombreuses thèses, qui ont expliqué les crises par des tendances inhérentes au capitalisme à la sous-consommation ou à la surproduction. Dans son Accumulation du capital, parue en 1913, Rosa Luxemburg critique ces thèses et montre que la bonne question n'est pas « d'où vient la monnaie ? », mais « d'où vient la demande ? », et que celle-ci peut être traitée indépendamment de la circulation de la monnaie. Partant de là, elle élabore une théorie qui rend compte à la fois des crises du capitalisme et de son caractère transitoire.
Rosa Luxemburg adjoint aux schémas de reproduction de Marx trois hypothèses qui, selon elle, traduisent des traits essentiels du capitalisme. Premièrement, elle écarte la consommation des capitalistes, car il serait paradoxal de démontrer la pérennité de la reproduction du capital grâce à cette consommation, alors même que l'essence du capital est d'accumuler sans cesse. Deuxièmement, elle admet que la concurrence entre les capitaux accomplit son office, c'est-à-dire que les échanges se font aux prix de production et que les taux de profit des deux sections sont égaux. Troisièmement, elle intègre le développement des forces productives. En bonne marxiste, elle admet qu'il a pour effet d'augmenter la composition organique. Mais on peut admettre qu'il a l'effet inverse sans rien modifier à sa démonstration et à sa conclusion. Cette conclusion est que, si le capitalisme avait seulement ces trois traits, alors il ne pourrait pas vérifier sa condition de reproduction et n'aurait donc jamais pu exister.
Rosa Luxemburg relève alors une hypothèse implicite des schémas de Marx : le système capitaliste est fermé. Puis elle montre que, s'il est ouvert sur un milieu constitué de formations sociales non capitalistes, il peut vérifier sa condition de reproduction en réalisant avec ce milieu des échanges-intégration, par lesquels il détruit ces formations sociales en phagocytant leurs forces productives. Ainsi, elle peut, d'une part, fixer au capitalisme un terme ultime : la destruction totale de son milieu, et, d'autre part, interpréter les crises comme des moments où il est incapable d'effectuer des échanges-intégration satisfaisants, pour diverses raisons : les hommes vivant dans ces formations sociales refusent ces échanges ; la culture de ces hommes les rend inemployables vu les techniques de production utilisées ; les rapports de forces géopolitiques entre pays empêchent de tels échanges-intégration...
La théorie de Rosa Luxemburg aurait dû séduire les marxistes. Elle explique les crises et le caractère transitoire du capitalisme à partir de la dialectique des forces productives et des rapports de production. Elle rend compte du fait historique que le capitalisme a continûment détruit les formations sociales non capitalistes, et qu'il a donc toujours été impérialiste. En outre, elle fournit une grille de lecture pertinente des conjonctures où les puissances capitalistes s'apprêtent à entrer en guerre, comme en 1914. Pourtant, elle a été combattue aussi bien par les réformistes (Karl Kautsky) que par les révolutionnaires (Lénine et Nicolas Boukharine). Tous reprochent explicitement à Rosa Luxemburg d'avoir osé critiquer Marx. Mais, au fond, ils n'acceptent pas l'une des conséquences de sa théorie : le socialisme dans un seul pays ne pourra survivre qu'en étant aussi impérialiste que le capitalisme.
La théorie de Rosa Luxemburg a néanmoins un point faible, mis au jour dès 1913 par Otto Bauer, un austro-marxiste. Cette théorie tient, certes, compte du résultat de la concurrence entre les capitaux, mais ne la représente pas. Elle suppose que tous les capitaux ont le même taux de profit, alors que, pour représenter leur concurrence, on doit admettre qu'il existe des différentiels de taux de profit et, en conséquence, des transferts de capitaux d'une activité à une autre motivés par ces différentiels. Or, en intégrant ces transferts, on peut montrer qu'une variation de la composition organique provoque à coup sûr des fluctuations, mais qu'elle n'interdit pas qu'un système capitaliste fermé vérifie la condition de reproduction (Rosier, 1986).
En dépit de toutes ses difficultés, le cadre conceptuel économique marxiste a été une source stimulante pour nombre d'économistes, tels que Michael Kalecki, Wassily Leontief... À certaines époques, il a même constitué un espace de débats ayant leurs propres enjeux, mais aussi chargés d'implications évidentes pour des pans entiers de la discipline économique. Ainsi, entre 1945 et 1980, des thèses marxistes ont dominé l'économie du développement : celles sur l'échange inégal qui expliquent les écarts de richesse entre pays par des captations de valeur résultant du jeu de la péréquation du taux de profit au niveau international ; et celles sur les liens entre pays du centre et de la périphérie, qui s'inspirent de la théorie luxemburgiste. Après 1980, les économistes semblent avoir déserté ce cadre conceptuel, presque aucun ne se revendique plus marxiste, si tant est que cela ait jamais eu un sens. Cependant, les tensions économiques qui se sont fait jour depuis lors suscitent un certain regain d'intérêt pour celui-ci. Les régulationnistes y empruntent explicitement beaucoup, tandis que d'autres s'y réfèrent de façon moins systématique et plus discrète.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel ROSIER : docteur d'État en sciences économiques, professeur des Universités
Classification
Médias
Autres références
-
MARITIMISATION DE L'ÉCONOMIE
- Écrit par Geoffroy CAUDE
- 3 979 mots
- 8 médias
Depuis l’Antiquité, la voie maritime a permis aux navigateurs de commercer en transportant dans leurs navires des quantités de marchandises très supérieures à celles que permettaient les voies terrestres – ainsi, les Égyptiens, qui allaient jusqu’à Sumatra quelque 1200 ans avant notre ère ou, plus...
Voir aussi
- PRODUCTION MODES DE
- CAPITAL CONSTANT & CAPITAL VARIABLE
- CAPITAL ACCUMULATION DU
- DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- STATIQUE COMPARATIVE, économie
- PLUS-VALUE
- MARXISME, économie
- BORTKIEWICZ LADISLAUS VON (1868-1931)
- VALEUR LOI DE LA
- PRODUCTIVITÉ
- ÉCHANGE, économie
- OFFRE & DEMANDE
- UTILITÉ, économie
- MARCHANDISE
- FÉTICHISME, économie
- LUTTE DE CLASSES
- CONDITIONS DE TRAVAIL
- PRODUCTION MOYENS DE
- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT
- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA
- CLASSIQUE ÉCOLE, économie