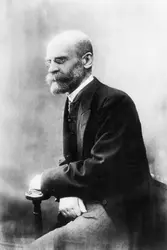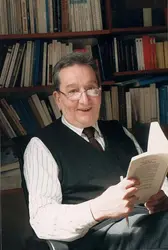ÉDUCATION Sociologie de l'éducation
Article modifié le
Que fait l'école ?
Quand l'alliance paisible de l'école et de la société paraît ébranlée, quand l'école semble enfoncée dans une crise latente, la plupart des sociologues ne s'en tiennent plus à une conception « simple » de la reproduction selon laquelle l'école serait une sorte de boîte noire enregistrant passivement les inégalités sociales. Bien qu'aucun système scolaire ne paraisse en mesure de neutraliser l'effet des inégalités sociales sur les inégalités scolaires, il semble cependant que l'école joue un rôle propre à travers son organisation, ses méthodes pédagogiques, ses traditions, comme le mettent en évidence les comparaisons internationales des systèmes scolaires qui semblent plus ou moins efficaces et plus ou moins équitables. Depuis une vingtaine d'années, un nombre considérable de travaux, notamment ceux de Marie Duru-Bellat, ont été consacrés aux inégalités de l'offre scolaire elle-même, aux divers « effets » scolaires, à la manière dont l'école « produit » des inégalités.
Bien sûr, les établissements accueillant les meilleurs élèves, qui sont souvent les plus privilégiés socialement, obtiennent de meilleurs résultats que les autres. Mais il apparaît aussi que des établissements socialement identiques n'ont pas nécessairement la même « efficacité ». Ils ne sélectionnent et n'orientent pas les élèves de la même manière, quelques-uns creusent les écarts, d'autres les maintiennent ou les atténuent. Ce qu'on appelle le climat éducatif, la nature des relations entre les enseignants, les élèves et les familles, la cohésion de l'équipe éducative, varient sensiblement selon les établissements. Les uns sont confrontés à l'absentéisme et aux désordres, les autres moins. Il semble que cet « effet établissement » tienne à la mobilisation des équipes éducatives, au style d'autorité des directions et à leur capacité d'attirer les meilleurs élèves au sein d'une catégorie sociale donnée. Dès lors, la carrière d'un élève ne dépend pas seulement de son origine sociale et de ses talents, elle tient aussi à la qualité de l'établissement où il est scolarisé.
Autre effet, celui de la composition des classes. Beaucoup pensent que les classes hétérogènes du collège unique sont un échec, « tirant » les meilleurs élèves vers le bas et imposant aux plus faibles un enseignement qui ne leur conviendrait pas. La mesure précise des conséquences de la composition des classes dément cette croyance : le regroupement des élèves faibles dans les mêmes classes fait baisser leur niveau, alors que le regroupement des bons élèves n'entraîne pas un gain comparable à la perte des plus faibles. Dès lors, la manière de composer les classes a des effets sur le niveau moyen des élèves et sur les écarts entre les meilleurs et les moins bons. L'organisation de l'école peut donc infléchir la formation des inégalités scolaires.
Les effets de l'école peuvent être plus subtils encore. Par exemple, la « qualité » du maître de cours préparatoire produit des conséquences identifiables sur les apprentissages scolaires des élèves. Dans l'enseignement secondaire, des études de Georges Felouzis et de Pierre Merle démontrent que les manières de noter et d'évaluer les élèves varient sensiblement d'un enseignant à un autre et que les professeurs ne sont pas également efficaces et équitables. Mais ce qui vaut pour les maîtres vaut aussi pour les élèves et l'on ne doit pas perdre de vue le fait que de nombreux parcours scolaires sont profondément atypiques : des élèves a priori « voués » à l'échec connaissent de grandes réussites alors que d'autres, socialement destinés à réussir, échouent à l'école. La sociologie de l'éducation étudie donc ces parcours exceptionnels qui échappent parfois à l'analyse des grandes séries statistiques. L'école n'est pas une simple chambre d'enregistrement des inégalités sociales : il existe une marge d'action, fût-elle réduite, face à la « loi d'airain » des inégalités scolaires.
L'évaluation des politiques publiques et les comparaisons internationales renforcent encore l'idée selon laquelle l'école a un rôle propre. De plus en plus fréquemment, les sociologues de l'éducation analysent et évaluent les conséquences des politiques scolaires. Denis Meuret, par exemple, s'est efforcé de mesurer la portée de la politique de discrimination positive mise en place voici plus de vingt ans avec les Z.E.P. Il montre que si cette politique n'a pas eu d'effets sensibles sur les performances des élèves, elle a en revanche contribué à améliorer le climat des établissements. Les comparaisons internationales, appuyées sur de vastes enquêtes, indiquent que, pour des sociétés comparables consacrant la même part de leur P.I.B. à l'éducation, le niveau moyen des élèves et les écarts entre les meilleurs et les moins bons varient sensiblement d'un pays à l'autre. Comment expliquer ces différences ? Tiennent-elles à la structure des études, à l'autonomie des établissements, au mode de pilotage du système, à la formation et au travail des enseignants ? Il est clair que la sociologie de l'éducation comparée est appelée à se développer dans les années qui viennent. Tous ces travaux mettent en lumière le fait que la sociologie de l'éducation n'est pas strictement spéculative : bon gré mal gré, elle contribue à l'élaboration des politiques scolaires.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François DUBET : professeur des Universités, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Médias
Autres références
-
ÉDUCATION / INSTRUCTION, notion d'
- Écrit par Daniel HAMELINE
- 1 300 mots
On pourrait penser, dans un premier temps, que les rapports entre « éduquer » et « instruire » sont simples à établir. Si l'on se réfère à la définition qu' Emmanuel Kant donne de l'éducation, à la fin du xviiie siècle, l'instruction apparaît, à côté « des soins, de...
-
AFGHANISTAN
- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT
- 37 323 mots
- 19 médias
Par ailleurs, les politiques publiques, largement imposées de l'extérieur, sont irréalistes dans leur définition. Ainsi,l'éducation est l'un des seuls domaines où le ministère afghan est un acteur central, notamment parce qu'il gère le personnel. Pourtant, la stratégie, définie par les organisations... -
ALPHABÉTISATION
- Écrit par Béatrice FRAENKEL , Léon GANI et Aïssatou MBODJ
- 8 964 mots
...marchands. En France, l'écriture de la langue française et l'invention de l'imprimerie vont rendre définitive la sécularisation de la culture écrite. C'est autour des xvie et xviie siècles qu'une demande d'école, émanant des communautés urbaines et parfois rurales, s'affirme. Dès lors, l'histoire... -
ARNOLD THOMAS (1795-1842)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 366 mots
Éducateur britannique, headmaster (directeur) de la célèbre public school de Rugby, Thomas Arnold exerça une forte influence sur l'éducation privée en Angleterre. Il était le père du poète et critique Matthew Arnold.
Né le 13 juin 1795 à East Cowes, sur l'île de Wight, Thomas Arnold fait...
-
ART (Aspects culturels) - La consommation culturelle
- Écrit par Pierre BOURDIEU
- 4 059 mots
- 2 médias
...tient les goûts en matière de culture légitime pour un don de la nature, l'observation scientifique montre que les besoins culturels sont le produit de l' éducation : l'enquête établit que toutes les pratiques culturelles (fréquentation des musées, des concerts, des expositions, lecture, etc.)... - Afficher les 108 références
Voir aussi
- CULTURE SOCIOLOGIE DE LA
- ZEP (zone d'éducation prioritaire)
- PASSERON JEAN-CLAUDE (1930- )
- COLLÈGE
- DÉMOCRATISATION
- BAUDELOT CHRISTIAN (1938- )
- ÉDUCATION SOCIOLOGIE DE L'
- ESTABLET ROGER (1938- )
- HÉRITAGE SOCIO-CULTUREL
- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
- ENSEIGNANTS
- ÉGALITÉ & INÉGALITÉ SOCIALES
- DOMINATION, sociologie
- MARCHÉ DU TRAVAIL
- DIPLÔME, enseignement
- EMPLOI
- SCOLARITÉ