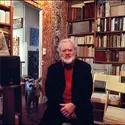ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
Article modifié le
Haut-parleurs
Parmi les transducteurs électro-acoustiques destinés à transformer de l' énergie électrique en énergie acoustique, on distingue habituellement deux grandes classes : celle des haut-parleurs, appareils conçus pour rayonner dans l'espace de l'énergie acoustique, et celle des écouteurs, appareils conçus seulement pour transmettre directement des sons par l'intermédiaire d'un couplage acoustique étroit entre l'écouteur et le pavillon de l'oreille.
De même que le problème du microphone est dominé par les difficultés dues à la diffraction, le problème du haut-parleur est dominé par les difficultés du rayonnement. On demande au haut-parleur considéré comme un « émetteur sonore » des performances absolument extraordinaires – et d'ailleurs totalement irréalisables, du moins dans l'état actuel de la technique. Il s'agirait en effet de posséder des qualités de rendement, de linéarité et de directivité qui soient non seulement bonnes, mais en outre constantes sur une gamme de fréquences qui s'étend sur près de dix octaves.
Le rayonnement
Les théories du rayonnement prennent toujours pour point de départ l'étude de la source acoustique la plus simple, à savoir la source sphérique ponctuelle ou « sphère pulsante ». Une telle source émet en milieu infini des ondes sphériques divergentes qui, si on les observe très loin de la source, tendent à avoir les caractéristiques d'une onde plane.
La source peut être considérée comme ponctuelle si son rayon r est plus petit que λ/6. Si U désigne la vitesse vibratoire maximale de la surface de la sphère, la pression acoustique p créée à une distance d de la source prend alors la forme :

La source est omnidirectionnelle, et la pression acoustique varie proportionnellement à l'inverse de la distance.
Un des modèles intéressants directement issu de celui-ci est le doublet acoustique que constituent deux sphères pulsantes ponctuelles voisines vibrant en opposition de phase.
À une distance d du doublet, grande à la fois par rapport à λ et par rapport à l'écart δ des deux sources, le module de la pression sonore créée en milieu infini dans une direction faisant l'angle θ avec la droite qui joint les sources prend la forme :

La source obtenue est bidirectionnelle ; la pression acoustique produite à distance est maximale sur la droite joignant les deux sources et nulle dans leur plan médiateur. En outre, on remarquera que, si cette pression reste, comme dans le cas de la source sphérique simple, proportionnelle à l'inverse de la distance d, elle devient par contre proportionnelle au carré de la fréquence, et non plus à la fréquence.
La théorie du rayonnement de la sphère pulsante ponctuelle, ou celle qui en est déduite de la demi-sphère pulsante ponctuelle, rayonnant dans un demi-espace, permet d'aborder l'étude du rayonnement de sources étendues ayant des formes simples.
On considère ces sources comme formées par une infinité de sources sphériques élémentaires, selon les cas placées sur une ligne ou réparties uniformément sur une surface, et l'on opère par intégration. C'est ainsi, par exemple que l'on peut établir la théorie du piston circulaire plat, qui sert de base à l'étude du rayonnement des haut-parleurs. Un tel piston est supposé essentiellement rigide, c'est-à-dire que toutes les parties de sa surface vibrent en synchronisme rigoureux. On le considère le plus souvent comme placé sur un écran plat infini, et l'on étudie alors son rayonnement dans un demi-espace seulement. Le calcul, effectué notamment par Morse, fait intervenir des fonctions de Bessel et fournit le résultat suivant lorsque l'on considère la pression acoustique produite à grande distance de la source dans une direction faisant l'angle θ avec l'axe du piston :

On en déduit que, tant que la circonférence du piston est inférieure à la demi-longueur d'onde de son rayonné (2 π r < λ/2), la partie entre crochets étant alors négligeable, le piston se comporte comme une source ponctuelle : il est omnidirectionnel ; mais, lorsque la fréquence croît, il devient de plus en plus directionnel, avec, à partir d'une certaine fréquence (telle que 2 π r > 4 λ environ), apparition de lobes secondaires.
Haut-parleurs à radiation directe
Les haut-parleurs à radiation directe se composent essentiellement :
– d'un transducteur électromécanique, appelé parfois moteur du haut-parleur ;
– d'un transducteur mécano-acoustique, qui est le diaphragme ou la membrane rayonnante ;
– d'éléments annexes qui assurent la cohésion mécanique de l'ensemble.
Dans le cas le plus fréquent, celui du haut-parleur électrodynamique à bobine mobile, la membrane – en pâte à papier spéciale, en matière plastique, en métal léger, en matériau composite – affecte la forme d'un tronc de cône de révolution ou à base elliptique, ou encore d'une portion de surface, en général de révolution, à génératrice exponentielle, parabolique ou hyperbolique. Mais d'autres formes de membranes, plus compliquées, ont été essayées parfois et sont employées dans certains cas. Il n'y a évidemment pas de limite à la recherche dans ce domaine.
La bobine mobile est collée à la membrane, et l'ensemble forme l'« équipage mobile », lequel est maintenu au centre de l'entrefer du circuit magnétique par un système de suspension annulaire en général double : la suspension périphérique et le spider. Le circuit magnétique et les suspensions sont rendus solidaires par l'intermédiaire du « saladier », pièce qui permet également la fixation du haut-parleur.
Sauf cas spéciaux, la conception d'un tel haut-parleur est dominée par la nécessité de s'approcher, d'une part, d'un fonctionnement en piston rigide, d'autre part, et simultanément, d'un fonctionnement en source ponctuelle, afin d'avoir une source aussi peu directionnelle que possible.
Il est aisé de voir que cette deuxième exigence conduit rapidement à une impossibilité pratique. En effet, pour que le haut-parleur reste omnidirectionnel jusque dans les fréquences audibles les plus élevées, pour lesquelles la longueur d'onde devient inférieure à 2 cm, il faut que le diamètre de sa membrane soit très inférieur à 1 cm. Mais alors, pour rayonner une puissance notable aux fréquences les plus basses, il faudrait que cette membrane puisse se déplacer avec une amplitude énorme, égale à plusieurs fois son diamètre, ce qui est irréalisable et poserait, en outre, des problèmes théoriques nouveaux (effet Doppler). En réalité, pour rayonner correctement les fréquences les plus basses, on ne peut se passer, en pratique, d'une surface rayonnante de grande dimension. Mais alors, pour qu'une membrane d'une telle surface présente la rigidité d'un piston, elle ne peut guère être qu'assez dense. Or une densité superficielle élevée est incompatible avec un bon rendement...
En bref, il est clair que les haut-parleurs réels ne peuvent être que des compromis plus ou moins heureux entre ces exigences contradictoires. Et l'on peut distinguer, globalement, deux méthodes opposées dans la recherche de ce compromis :
– La première consiste à sacrifier un peu les extrémités du spectre audible. Elle conduit à fabriquer des haut-parleurs dits « à large bande » qui peuvent être excellents dans le milieu du spectre audible, mais qui sont trop petits pour rayonner vraiment bien les fréquences les plus basses et beaucoup trop grands pour ne pas être fortement directionnels dans les fréquences les plus élevées.
– La deuxième consiste à diviser le spectre audible en plusieurs bandes – deux ou trois en général, parfois quatre – et à confier la reproduction de ces diverses bandes à des haut-parleurs spécialisés. Pour chacun de ceux-ci pris séparément, les exigences extrêmes se trouvent ainsi beaucoup moins éloignées, et par conséquent le compromis réalisable est bien meilleur. Mais un problème nouveau se pose : celui de la séparation électrique, puis du raccordement de ces bandes de fréquences pour reconstituer le spectre audible dans son intégralité. La séparation se fait à l'aide de filtres électriques qui peuvent apporter, par ailleurs, des défauts nouveaux. La reconstitution du spectre se fait acoustiquement, et pose notamment des problèmes de directivité qui sont insolubles dans la pratique. On ne peut éviter, en effet, que, dans la bande de fréquences où deux hauts-parleurs spécialisés consécutifs fonctionnent simultanément, il n'y ait des phénomènes d'interférences nuisibles, dus à l'existence des deux sources sonores distinctes séparées par une distance qui n'est pas négligeable, et qui est même bien souvent plus grande que la longueur d'onde du son considéré. On est donc, là encore, conduit à consentir des « sacrifices » sur la directivité, au moins dans certaines portions de l'espace et dans certaines bandes de fréquence.
Haut-parleurs à pavillon
Le rendement, c'est-à-dire le rapport « puissance acoustique rayonnée/puissance électrique absorbée », est très faible pour les haut-parleurs à radiation directe, de l'ordre de quelques centièmes, parfois inférieur à 1 p. 100. La raison en est la forte désadaptation entre les impédances acoustiques des deux milieux en contact : la membrane du haut-parleur et l'air environnant. Cette désadaptation d'impédances est due à la différence entre les masses spécifiques de ces deux milieux. Il existe un moyen d'y remédier partiellement en réalisant une adaptation progressive des deux impédances : il consiste à utiliser la propagation des ondes acoustiques dans un pavillon de forme évasée. La « gorge » du pavillon, de faible section, est placée en contact avec la membrane. La « bouche », de forte section, est la partie qui, à l'autre extrémité, rayonne dans l'air. Si l'évasement du pavillon est bien calculé et, en particulier, si la variation de la section avec la distance lorsque l'on passe de la gorge à la bouche se fait selon une loi exponentielle, les lois de la propagation des ondes acoustiques montrent que tout se passe comme si la masse d'air contenue dans un volume élémentaire ayant la section de la bouche se trouvait concentrée dans la gorge, autrement dit comme si l'air contenu dans le pavillon devenait de plus en plus dense au fur et à mesure que l'on se rapproche de la gorge. On réalise donc bien ainsi, partiellement, une adaptation d'impédance, et le rendement d'un bon haut-parleur à pavillon est de 30 à 50 p. 100. Mais ce fonctionnement idéal du pavillon n'a lieu que pour les fréquences supérieures à une fréquence limite appelée fréquence de coupure basse du pavillon, qui est déterminée essentiellement par la surface de la bouche et par la constante m caractérisant la croissance de la section du pavillon.

Pour des raisons techniques, on obtient des haut-parleurs à pavillon un rendement optimal lorsque l'on utilise une membrane de haut-parleur de section nettement supérieure à celle de la gorge. Le couplage acoustique nécessaire entre la membrane et la gorge est alors réalisé au moyen d'une cavité de faible profondeur appelée chambre de compression.
Baffles et enceintes acoustiques
Aux très basses fréquences, un haut-parleur à radiation directe peut être considéré comme une source ponctuelle, mais évidemment pas comme une sphère pulsante. En réalité, il est facile de montrer que le rayonnement d'un piston plat sans écran, rayonnant par conséquent dans tout l'espace, est assimilable aux fréquences basses à celui du doublet ou dipôle acoustique, constitué par deux sphères pulsantes ponctuelles séparées par une distance δ et vibrant en opposition de phase. En effet, un déplacement positif du piston produit une surpression, sur sa face avant par exemple, mais il produit alors sur sa face arrière une dépression de même amplitude. Cette surpression et cette dépression se propagent toutes deux dans l'air avec la vitesse du son, et l'on retrouve aussitôt les propriétés essentielles du doublet indiquées plus haut. On est en présence d'une source bidirectionnelle, qui ne rayonne aucune énergie dans son plan, mais pour laquelle, en outre, la pression sonore croît proportionnellement au carré de la fréquence. La puissance rayonnée est très faible lorsque la longueur d'onde est nettement supérieure au diamètre de la membrane, car il se produit alors, entre les deux « sphères pulsantes » virtuelles qui la représentent, un véritable court-circuit acoustique.
C'est la nécessité d'annuler, ou tout au moins de réduire, les effets de ce court-circuit qui a conduit les techniciens à imaginer des systèmes permettant de séparer totalement ou partiellement le rayonnement de la face avant du haut-parleur de celui de sa face arrière : simples écrans de plus ou moins grandes dimensions, et qui sont alors appelés baffles, ou véritables boîtes, appelées enceintes acoustiques. Celles-ci peuvent être totalement closes ou comporter une ou plusieurs ouvertures, auquel cas il s'agit d'enceintes résonnantes.
Écouteurs
Hormis le problème spécifique du rayonnement, tous les principes qui régissent le fonctionnement d'un haut-parleur sont applicables – moyennant éventuellement quelques adaptations – au cas des écouteurs. Ainsi, en particulier, les principes de traduction électromécanique utilisés sont les mêmes. Toutefois, alors que les haut-parleurs courants utilisent tous le principe électrodynamique, c'est le principe électromagnétique qui est le plus répandu dans le domaine des écouteurs ; c'est en particulier le cas des écouteurs téléphoniques classiques. Ce choix a été dicté jusqu'à présent par des considérations de simplicité de fabrication, de robustesse et de prix de revient. Néanmoins, les autres principes, et en particulier le principe électrodynamique, sont de plus en plus fréquemment utilisés, notamment dès que l'on recherche une certaine qualité. Enfin, dans le domaine de la très haute fidélité, ce principe électrodynamique est lui-même supplanté par le principe électrostatique pour les écouteurs de grande qualité.
L'écouteur étant couplé directement à l'oreille, on peut considérer en première approximation, et dans une très large gamme de fréquences, que l'onde acoustique émise et l'onde reçue par le tympan ont même amplitude : il n'y a pas d'affaiblissement de propagation. Aussi la puissance acoustique requise de l'écouteur est-elle dérisoire, contrairement à ce qui se passe dans le cas des haut-parleurs. De même, les problèmes de directivité ne se posent évidemment pas. Par contre, pour les écouteurs tout comme pour les haut-parleurs, c'est la restitution correcte des fréquences basses qui pose un des problèmes les plus délicats. Ici, ce n'est plus à proprement parler l'effet de « doublet » qui est à craindre, mais la diminution du couplage lorsque la fréquence décroît. Les fuites inévitables dans la cavité formée par l'écouteur et le pavillon de l'oreille introduisent en effet une perte qui croît très vite lorsque la fréquence diminue, ce qui se traduit par un affaiblissement des fréquences basses et une augmentation de la distorsion à ces fréquences. Dans le cas des écouteurs de qualité, on y remédie en maintenant un couplage suffisant à l'aide de joints souples qui, appliqués contre le pavillon de l'oreille avec une certaine pression, colmatent les fuites.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Éric de LAMARE : ingénieur en chef à télédiffusion de France, chef du département Image et son à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications
Classification
Médias
Autres références
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
Électroacoustique et acousmatique s'opposent donc ou se distinguent comme registre de jeu et registre d'écoute, comme faire et entendre, bref, comme fonctions musicales. Extension du domaine instrumental, le potentiel électroacoustique fournit de nouvelles sources, de nouveaux modes d'énergie,... -
BELL ALEXANDER GRAHAM (1847-1922)
- Écrit par Bruno JACOMY et Jacques MÉRAND
- 899 mots
- 1 média
La transmission électrique des sons, que le chercheur en électromagnétisme américain Charles Grafton Page (1812-1868) avait décrite en 1837, avait été expérimentée par l’inventeur et scientifique allemand Johann Philipp Reis (1835-1874), dans les années 1860. Mais l'appareil de Reis ne transmettait... -
ENREGISTREMENT
- Écrit par Michel CALMET
- 11 310 mots
- 28 médias
Une tige filetée déplace lentement le graveur vers le centre du disque, la pointedu burin décrivant un rayon du disque. C'est la combinaison de ces deux mouvements (rotation du disque et translation radiale du burin) qui donne naissance au sillon en spirale. La vitesse d'exploration du sillon (V = ΩR,... -
MUSIQUE CONTEMPORAINE - Les musiques électro-acoustiques
- Écrit par André-Pierre BOESWILLWALD
- 4 304 mots
- 2 médias
L' électro-acoustique est l'ensemble des techniques d'application de l'électricité ou de l'électronique au domaine de l'acoustique, et les termes de musique électro-acoustique désignent, globalement, tout phénomène de caractère musical qui utilise ces techniques dans...
Voir aussi
- MEMBRANES VIBRANTES
- ÉLECTROSTATIQUE
- RÉSONATEUR, physique
- RÉSISTANCE, physique
- RÉVERBÉRATION, acoustique
- CONDENSATEUR, électricité
- INDUCTANCE, électricité
- HAUTE FIDÉLITÉ
- MONOPHONIE
- INERTANCE, acoustique
- HAUT-PARLEUR
- MICROPHONE
- CAPTEURS
- TRANSDUCTEURS
- STÉRÉOPHONIE
- CAPACITANCE, physique
- ÉCOUTEUR
- DOUBLET, physique
- BAFFLE
- DIRECTIVITÉ, radiocommunication et acoustique
- ENCEINTE ACOUSTIQUE
- PRISE DE SON
- BESSEL FONCTIONS DE
- PAVILLON, électro-acoustique
- ÉNERGIE CONVERSION D'
- FORCE ÉLECTROMOTRICE
- ÉLECTRONIQUE, science et technique
- ÉLECTRODYNAMIQUES APPAREILS
- LONGUEUR D'ONDE
- PRESSION ACOUSTIQUE
- ACOUSTIQUE PHYSIQUE
- ÉCHO