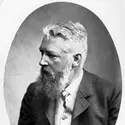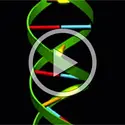ÉLECTROPHORÈSE
Article modifié le
L'électrophorèse libre
Mesure de la mobilité électrophorétique
La mesure de la mobilité électrophorétique (vitesse de déplacement d'une particule ou d'une macromolécule, dans un liquide donné à une température donnée, sous l'effet d'un champ électrique unité) peut s'effectuer par observation des particules sous microscope si les particules sont visibles à l'aide de cet appareil, au moins sous éclairage ultramicroscopique ; si les particules sont invisibles au microscope (macromolécules en solution par exemple), on observe par des moyens optiques appropriés le déplacement dans le champ d'une frontière initialement créée entre la solution colloïdale et le solvant pur : la vitesse de déplacement de cette frontière est celle des macromolécules.
Mesures sous microscope
Ces mesures, effectuées dans des canaux très fins, se compliquent du fait de la superposition de deux phénomènes : l'électrophorèse (déplacement des particules par rapport au liquide) et l'électro-osmose (déplacement du liquide le long des parois du canal).
On opère souvent selon la méthode d' Ellis : deux petits récipients communiquent par un « canal capillaire » long de quelques centimètres, généralement de section rectangulaire et de très faible épaisseur. La cellule est complètement remplie de la suspension à étudier ; on introduit dans les petits récipients des électrodes montées sur des bouchons qui assurent la fermeture étanche de la cellule.
Une différence de potentiel électrique connue est établie entre les électrodes : la valeur du champ électrique qui règne dans le canal peut être déduite de cette différence de potentiel ou, parfois, contrôlée grâce à une paire d'électrodes-sondes placées aux extrémités du canal. Dans ce champ électrique, le liquide de suspension est entraîné par électro-osmose le long des parois, mais, comme la cellule est close, ce liquide reflue en sens inverse dans la portion axiale du canal. Dans le cas d'un canal de section rectangulaire et de très faible épaisseur, les lois de l'hydrodynamique montrent que les vitesses du liquide par rapport aux grandes parois sont représentées, en fonction de la distance à l'une de ces parois, par un arc de parabole et qu'il existe deux plans parallèles aux grandes parois (plans stationnaires) au niveau desquels le liquide reste immobile ; les distances de ces plans à l'une des grandes parois du canal sont approximativement égales à 21 p. 100 et à 79 p. 100 de l'épaisseur du canal. Si l'on met un microscope exactement au point sur l'un des deux plans stationnaires, la vitesse directement mesurée sur les particules visibles avec netteté est leur vitesse d'électrophorèse.
La mobilité électrophorétique s'obtient en divisant la vitesse d'électrophorèse par la valeur du champ électrique dans le canal.
Mesures de la mobilité de macromolécules en solution
On utilise fréquemment un appareil de type Tiselius, où l'épaisseur des canaux des cellules est de l'ordre de plusieurs millimètres.
La cellule, soigneusement thermostatée, constitue, en position de mesure, un tube en U dans lequel sont superposés la solution macromoléculaire à étudier et son solvant (par exemple une solution de protéine dans un tampon et le tampon pur) ; la solution de plus forte densité (en général la solution macromoléculaire) doit être placée au-dessous de la solution de plus faible densité. À leur partie supérieure, les deux branches du tube en U communiquent avec des récipients contenant les électrodes. Dans une portion verticale de chacune des branches du tube en U, on crée, immédiatement avant de faire passer le courant électrique, une frontière aussi nette que possible entre la solution et son solvant. Il existe plusieurs techniques pour créer ces frontières précises. Dans l'appareil de Tiselius, le tube en U est sectionné en cinq tronçons, dont deux tronçons verticaux solidaires l'un de l'autre, formant un bloc qui peut glisser comme un tiroir aux joints parfaitement étanches entre la portion inférieure du tube en U et le bloc constitué par les deux portions supérieures ; la portion inférieure, indépendamment, peut aussi glisser le long de la base du « tiroir » médian. Grâce à un jeu convenable des parties mobiles, on emplit d'abord la portion inférieure du tube de solution, puis l'un des tronçons médians de tampon pur et l'autre de solution, enfin les branches supérieures de tampon pur ; on pousse alors les tiroirs de façon à reconstituer le tube en U ; puis, en déplaçant le liquide dans le tube, on amène les deux frontières à un niveau où leur examen optique est possible, c'est-à-dire dans les tronçons médians. S'il n'existe en solution qu'une seule espèce macromoléculaire, ou si les mobilités de toutes les espèces présentes sont de même signe dans les conditions de l'expérience, un champ électrique donné déplacera l'une des frontières vers le haut (branche ascendante), l'autre vers le bas (branche descendante) ; en même temps, les frontières perdent de leur netteté initiale en raison de la diffusion. Dans d'autres types d'appareils, on crée la frontière par aspiration latérale.
Le déplacement de la frontière peut s'observer directement si la macromolécule est colorée (hémoglobine par exemple) mais, dans le cas général, on utilise divers procédés optiques (interférométrie, dispositif de Philpot-Svensson) reposant sur la variation d'indice de réfraction de la solution macromoléculaire avec sa concentration, qui permettent de suivre le déplacement du plan où le gradient est maximal ; ces procédés sont analogues à ceux que l'on emploie pour suivre un déplacement de frontière provoqué par ultracentrifugation.
Si la solution contient plusieurs types de macromolécules, de mobilités différentes, la frontière initiale se résout en général en plusieurs frontières qui se déplacent avec des vitesses différentes.
Remarquons que l'électro-osmose le long des parois de la cellule ne déforme pratiquement pas l'horizontalité des zones frontières dans les canaux verticaux et de large section des appareils de ce type, à condition toutefois qu'il y ait entre la solution et son solvant une différence de densité suffisante pour que les effets hydrostatiques rétablissent à chaque instant cette horizontalité.
La figure représente un diagramme d'électrophorèse obtenu à l'aide du dispositif Philpot-Svensson, relatif au sérum sanguin humain.
Ordre de grandeur des mobilités électrophorétiques
Qu'il s'agisse de la mobilité des particules visibles au microscope, de particules submicroscopiques, de micelles d'agents de surface, de macromolécules en solution, ou même de bactéries, les valeurs des mobilités en solution aqueuse sont le plus souvent de l'ordre de quelques microns par seconde dans un champ d'un volt par centimètre ; cet ordre de grandeur est le même que celui des mobilités des « petits ions » des électrolytes minéraux comme l'ion Na+ ou l'ion Cl-.
D'une façon générale, la mobilité électrophorétique diminue en valeur absolue quand la concentration saline de la solution augmente.
S'il s'agit de macromolécules amphotères (c'est-à-dire portant des groupes acides et des groupes amines), comme les protéines, la mobilité varie avec le pH de la solution : nulle à un pH caractéristique de l'espèce moléculaire considérée, appelé « point isoélectrique » (pHi), elle est négative – c'est-à-dire que la molécule migre vers l'électrode positive – lorsque le pH est supérieur au pHi, positive lorsque le pH est inférieur au pHi.
Applications
Les mesures de mobilité électrophorétique des particules en suspension servent principalement à des recherches fondamentales concernant la charge électrique des particules ; elles peuvent s'appliquer à la prévision de la stabilité des suspensions colloïdales.
La mobilité de particules de silice couvertes d'une couche d'adsorption d'une protéine donnée est pratiquement égale à celle de la molécule elle-même, placée dans les mêmes conditions de pH (Abramson).
Signalons aussi certains usages de l'électrophorèse en bactériologie. Des espèces bactériennes différentes peuvent ainsi être séparées si leurs mobilités électrophorétiques sont assez différentes.
L'électrophorèse des macromolécules en solution est employée souvent à des fins analytiques et sert à déceler dans une solution protéique (ou dans une solution de polyélectrolytes en général) l'existence de plusieurs espèces de mobilités différentes, à identifier ces espèces grâce à la valeur de leur mobilité dans un tampon de pH donné, à doser approximativement chacune d'elles. Dans les appareils destinés à l'électrophorèse préparative, on peut séparer en quantité notable une espèce protéique de plusieurs autres, par exemple en se plaçant à un pH intermédiaire entre le point isoélectrique de l'espèce à séparer et ceux des autres espèces : les molécules de l'espèce à séparer migrent alors en sens inverse des autres.
Dans une solution où l'on a créé un gradient de densité vertical à l'aide d'un soluté non-électrolyte (saccharose par exemple), une espèce macromoléculaire donnée, sous l'action d'un champ électrique approprié, s'immobilisera à un niveau où l'effet électrique sera compensé par un effet hydrostatique. On réalise ainsi des séparations d'espèces macromoléculaires par zones.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean GUASTALLA : Directeur de Recherche honoraire au CNRS
- Jean MORETTI : maître de conférence à l'université de Montpellier
- Jean SALVINIEN : Professeur honoraire à la Faculté des Sciences de Montpellier.
Classification
Médias
Autres références
-
ÉLECTROPHORÈSE EN CHAMP PULSÉ
- Écrit par Jean-Luc GUESDON
- 263 mots
La technique d'électrophorèse classique en gel d'agarose ou de polyacrylamide permet de séparer des fragments d'ADN suivant leur taille. Sur ces gels constitués d'un réseau désorganisé de longues fibres, on dépose l'ADN dont les molécules sont chargées négativement. Soumises à...
-
ANALYTIQUE CHIMIE
- Écrit par Alain BERTHOD et Jérôme RANDON
- 8 890 mots
- 4 médias
Les espèces chargées, en solution, peuvent être séparées grâce à leurs différences de mobilité sous l'effet d'un champ électrique : en fonction de la charge et de la masse de la molécule, celle-ci se déplacera plus ou moins vite dans la solution. L'électrophorèse capillaire... -
GÉNÉTIQUE
- Écrit par Axel KAHN , Philippe L'HÉRITIER et Marguerite PICARD
- 25 881 mots
- 31 médias
...l'aide d'une enzyme de restriction, celui ou ceux contenant la séquence nucléotidique recherchée. Les fragments d'ADN sont séparés selon leur taille par électrophorèse, c'est-à-dire par migration dans un champ électrique au travers d'un gel jouant un rôle de tamis moléculaire. Une autre technique, consistant... -
HÉMOGLOBINOPATHIES
- Écrit par Michel COHEN-SOLAL et Jean-Claude DREYFUS
- 3 854 mots
- 6 médias
Laséparation des hémoglobines est habituellement fondée sur les propriétés de la charge électrique de la globine. Celle-ci, comme toutes les protéines, est un ampholyte ; les fonctions acides et bases libres portées par les acides aminés de la protéine sont plus ou moins ionisées selon le pH du milieu.... -
IMMUNOCHIMIE
- Écrit par Joseph ALOUF
- 9 360 mots
- 6 médias
Dans un gel aqueux transparent, on fait migrer parélectrophorèse les constituants du liquide à examiner. On fait ensuite diffuser perpendiculairement à l'axe de migration un immunsérum contenant des anticorps précipitant les constituants (antigènes) du mélange. Lorsque ces anticorps rencontrent les... - Afficher les 14 références
Voir aussi