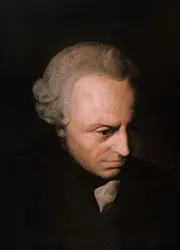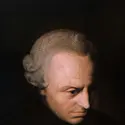KANT EMMANUEL (1724-1804)
Article modifié le
La meilleure image que l'on puisse proposer de la nouveauté que Kant introduit dans l'histoire de la pensée et qui le promeut au rang du petit nombre des très grands philosophes de tous les temps, c'est peut-être celle à laquelle il songea lui-même pour qualifier le changement de méthode dont il faisait l'essai en philosophie : celle de la révolution opérée par Copernic en astronomie lorsqu'il supposa que le centre immobile privilégié pour l'observateur pourrait ne plus être la Terre mais le Soleil. Car dans les deux cas on peut bien dire que la modeste hypothèse d'un changement de point de vue destiné à tirer la connaissance d'embarras et à procurer une conception plus satisfaisante des choses dans le domaine limité d'une activité particulière de la pensée s'est trouvée dépassée de très loin par le nombre et l'importance des conséquences qu'elle mit au jour, puisque c'est toute la façon de penser des hommes qui s'en trouva finalement elle-même changée.
Qu'une transformation aussi profonde ait été apportée par un penseur qui se sentait lui-même appartenir pleinement à son temps, à ce siècle des Lumières auxquelles il ne cessa de vouloir contribuer, peut s'expliquer par le fait qu'il le comprit radicalement comme « siècle de la Critique à laquelle il faut que tout se soumette ». Car, en se proposant de faire de cette critique une science, afin précisément de conférer un statut scientifique à cette connaissance des fins de la raison humaine dont le passé de la philosophie lui léguait le projet sous le nom de métaphysique, il fut amené à procurer à la pensée un point d'appui tout à fait nouveau pour sa réflexion. Si la raison peut être à la fois le sujet et l'objet de la critique, c'est qu'elle est ce pouvoir spécifique et parfaitement original que possède la pensée d'opposer à ce qui est ce qui doit être, d'imprimer à la pure et simple existence, qu'elle ne crée pas et que seule l'expérience peut lui révéler, le sceau d'une nécessité et d'une universalité qui expriment son exigence normative. L'acte propre de la pensée étant le jugement qui décide de toute chose comme d'un cas relevant d'une règle, l'objet propre de la philosophie comme connaissance de la raison humaine, ce sont les conditions nécessaires à l'exercice légitime de sa propre normativité.
Dès lors, pour la première fois dans l'histoire, la philosophie se met à part de toutes les autres formes de pensée et de savoir. La réflexion qui la caractérise prend la forme d'un reflux de la pensée sur ses propres sources vives, qui lui permet de se ressaisir comme l'origine du sens qu'elle confère à ses objets et à ses œuvres. Loin que les réponses à ses questions soient déjà données quelque part dans l'au-delà d'une transcendance plus ou moins inaccessible, elles ne se découvrent que progressivement dans leurs liens aux problèmes que l'esprit peut et doit se proposer comme autant de tâches à accomplir. Assurément, comme toute connaissance digne de ce nom, la philosophie vise bien cette valeur de vérité qui se définit par l'accord de la pensée avec son objet, mais son objet à elle, c'est le critère de cette vérité qui ne qualifie pas seulement les solutions, mais les problèmes eux-mêmes. Le lieu qui lui revient en propre ne se situe « ni dans le ciel, ni sur la terre » : l'homme est bien « enfant de la terre », il ne peut s'en détacher ni s'exalter jusqu'à des visions supraterrestres et il ne saurait être tout entier raison ; mais il y participe, et elle se manifeste assez irrécusablement en lui pour qu'il ne puisse faire le plein de son être d'homme qu'en sachant se soumettre à ce qu'elle exige de lui : c'est à ce prix que le monde et sa propre destinée peuvent prendre un sens.
Avec Kant, la philosophie a accédé à la conscience d'elle-même en cherchant son centre de gravité dans cette raison finie, caractéristique de l'homme, qui ne peut se montrer raisonnable que juste autant qu'il veut l'être, ni trouver sa liberté autrement qu'en se soumettant à ce que la raison exige de lui. C'est sans doute pour avoir su formuler dans la rigueur de ces termes tout nouveaux la question dont Platon avait déjà fait l'objet de la philosophie : qu'est-ce que l'homme ? que convient-il à sa nature de faire ou de subir autrement que les autres êtres ? que la pensée de Kant continue de vivre dans l'esprit de tous ceux qui réfléchissent après lui.
Une vie d'enseignant
La longue vie d'Emmanuel Kant fut tout entière celle d'un professeur allemand d'université, consacrée à l'enseignement et à la recherche, sans autres événements marquants que la parution d'œuvres savantes, dont quelques-unes parvinrent, au terme d'une méditation poursuivie avec autant de ténacité que de rigueur, à ouvrir des voies toutes nouvelles à la spéculation philosophique.
Les origines
Kant ne s'éloigna jamais de Königsberg, sa ville natale. Il était le quatrième d'une famille de onze enfants, extrêmement modeste. Son père par son exemplaire probité d'artisan sellier, sa mère surtout par la sincérité de sentiments piétistes qui donnaient à sa foi un tour proprement moral éveillèrent en lui une conscience exigeante et scrupuleuse, et plus spécialement une horreur du mensonge et de la mauvaise foi : il manifesta tant d'originalité et d'obstination dans sa façon de les déloger du cœur même de la pensée spéculative qu'on peut finir par y reconnaître une des plus éminentes caractéristiques de son génie philosophique.
Les études
Avant de mourir prématurément en 1737, cette mère remarquable avait dû à l'amitié du pasteur Albert Schultz, professeur à l'université, de pouvoir faire entrer son fils, en 1732, au Collegium Fredericianum, dont il était le directeur. Si Kant rendit plus tard hommage à la solide culture latine qu'il y reçut, il dit aussi quel souvenir « de terreur et d'angoisse » lui laissa cet « esclavage de jeunesse », qui lui inspira une répulsion définitive à l'endroit de toutes les manifestations extérieures de la religion. Aussi, lorsqu'en 1740 il devint étudiant à l'université, il ne semble pas qu'il montra beaucoup de zèle à suivre les cours de théologie dogmatique professés par Schultz. Il lui préféra Martin Knutzen, qui était pourtant le disciple de ce dernier et ne se montrait pas moins soucieux que lui de concilier le piétisme en matière morale et religieuse avec le rationalisme philosophique de Wolf, inspiré de celui de Leibniz et mis, pour les besoins de l'enseignement, sous une forme systématique selon le modèle mathématique ; du moins inclinait-il davantage à la philosophie qu'à la théologie et possédait-il une réelle compétence scientifique. Apparemment, ce que Kant retint avant tout de ses leçons, c'est une bonne initiation à la science de Newton, qui ne cessa jamais de nourrir sa réflexion. Pourtant, lors même qu'il se fut complètement détaché du dogmatisme de « l'illustre Wolf », il ne manqua jamais de louer sa « méthode sévère », son souci exigeant de définir, démontrer, ordonner, où il voyait le modèle de toute spéculation philosophique en ce qu'elle a de nécessairement scientifique et scolastique. Quant au piétisme, s'il rejette l'arrogance dont ses adeptes faisaient montre en oubliant qu'ils étaient « simples fils de la terre », c'est qu'il sut mieux qu'eux se garder strictement de cette exaltation mystique (Schwärmerei) qu'ils avaient prétendu proscrire ; mais il ne se montra pas moins sensible qu'eux à l'aspect de contrainte qui s'attache irréductiblement à la loi, et, surtout, il rejoignit finalement leur conviction que l'authentique réalité du mal obligeait l'homme à se faire autre plutôt que de se flatter de devenir meilleur.
Le professeur
En 1746, la mort de son père le privant de toute ressource, il dut, pendant près de dix ans, devenir précepteur dans diverses familles qui résidaient aux environs de Königsberg, en particulier chez la comtesse de Keyserling, où il acquit un goût durable pour les raffinements de la vie mondaine et la conversation spirituelle, qui en fit plus tard un invité fort recherché, des dames en particulier, dans la bonne société de Königsberg.
Devenu privatdozent en 1755 grâce à une Dissertation sur les premiers principes de la connaissance métaphysique, il commença une longue carrière d'enseignement à laquelle il ne devait mettre un terme que plus de quarante ans plus tard, en 1797 ; enseignement aussi copieux (jusqu'à cinq heures par jour) que divers (sciences, logique, métaphysique, théologie et droits naturels, anthropologie, pédagogie, géographie physique), et qu'il associa toujours étroitement à sa recherche personnelle. C'est à l'épreuve de ses leçons qu'il mit à jour les insuffisances de la métaphysique wolfienne, et c'est en partie au moins pour avoir eu d'abord à l'enseigner qu'il en vint à souhaiter donner à la métaphysique le caractère d'une connaissance scientifique.
Au bout de quinze ans vécus dans la gêne matérielle, il devint enfin professeur titulaire à l'âge de quarante-six ans lorsqu'il eut présenté en 1770 une dissertation en latin sur la forme et les principes du monde sensible et du monde intelligible. Si la carrière universitaire devait finalement lui valoir les plus grands honneurs qui peuvent s'y attacher, elle ne fut pas moins tardive que l'accession à la pleine originalité de sa pensée philosophique.
En effet, plus de dix ans s'écoulèrent encore avant qu'il pût parvenir à récolter le fruit des efforts opiniâtres de sa recherche philosophique, et il approchait de la soixantaine lorsqu'il publia la première grande œuvre qui allait le rendre illustre et lui assurer une gloire durable : la Critique de la raison pure(Kritik der reinen Vernunft, 1781). Aussi, lorsqu'il publie en 1790 la troisième Critique, celle de la faculté de juger (Kritik der Urteilskraft), la Critique de la raison pratique (Kritik der praktischen Vernunft) étant parue en 1788, le voit-on se déclarer pressé de gagner sur son âge le temps qui pouvait encore être favorable à son travail.
De constitution chétive, sa santé et sa longévité furent vraiment son œuvre comme il se plut à le dire. L'emploi de son temps était minutieusement et rigoureusement réglé : seules la lecture d'une nouvelle œuvre de Rousseau ou l'annonce des grands événements de la Révolution française, dont les débuts firent naître en lui une grande espérance, purent changer l'heure et le cours immuables de sa promenade quotidienne. Il laissait place à d'immenses lectures, non seulement les mémoires scientifiques reçus par l'Académie de Berlin mais, de façon générale, tout ce qui se publiait d'important en Europe, et aussi à des dîners réunissant ses nombreux amis, choisis dans les milieux les plus divers, où il montrait un enjouement conquis sur un tempérament naturellement mélancolique. Le seul événement notable de ses dernières années fut les démêlés qu'il connut avec la censure de Frédéric-Guillaume II en 1793 lorsqu'il publia La Religion dans les limites de la simple raison (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft). Mais, dès 1798, il s'estima délié par la mort du roi de la promesse qu'il lui avait faite de ne plus traiter de questions religieuses, auxquelles il revint dans Le Conflit des facultés (Der Streit der Fakultäten). Il employa les dernières années de sa vie à tenter d'achever sa métaphysique de la nature en en raccordant les Premiers Principes (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft), que la première Critique lui avait permis d'énoncer dès 1786, avec la physique. Mais il sentait ses forces le trahir et il mourut en prononçant les mots : « Es ist gut. » (C'est bien.)
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis GUILLERMIT : professeur à l'université de Provence
Classification
Média
Autres références
-
CRITIQUE DE LA FACULTÉ DE JUGER, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 1 040 mots
La Critique de la faculté de juger (Kritik der Urteilskraft, 1790) est la troisième et dernière des Critiques d'Emmanuel Kant (1724-1804). Elle vient après la Critique de la raison pure (1781) et la Critique de la raison pratique (1786). Il ne s'agit pas tant d'ajouter au domaine des sciences...
-
CRITIQUE DE LA RAISON PURE, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 961 mots
- 1 média
Dans la Préface à la première édition de la Critique de la raison pure (1781), Emmanuel Kant (1724-1804) établit un parallèle célèbre entre les progrès des sciences exactes et la confusion qui règne dans la « métaphysique », pourtant la plus ancienne et longtemps la plus prestigieuse des...
-
FONDEMENTS DE LA MÉTAPHYSIQUE DES MŒURS, Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 861 mots
En 1781, la Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant (1724-1804) marquait nettement la différence de statut entre les sciences exactes et les sciences humaines. Elle soulignait aussi que toute science se décompose en connaissance a priori (ce que Kant appelle, en un sens technique, « métaphysique...
-
QU'EST-CE QUE LES LUMIÈRES ? Emmanuel Kant - Fiche de lecture
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 1 136 mots
Publié en 1784 dans la BerlinischeMonatsschrift, soit trois ans après la Critique de la raison pure (1781) et quatre ans avant la Critique de la raison pratique (1788), Qu’est-ce que les Lumières ? peut être considéré comme le bouquet du feu d’artifice de cette période qualifiée d’ « ...
-
ABSTRAIT ART
- Écrit par Denys RIOUT
- 6 718 mots
- 2 médias
LorsqueKant oppose la « beauté adhérente », déterminée par la perfection de ce que doit être l'objet dans lequel elle se manifeste, à la « beauté libre », sans concept, il prend pour exemple de cette dernière non seulement les fleurs, le colibri, l'oiseau de paradis, les crustacés... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
La profonde nouveauté de Kant dans l'histoire de la philosophie, le « renversement » ou la « révolution copernicienne », consiste en sa conception architectonique de la pensée, c'est-à-dire en ce que les termes (concepts) et les choses (Sachen) de la pensée dépendent, dans leur... -
ANALYTIQUE PROPOSITION
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 459 mots
Le mot « analytique » a au moins trois sens.
1. Au sens large, une proposition est dite analytique si elle est vraie en vertu de la signification des termes qu'elle contient. La simple considération des significations suffit à donner l'assurance de sa vérité. À ce sens se rattachent le...
-
ANTINOMIE
- Écrit par Françoise ARMENGAUD
- 372 mots
N'est pas antinomie n'importe quelle contradiction, mais seulement celle qui joue entre des lois — soit des lois juridiques ou théologiques, soit des lois de la raison (Kant), soit des thèses déduites de lois logiques (théorie des ensembles) —, ni n'importe quel paradoxe...
- Afficher les 162 références
Voir aussi
- POSSIBILITÉ
- ONTOLOGIQUE PREUVE
- IMPÉRATIF CATÉGORIQUE
- LOI, éthique
- POSTULAT
- CHOSE-EN-SOI
- KNUTZEN MARTIN (1713-1751)
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- INTENTION, philosophie
- IDÉE
- PRINCIPE
- HISTOIRE PHILOSOPHIE DE L'
- NATURE IDÉE DE
- CRITIQUE, philosophie
- RESPECT
- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- A PRIORI CONNAISSANCE
- TRANSCENDANTAL, philosophie