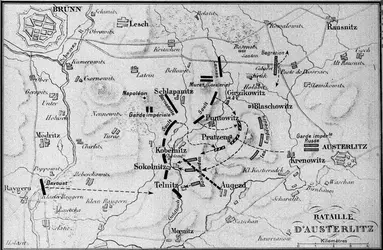EMPIRE (PREMIER)
Article modifié le
Le grand empire
Considérons l'Europe vers 1810. La domination napoléonienne s'étend non seulement à la France proprement dite, mais à la Belgique transformée en départements dès la Révolution, à la Hollande annexée en 1810, aux villes de la Hanse, Brême et Hambourg, à la rive gauche du Rhin, à l'Italie du Nord, à Rome et aux Provinces Illyriennes. Napoléon est médiateur de la Confédération helvétique et protecteur de la Confédération du Rhin. Il a pour vassaux le roi d'Espagne et le roi de Naples. En Suède va régner un maréchal d'Empire, Bernadotte, et le Danemark est un allié fidèle. Ainsi plus de la moitié de l'Europe est-elle alors placée sous l'autorité de l'empereur.
Au cœur de la politique napoléonienne, il ne faut voir ni l'insatiable ambition dénoncée par ses adversaires, ni l'esprit de famille d'où seraient sorties les royautés vassales confiées aux frères et aux sœurs, ni le mirage oriental, ni même l'idée romaine, mais le Blocus continental qui explique bien la formation du grand empire. Tous les pays vassaux, annexés ou alliés, ont dû se plier à ses exigences, et l'Europe napoléonienne apparaît avant tout comme une machine de guerre dirigée contre l'Angleterre. Devait-elle se désunir après l'effondrement de l'économie britannique ? En réalité, Napoléon, avant même la naissance du Roi de Rome, a très vite cessé de considérer son empire comme une création passagère destinée à unir un moment le continent contre « la perfide Albion ». Il a cherché à lui donner, à la manière de Rome, des bases solides. Partout fut introduit le Code civil. Des principes juridiques nouveaux (égalité sociale, liberté civile) se substituèrent à la vieille organisation féodale, mais avec des nuances.
En Italie du Nord comme en Belgique, la Révolution avait déjà aboli la féodalité. Elle disparut, le 2 août 1806, dans le royaume de Naples : les droits personnels, les banalités et les dîmes furent supprimés, mais les droits réels durent être rachetés. Le paysan étant trop pauvre pour se libérer, un large secteur du système féodal subsista dans l'Italie méridionale. Il en fut de même dans le grand-duché de Berg, où le servage fut aboli le 12 décembre 1806, mais non les droits réels déclarés rachetables. En Allemagne du Sud (à Bade et au Wurtemberg le servage avait disparu dès le xviiie siècle), le régime féodal résista victorieusement à la pénétration du droit français. Dans le grand-duché de Varsovie, la Constitution du 22 juillet 1807 avait aboli le servage, mais les droits seigneuriaux persistèrent. La féodalité n'a donc pas été entièrement détruite. Les institutions françaises furent introduites dans les pays vassaux ou soumis : préfectures établies en Espagne en 1809, justices de paix en Pologne, système fiscal d'inspiration française en Allemagne. Là encore, l'emprise ne fut pas toujours durable.
La route devint, comme dans l'Empire romain, le principal facteur d'unité. En 1805, Napoléon écrivait : « De tous les chemins ou routes, ceux qui tendent à réunir l'Italie à la France sont les plus politiques. » Le décret du 16 décembre 1811 établit le classement des quatorze routes de première classe qui rayonnent de Paris vers les parties les plus reculées de l'Empire : route no 2 (Paris-Bruxelles-Anvers-Amsterdam), route no 3 (Paris-Hambourg), route no 6 (Paris-Rome par le Simplon), route no 7 (Paris-Turin par le mont Cenis), route no 11 (Paris-Bayonne et l'Espagne).
Les grands travaux changèrent le visage des vieilles capitales ; l'œuvre du préfet Tournon, à Rome, fut considérable : assèchement des marais Pontins, pont sur la via Appia, aménagement du Tibre, progrès de l'hygiène publique.
Au sein de la Grande Armée s'opéraient également des brassages de population. Ne va-t-on pas désigner sous le nom d'armée des vingt nations les forces qui s'engageront, en 1812, dans les steppes de Russie ?
Napoléon alla même jusqu'à créer un ordre qui remplaçait les anciennes décorations de l'Europe et qui symbolisait la fusion dans l'Empire de pays différents : ce fut l'ordre impérial de la Réunion, établi par décret le 18 octobre 1811. Dans les premières nominations, on compte au sommet de la hiérarchie trente Français, quarante Italiens et quatre-vingt-dix Hollandais.
Les arts eux-mêmes n'échappent pas à cette œuvre d'unification. C'est au Louvre qu'il faut désormais venir admirer les Rubens d'Anvers ou les chefs-d'œuvre des collections italiennes, allemandes ou espagnoles. Vivant-Denon fait de ce musée, avec le butin des campagnes victorieuses, le plus fantastique ensemble de toiles et de sculptures européennes. Il n'est pas jusqu'aux archives des pays vaincus dont le transfert n'ait été envisagé à Paris. En outre le « style Empire », surtout le mobilier (Jacob et les artisans du faubourg Saint-Antoine), étend son influence en Allemagne, en Italie et même en Espagne. Certains artistes, comme David (qui s'institue dictateur de la peinture aussi bien que Fontaine régente l'architecture) ou comme Isabey, participent à la propagande impériale. Dans les salons, la peinture guerrière l'emporte. À l'Opéra, le succès va au Triomphe de Trajan de Lesueur, apologie à peine déguisée de l'empereur. La vision de la littérature s'élargit sous l'influence de Mme de Staël, passée avec les idéologues dans l'opposition. Si les grands courants d'idées furent étouffés, il n'en fut pas de même des sciences. Lacépède fut grand chancelier de la Légion d'honneur, Chaptal ministre de l'Intérieur, Monge et Berthollet entrèrent au Sénat.
De cet empire fortement centralisé, Paris devient la capitale. Sa population s'accroît en quinze ans de cent soixante mille habitants, mais l'aspect extérieur de la ville ne se modifie guère (arc du Carrousel, colonne Vendôme, des fontaines, quelques ponts et quais sont toutefois à mettre au crédit de l'Empire) malgré les grands projets agités par Napoléon.
Le grand empire était-il viable ? Peut-être ; si Napoléon n'avait modifié en 1810 la conception initiale du Blocus. N'ayant pu décourager la contrebande avec l'Angleterre, Napoléon se fit lui-même contrebandier. Il autorisa l'importation de marchandises anglaises par le système des licences. Il percevait sur l'entrée de ces marchandises des droits élevés qui lui permirent de financer l'expédition de Russie. Mais ce commerce, au demeurant limité, avec l'Angleterre fut exclusivement réservé aux ports français qui redistribuaient ensuite au reste de l'Europe les produits importés de Grande-Bretagne. Tout commerce avec Londres restait en revanche interdit aux vassaux et alliés de Napoléon. Bien plus, celui-ci renforça dans ces pays la lutte contre la contrebande, notamment en Allemagne : des marchandises anglaises d'une valeur de plusieurs millions furent brûlées à Francfort.
L'Europe supportait déjà mal les privations que lui imposait un blocus qui ruinait par ailleurs son économie : elle le supporta encore plus difficilement quand elle vit la France s'en affranchir. En réalité, par son système des licences et par les restrictions apportées au développement industriel dans certains pays comme l'Italie, Napoléon entendait faire de l'Europe un gigantesque marché pour les commerçants et manufacturiers français. « Mon principe, affirmait-il, est la France avant tout. » Arme de guerre contre l'Angleterre, le Blocus devient, à partir de 1810, l'instrument de l'hégémonie économique de la France sur le continent.
Sans doute l'Europe n'aurait-elle pas osé se soulever si les revers militaires de Russie et d'Allemagne n'avaient affaibli le prestige de Napoléon.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean TULARD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
CONSULAT ET EMPIRE - (repères chronologiques)
- Écrit par Sylvain VENAYRE
- 187 mots
9-10 novembre 1799 Coup d'État de Bonaparte (18-Brumaire an VIII), qui est nommé consul provisoire.
17 janvier 1800 Suppression de soixante des soixante-treize journaux politiques parisiens.
15 juillet 1801 Signature du Concordat avec le pape Pie VII.
20 mai 1802 Rétablissement de l'...
-
ANTISÉMITISME
- Écrit par Esther BENBASSA
- 12 236 mots
- 9 médias
Au fil de ses victoires, Napoléon étend l'émancipation en Europe. Au niveau de l'organisation du culte, son règne ouvre une phase nouvelle. En 1808, il crée les consistoires, parallèlement aux consistoires protestants. Reste que d'un point de vue juridique, la période napoléonienne constitue une régression.... -
ARMÉE - Typologie historique
- Écrit par Paul DEVAUTOUR et Encyclopædia Universalis
- 12 929 mots
- 21 médias
...Les armées de l'Europe coalisée contre la Révolution se modèleront sur l'image française, comme sur celle de Frédéric, quelques décennies plus tôt. Napoléon Bonaparte, Premier consul de la République, puis empereur, remanie l'armée, reconstitue en particulier une cavalerie, subdivisée en cavalerie... -
ARNDT ERNST MORITZ (1769-1860)
- Écrit par Lore de CHAMBURE
- 483 mots
Le nom d'Ernst Moritz Arndt est lié à l'histoire de la guerre de libération (1813). Chez Arndt, en effet, la vie et l'œuvre sont fortement tributaires des événements politiques qui agitèrent l'Allemagne du xixe siècle : pendant près de cinquante ans, il jouera un rôle...
-
AUGEREAU CHARLES PIERRE FRANÇOIS (1757-1816) maréchal d'Empire (1804) duc de Castiglione (1808)
- Écrit par Jean MASSIN
- 322 mots
L'un des seuls Parisiens d'origine parmi les généraux de la Révolution et de l'Empire. Fils d'un domestique et d'une fruitière, Augereau s'engage à dix-sept ans, puis passe dans l'armée napolitaine. En 1790, il rentre de Naples où il avait fini par devenir maître d'armes, et s'engage comme volontaire....
- Afficher les 103 références
Voir aussi
- CONFÉDÉRATION DU RHIN
- EUROPE, histoire
- AFRANCESADOS
- GRANDE ARMÉE
- MACK KARL, baron von LEIBERICH (1752-1828)
- VARSOVIE GRAND-DUCHÉ DE
- WESTPHALIE ROYAUME DE
- RUSSIE CAMPAGNE DE (1812)
- PARIS TRAITÉS DE (1814 et 1815)
- AMIENS PAIX D' (1802)
- BERG GRAND-DUCHÉ DE
- CENT-JOURS LES
- COMMUNICATION VOIES DE
- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914
- AUTRICHE, histoire jusqu'en 1945
- ESPAGNE, histoire : XVIIIe et XIXe s.
- ITALIE, histoire, de 1789 à 1870
- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914
- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914
- CHEVALIERS DE LA FOI
- LOUVRE MUSÉE DU
- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815
- ALLEMAGNE, histoire, du Moyen Âge à 1806
- PRESBOURG TRAITÉ DE (1805)
- TILSIT PAIX DE (1807)
- QUADRUPLE ALLIANCE (20 nov. 1815)
- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917
- HISTOIRE ÉCONOMIQUE