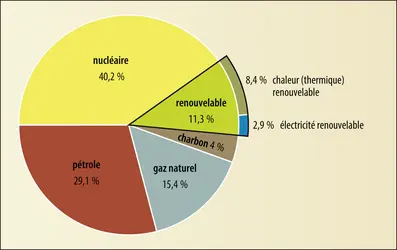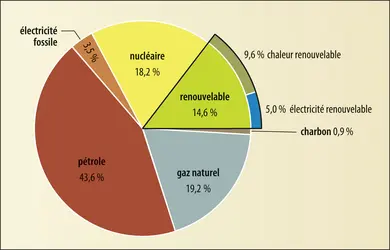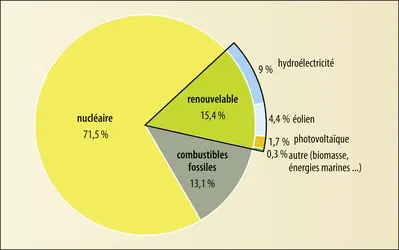- 1. Bref historique
- 2. Quelques définitions
- 3. L’origine des énergies renouvelables
- 4. Quelques notions sur l’énergie
- 5. Objectifs et ambitions des énergies renouvelables
- 6. Principales caractéristiques des énergies renouvelables
- 7. Énergies renouvelables et société
- 8. Énergies renouvelables et couverture des besoins
- 9. Bibliographie
- 10. Sites internet
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article modifié le
Quelques définitions
Un certain nombre de termes sont utilisés pour désigner les énergies renouvelables, en référence à des périmètres assez divers. Ils ne sont pas toujours neutres et reflètent souvent les intérêts des acteurs qui les ont introduits. Ainsi, l’expression « énergies vertes » met l’accent sur l’approche écologique quand celle d’« énergies propres » s’oppose aux énergies considérées comme « sales » puisque productrices de pollutions et de déchets. Celle d’« énergies décarbonées » – signifiant sans émission de dioxyde de carbone (CO2) et, donc, implicitement sans impact sur le changement climatique – permet quant à elle de parer l’énergie nucléaire des principales vertus des énergies renouvelables. On rencontre également l’expression « énergies alternatives », qui porte l’idée de changement, celle d’« énergies nouvelles », qui introduit une notion de modernité, ou bien encore celle d’« énergies durables », qui insiste sur la convergence de ces formes d’énergies avec le développement durable et les critères environnementaux, mais aussi économiques et sociaux (dont l’emploi) qui le sous-tendent.
L’expression « énergies renouvelables » semble la plus neutre. Elle repose sur la distinction qui peut être faite entre une énergie produite en prélevant une ressource sur un stock qui, à terme, s’épuisera (c’est le cas du charbon, du gaz naturel, du pétrole ainsi que de l’uranium utilisé par les réacteurs nucléaires) et une énergie issue d’un flux (d’une source) qui n’est pas affecté par ce prélèvement, par exemple le Soleil ou les marées.
Pour autant, toutes les énergies renouvelables ne sont pas systématiquement propres ni totalement décarbonées. Par exemple, le développement de la biomasse doit d’abord faire l’objet d’une attention particulière au niveau de sa production. En effet, celle-ci ne respecte pas nécessairement les meilleures pratiques culturales ou peut faire l’objet de substitution d’usage des sols et concurrencer la production alimentaire, conduire à du déboisement et avoir un impact négatif sur la biodiversité. La combustion de la biomasse, réalisée dans de mauvaises conditions ou sans dispositif de dépollution adapté, peut émettre des polluants atmosphériques comme des oxydes d’azote ou du monoxyde de carbone et des suies nuisibles à la santé. Par ailleurs, s’il est admis, par convention, que la quantité de dioxyde de carbone émise lors de la combustion de la biomasse équivaut à celle qui a été captée lors de sa croissance – ce qui conduirait à un bilan neutre –, il faut néanmoins tenir compte des émissions dues à la culture (production d’éventuels engrais, production et consommation des engins agricoles et de transport), voire à la fabrication des appareils de combustion. Tous ces éléments doivent être considérés lors de l’analyse du cycle de vie (dite aussi analyse du berceau à la tombe).
De même, la fabrication d’éoliennes ou de cellules photovoltaïques, comme de tout autre système, nécessite la mobilisation de matières premières et d’énergie qui peuvent impacter le bilan du cycle de vie. Cependant, en ce qui concerne ces technologies, le coût énergétique est rapidement amorti. Ainsi, une cellule photovoltaïque dont la durée de vie est supérieure à trente ans produira en moins de deux ans plus d’énergie que sa fabrication en nécessite.
Certaines énergies renouvelables ont une production variable et discontinue dans le temps car elles dépendent des conditions météorologiques et du cycle jour-nuit. On parle alors d’énergies intermittentes. Cette caractéristique a souvent été mise en avant comme une limite à leur développement. Qu’en est-il vraiment ? Alors que l’utilisation de la biomasse ou la géothermie permet une production continue et que les marées ont un cycle parfaitement prévisible, l’ensoleillement et le vent sont, il est vrai, sujets à des variations bien réelles. Pour autant, celles-ci ne conduisent pas nécessairement à une production en « tout ou rien ». Si la production électrique issue de l’éolien et du photovoltaïque est variable localement (au niveau d’une éolienne ou d’un toit photovoltaïque), elle peut cependant être lissée à l’échelle d’un pays et les installations peuvent être réparties sur l’ensemble du territoire. La France est soumise à trois grands régimes de vent complémentaires – correspondant à trois grandes zones géographiques : Manche-mer du Nord, façade atlantique et région méditerranéenne – et il est rare qu’il n’y ait pas de vent sur l’ensemble du territoire. Il existe également des compensations entre le vent et l’ensoleillement, ces deux sources d’énergie se complétant : il y a souvent du soleil les jours où il n’y a pas de vent lors de périodes anticycloniques et inversement en périodes dépressionnaires. Enfin, la France n’est pas isolée, des échanges d’électricité pouvant avoir lieu entre pays frontaliers. Les pics de consommation, correspondant au maximum des besoins, font l’objet de déphasage (décalage dans le temps) entre les différents pays européens (on s’éclaire plus tôt dans l’Est que dans l’Ouest, les horaires de travail varient…). Pour autant, une augmentation importante des énergies intermittentes dans la production énergétique, et tout particulièrement de l’électricité, nécessite le recours à du stockage. Pour cela, les technologies seront différentes selon la durée du stockage envisagée. Pour pallier des variations de courte durée – de quelques secondes (comme lors de passages nuageux) à quelques heures (lors de pics de consommation) –, on utilise des batteries d’accumulateurs. Si les besoins sont de l’ordre de la journée à quelques semaines, on fera appel à des centrales hydroélectriques réversibles ou stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). Enfin, le stockage intersaisonnier s’envisage en utilisant l’électricité excédentaire en été pour produire des gaz stockables (hydrogène ou méthane, par exemple) ou des hydrocarbures de synthèse à partir de la biomasse. Ces pistes font l’objet de recherches et de développements importants.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Daniel CLÉMENT : ancien directeur de la recherche et directeur scientifique adjoint de l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
Classification
Médias
Autres références
-
ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE ou ARCHITECTURE DURABLE
- Écrit par Dominique GAUZIN-MÜLLER
- 5 070 mots
- 1 média
...escaliers suffisent souvent. Un concept énergétique efficace associe ces mesures constructives à des installations optimisées, utilisant si possible des énergies renouvelables : pompes à chaleur, capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, poêle à bois, etc. Un puits canadien, appelé... -
AUSTRALIE
- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS
- 27 359 mots
- 29 médias
En plus de ces nombreux atouts énergétiques, l'Australie peut potentiellement produire en abondance del'énergie renouvelable (10 % seulement de la production en 2006) et notamment solaire. Sa production électrique est de 227 milliards de kWh. Elle est bon marché mais elle est due essentiellement à... -
AUTOMOBILE - Défis
- Écrit par Daniel BALLERINI , François de CHARENTENAY , André DOUAUD , Francis GODARD , Gérard MAEDER et Jean-Jacques PAYAN
- 11 590 mots
- 8 médias
...matières végétales qui, pour leur croissance et grâce au processus de la photosynthèse, utilisent le carbone du CO2 déjà présent dans l'atmosphère. Outre le fait qu'elle recycle le CO2, cette biomasse présente d'autres atouts majeurs : elle est renouvelable, produite localement et présente le... -
BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS
- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Anthony SIMON
- 6 509 mots
- 10 médias
...l’envolée des prix des hydrocarbures et la nécessité de plus en plus reconnue, par les citoyens comme par les États, de mieux gérer l’environnement et de promouvoir des énergies renouvelables ont été à l’origine d’une relance de la production de biocarburants. À l’échelle mondiale, la production de biocarburants... - Afficher les 22 références
Voir aussi
- AÉROGÉNÉRATEUR
- ÉNERGIE ÉOLIENNE
- BIOGAZ
- ÉNERGIE SOLAIRE
- HYDROÉLECTRICITÉ
- RÉSEAU, électricité
- CENTRALE ÉLECTRIQUE
- MARÉMOTRICE USINE
- CENTRALE THERMIQUE
- RAYONNEMENT SOLAIRE
- FLUX GÉOTHERMIQUE
- GÉOTHERMIE
- EAUX SOUTERRAINES
- PHOTOPILES SOLAIRES ou CELLULES SOLAIRES ou CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
- ÉNERGIE SOURCES D'
- AQUIFÈRE
- CLIMATS
- BIOMASSE
- HOULE
- FLUIDE CALOPORTEUR
- PHOTOVOLTAÏQUE EFFET
- VAGUES
- SALINITÉ
- ÉNERGIE NUCLÉAIRE
- ÉNERGIE CONVERSION D'
- ÉCLAIRAGE
- EUROPE, politique et économie
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- CHAUFFAGE
- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
- GAZ À EFFET DE SERRE
- CONSOMMATEURS, écologie
- FRANCE, économie
- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'
- CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE
- ÉNERGIE THERMIQUE
- GAZ DE SYNTHÈSE
- ÉNERGIE CINÉTIQUE
- OSMOSE, physique
- ÉOLIENNE
- ÉNERGIE PRODUCTION D'
- ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
- ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- PHOTOVOLTAÏQUE
- ÉNERGIE MARÉMOTRICE
- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- SOURCE CHAUDE, géologie
- COP (Conférence des Parties)
- ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT (2015)