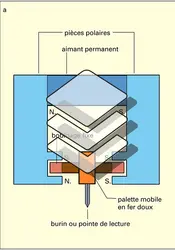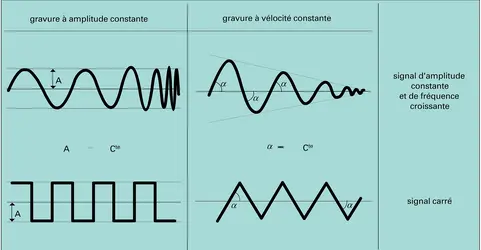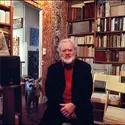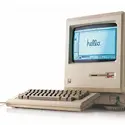ENREGISTREMENT
Article modifié le
L'enregistrement numérique du son
La numérisation du son transforme celui-ci en une succession de 0 et de 1. Il perd sa spécificité et on peut l'enregistrer comme un simple document comptable. Selon la richesse du codage adopté, la capacité de mémoire nécessaire peut, pour une seconde de signal audiofréquence, passer de 16 kilo-octets (téléphonie avec Fe = 16 kHz et N = 8) à 176 kilo-octets pour deux voies stéréo de haute fidélité avec Fe = 44 kilohertz et N = 16.
Nous voyons apparaître la première difficulté liée à l'enregistrement de ce qu'on appelle couramment la M.I.C. (modulation par impulsions codées) : l'énorme capacité de mémoire nécessaire pour atteindre des durées de l'ordre de l'heure.
Une autre difficulté est due à l'obligation de travailler en temps réel, le signal audio-fréquence ne supportant pas, en dehors de certaines phases de silence, la moindre altération de l'échelle des temps.
Les données numériques sont groupées dans une structure répétitive qu'on appelle (comme en vidéo) une trame. Celle-ci commence toujours par un mot (groupe de bits) de synchronisation et contient des mots de données (c'est-à-dire des échantillons du signal), des mots de contrôle de parité, des mots de correction d'erreurs et des mots de données auxiliaires (titre de l'œuvre, minutage, etc.).
Dès qu'une trame est lue, bien ou mal, il faut par un traitement approprié en extraire rapidement les échantillons et les équi-répartir dans le temps à la fréquence d'échantillonnage. Il n'est pas question, lorsqu'une poussière a perturbé la lecture d'un mot, de revenir en arrière : il faut corriger ou masquer le défaut. Pour cela, le codage a introduit des bits supplémentaires qui permettent de détecter toutes les erreurs, d'en corriger le plus grand nombre et au pire de remplacer les échantillons manquants par des échantillons plausibles (donc non gênants) calculés par interpolation à partir des échantillons voisins. Cette contrainte de restituer les échantillons à des instants précis impose une mémoire tampon, mais, grâce à cela, les fluctuations de vitesse d'une bande ou d'un disque numérique sont éliminées.
En résumé, l'enregistrement numérique du son est caractérisé par une bonne qualité (du moins celle qui est définie par le codage), par l'absence de pleurage et surtout par la conservation de la qualité initiale, notamment lors des recopies.
A priori, tous les types de mémoires sont utilisables. Dans des mémoires mortes à circuits intégrés, on ne dépasse pas pour l'instant quelques minutes de son. Avec les disques ou tambours magnétiques des gros ordinateurs, on peut tout au plus stocker quelques heures d'annonces publicitaires pour une radio commerciale, ce qui procure un accès aléatoire et programmable associé à une gestion automatique. La phonothèque numérique doit faire appel à des supports mieux optimisés : les bandes ou les disques.
Les bandes magnétiques audionumériques
Étant donné que le pas d'inscription sur une bande magnétique est de 2 micromètres environ par bit, les quelque 1 400 kilobits correspondant à une seconde de son stéréo exigent 1,4 × 106 × 2 × 10-6 = 2,8 mètres de piste. C'est prohibitif pour un enregistrement longitudinal série et on est conduit soit à utiliser un balayage hélicoïdal de la bande, comme en vidéo, soit à utiliser un grand nombre de pistes longitudinales parallèles. Avec un magnétoscope à cassettes grand public associé à un codeur-décodeur, on obtient trois heures d'autonomie. Une cassette miniaturisée utilisant ce même principe de têtes tournantes est apparue en 1987 sous le nom de D.A.T. (Digital Audio Tape). Avec une bande normale de 6,3 mm à dix pistes parallèles longitudinales, on peut descendre à des vitesses de l'ordre de 38 ou 19 centimètres par seconde, ce qui donne des autonomies de 1 à 2 heures. Une nouvelle cassette à pistes longitudinales avec compression de débit a vu le jour en 1992 sous le nom de D.C.C. (Digital Compact Cassette). Elle a le même encombrement que la cassette analogique afin que certains lecteurs puissent lire les deux formats.
La bande est un support commode pour l'enregistrement des originaux et les travaux de mise en forme, mais dès que l'on veut faire de la duplication à des fins commerciales, le disque reste le meilleur procédé par la rapidité de la duplication, la facilité des contrôles de qualité, la simplicité des manipulations.
Les disques audionumériques
Le disque compact qui a fait son apparition en 1983 est l'aboutissement de longues études d'optimisation et surtout de longues tractations commerciales puisque – et c'est peut-être une première dans l'histoire des techniques audiovisuelles – tous les constructeurs ont fini par se mettre d'accord sur un système unique. Mais cette remarquable unité n'aura pas duré longtemps, puisqu'un minidisque compac (M.D.) apparu en 1992, n'est pas compatible avec le premier. Le disque compact, de huit ou de douze centimètres de diamètre, n'est enregistré que sur une seule face, l'autre étant entièrement prise par l'étiquette, et pourtant on y trouve jusqu'à 75 minutes de musique stéréophonique, avec des niveaux imperceptibles de bruit, de diaphonie, de pleurage, de distorsions, et surtout pas d'usure puisque la lecture se fait optiquement par un rayon laser, donc sans contact. Grâce à une compression des données, le M.D. ne fait que 6,4 cm de diamètre pour une même durée, sinon tout à fait la même qualité, que le compact de 12 centimètres. Il existe en deux variantes : mécano-optique comme le compact, et magnéto-optique, c'est-à-dire effaçable et réenregistrable par l'utilisateur. Si l'on considère l'évolution suivie depuis les disques 78 tours, on peut remarquer que la vitesse linéaire du M.D. est la même (1,3 m/s) que celle du disque compact, ainsi que sa durée, alors que la longueur de piste est divisée par quatre. Cela vient du fait que, si la lecture du second se fait de façon continue dans le temps, la lecture du M.D. est au contraire discontinue : chaque paquet comprimé est lu, éventuellement relu en cas d'incident, avant d'être validé et mis dans une mémoire tampon d'où le signal sortira avec un débit régularisé.
Pour obtenir un disque numérique, on part en général d'une bande originale numérique, corrigée, montée, qui est lue et si besoin convertie dans le codage du disque compact : Fe = 44,1 kHz, N = 16 bits, soit 1,4112 Mbit/s pour deux voies audio. Dans le cas du M.D., la compression des données réduit cette valeur à environ 0,3 Mbit/s. Ce signal subit un nouveau codage destiné à faciliter le fonctionnement du lecteur : les mots de 8 bits sont remplacés par des mots de 14 bits dans lesquels il y a toujours au moins deux et au plus dix 0 entre deux 1 consécutifs. Ainsi, les 192 bits correspondant à 2 fois 6 échantillons de 16 bits plus les mots de synchronisation et de contrôle se retrouvent dans une trame de 588 bits où seuls les chiffres 1 sont matérialisés par un changement d'état, tandis que le nombre de 0 compris entre deux 1 est calculé, lors de la lecture, par interpolation dans le temps.
Le signal ainsi codé est envoyé dans un laser de gravure qui impressionne un disque de verre recouvert d'une pellicule photosensible. Le développement fait apparaître des petits creux qui peuvent être lus mais aussi dupliqués par galvanoplastie et pressage tout comme pour le disque ordinaire. La figure représente les différentes étapes entre le signal de départ, le disque compact et le signal restitué.
Le disque final est en matière transparente d'environ 1,2 mm d'épaisseur. La surface gravée est métallisée pour être réfléchissante et recouverte d'une couche de protection et de l'étiquette. La lecture se fait au travers de l'autre face par un petit faisceau laser réfléchi vers des cellules photoélectriques. Les différences de mise au point entre bosses et creux produisent des écarts de luminosité, donc des variations de tension électrique qui engendrent les 1 du signal numérique, après quoi les processus de correction d'erreurs et de décodage restituent le signal analogique de départ.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel CALMET : ancien élève de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des télécommunications, ingénieur en chef des télécommunications
Classification
Médias
Autres références
-
LE MUET A LA PAROLE (colloque)
- Écrit par François ALBERA
- 1 109 mots
Il existe une actualité du son enregistré, dupliqué, mixé, mis en scène, de son histoire et son évolution depuis la fin du xixe siècle. Au cours de l'année 2004, à Paris, un colloque international organisé à l'auditorium du Louvre par une équipe du C.N.R.S., « Le muet a la parole », l'exposition...
-
ACOUSMATIQUE MUSIQUE
- Écrit par François BAYLE
- 7 825 mots
- 5 médias
Cependant, l'événement sonore, comme l'événement visuel, se trouve placé dans une situation nouvelle par les techniques du xxe siècle qui, en réalisant le mythe du double, autorisent désormais le simulacre de la reproduction. -
APPLE
- Écrit par Pierre MOUNIER-KUHN
- 2 548 mots
- 2 médias
...firme conçoit et commercialise l’iPod (2001), baladeur numérique, et crée iTunes (2003), système de vente de musique en ligne qui contribue à bouleverser le marché de l’ enregistrement sonore. C’est cette diversification qui fait repartir la croissance de l’entreprise après huit ans de stagnation. -
ARRANGEURS DE LA CHANSON FRANÇAISE
- Écrit par Serge ELHAÏK
- 7 932 mots
- 3 médias
En 1925, l’invention del’enregistrement électrique avec microphone marque une véritable révolution qui permet d’enregistrer avec une plus grande finesse les divers instruments, notamment les cordes, et améliore la qualité du son rendu par les disques. Le marché de la musique est toujours plus florissant... -
BACKHAUS WILHELM (1884-1969)
- Écrit par Pierre BRETON
- 929 mots
- 2 médias
En 1905, Wilhelm Backhaus remporte à Paris le concours international Anton Rubinstein, qui prélude à sa carrière internationale.Backhaus réalise en 1909 le premier enregistrement complet d'un concerto pour piano et orchestre, en l'occurrence le concerto en la mineur de Grieg ; il... - Afficher les 35 références
Voir aussi
- FRÉQUENCE, physique
- COMPRESSION DES DONNÉES
- MODULATION & DÉMODULATION
- CODAGE
- AMPLIFICATEURS
- DISQUE
- AIMANTATION
- MODULATION PAR IMPULSIONS
- AUDIOVISUELLES TECHNIQUES
- MONOPHONIE
- BRUIT DE FOND
- BINAIRE SYSTÈME
- MAGNÉTIQUE ENREGISTREMENT
- BANDE MAGNÉTIQUE
- STÉRÉOPHONIE
- LECTURE OPTIQUE
- SIGNAL THÉORIE DU
- MODULATION DE FRÉQUENCE
- MODULATION PAR IMPULSIONS & CODAGE (MIC)
- MULTIPLEXAGE
- CASSETTE
- MAGNÉTOPHONE
- MAGNÉTO-OPTIQUE ENREGISTREMENT
- ANALOGIQUE ENREGISTREMENT
- PLEURAGE
- VÉLOCITÉ
- VIDÉO SIGNAL
- GRAVURE, électro-acoustique
- MICROSILLON
- ANALOGIQUE SIGNAL
- NUMÉRIQUE SIGNAL
- VIDÉODISQUE
- IMAGE ENREGISTREMENT & REPRODUCTION DE L'
- NUMÉRIQUE ENREGISTREMENT
- DISQUE COMPACT
- VHS (video home system)
- LONGUEUR D'ONDE
- CASSETTE VIDÉO ou VIDÉOCASSETTE
- LECTURE, électronique
- VIDÉO ENREGISTREMENT
- NORMALISATION
- SON NUMÉRIQUE
- ACOUSTIQUE