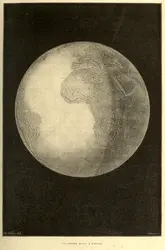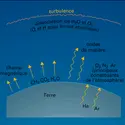- 1. L'homme dévastateur de la nature : un constat ancien
- 2. Des craintes croissantes concernant la rapide et profonde dégradation de l'environnement
- 3. 1948 : l'ombre de Malthus
- 4. L'impact médiatique du D.D.T.
- 5. Les questions environnementales ne s'inscrivent pas dans l'immédiateté
- 6. De la politique de conservation à l'écologie politique
- 7. Un combat sans cesse recommencé : Al Gore et « Une vérité qui dérange »
- 8. Bibliographie
ENVIRONNEMENT Catastrophisme environnemental
Article modifié le
Les questions environnementales sont devenues un enjeu politique majeur et les débats médiatiques s'avèrent souvent houleux. Schématiquement, on peut dire que deux groupes s'affrontent : aux environnementalistes « pessimistes » s'opposent des « optimistes ». Les pessimistes tentent d'alerter l'opinion publique ainsi que le pouvoir politique au sujet des menaces qui pèsent sur l'avenir de l'espèce humaine et de la nécessité de changer les modes de vie. Les optimistes les accusent d'être non seulement des cassandres, mais aussi des antihumanistes vouant un culte à la nature, des antiprogressistes incapables de considérer les capacités d'adaptation des hommes. Cependant, de documentaires ou de livres en articles de presse, l'idée que l'humanité court vers une catastrophe d'origine environnementale s'est imposée dans l'opinion comme un thème majeur et récurrent. Cette notion de catastrophisme environnemental n'est pas similaire au Déluge ou aux catastrophes postulées par Cuvier : il s'agit des conséquences des perturbations provoquées par l'homme sur son environnement qui, si elles ne sont pas régulées, finiront inéluctablement par remettre en cause l'avenir même de l'espèce humaine. Ce type de réflexion n'est pas aussi récent que peuvent le laisser croire les médias d'aujourd'hui. Un retour sur la seconde partie du xxe siècle en particulier permet de mieux comprendre l'origine de ce type de discours, mais aussi de saisir la profondeur du bouleversement qu'il provoque.
L'homme dévastateur de la nature : un constat ancien
Durant les vingt-cinq années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, une série de best-sellers, surtout américains, bouleversent profondément la conscience des Occidentaux : les auteurs de ces livres dénoncent une crise environnementale mondiale et prédisent, si aucune solution n'est apportée, de grandes difficultés pour l'humanité. En 1948, au début même d'une époque marquée par un intense développement économique et par une foi profonde dans le progrès, paraissent Road to Survival de William Vogt et Our Plundered Planet d'Henry Fairfield Osborn Jr. Tous les deux dénoncent les effets conjugués de l'explosion démographique et de l'épuisement des ressources naturelles. Leur succès n'est dépassé qu'en 1962 par Silent Spring (Printemps silencieux) de Rachel Carson, qui fait le constat alarmant de l'impact du D.D.T. et des autres pesticides de synthèse sur l'environnement. L'année 1968 est marquée par un nouveau best-seller, The Population Bomb (La Bombe P) de Paul R. Ehrlich ; mais, plus que le dernier jalon d'une série, l'immense succès de cet ouvrage marque l'émergence d'une nouvelle forme de pensée des problèmes environnementaux : l'écologie politique.
Mis à part le réchauffement climatique, les questions posées par ces auteurs sont les mêmes, ou presque, que celles des environnementalistes contemporains. Si cette dernière forme de pensée contestataire du développement économique généré par la révolution industrielle est née au début des années 1970, ses racines sont en réalité bien plus lointaines et diverses.
Une préoccupation ancienne des économistes et des géographes
L'un des textes les plus anciens et les plus importants sur la relation de l'homme à son environnement et sa dépendance vis-à-vis de celui-ci est l' Essai sur le principe de population de l'économiste britannique Thomas Robert Malthus (1766-1834), qui paraît pour la première fois en 1798 et que l'auteur va reprendre six fois jusqu'en 1826. Le succès est immense et l'ouvrage suscite de très nombreux éloges et critiques. Sa thèse est souvent résumée par cette formule : la population croît suivant une progression géométrique, tandis que les ressources alimentaires ne peuvent croître que suivant une progression arithmétique. D'après Malthus, la croissance de la population au-delà des ressources alimentaires disponibles provoque vices et misères, notamment chez les plus pauvres ; mais, comme l'être humain est doué d'entendement, il peut, contrairement aux animaux, anticiper cette contrainte et chercher à limiter la croissance de ses effectifs, en particulier en bas de l'échelle sociale. Le diplomate et philologue américain George Perkins Marsh (1801-1882) aborde, quant à lui, un autre volet du lien entre homme et environnement : la question de la conservation des ressources naturelles en dépit des modifications qu'il y introduit. Pour Marsh, l'être humain a acquis la capacité de modifier l'ordre naturel comme aucune autre espèce ne l'a jamais pu. Dans son Man and Nature ; or Physical Geography as Modified by Human Action (1864), un ouvrage qu'il enrichit en 1874 sous le titre de The Earth as Modified by Human Action, il tente de faire l'inventaire des modifications provoquées par l'homme et souligne la nécessité de la prudence chaque fois que ce dernier perturbe l'équilibre naturel. Il s'intéresse aussi aux moyens de restaurer cet équilibre lorsqu'il est perturbé et, dépassant le cadre de la simple description géographique, Marsh insiste sur l'importance d'un gouvernement sage et avisé pour conserver – voire améliorer – les ressources naturelles dont dépend l'être humain. L'œuvre de Marsh ne semble pas avoir eu une grande influence en Europe et n'a jamais été traduite en français, bien qu 'Élisée Reclus (1830-1905), géographe anarchiste, l'ait analysée dans la Revue des Deux Mondes en 1864. Comme en témoigne la correspondance entre Reclus et Marsh, ce sont deux visions du futur de l'homme qui s'affrontent : l'auteur américain voit l'œuvre du Français comme un complément plus optimiste à la sienne. Marsh insiste sur la capacité destructrice de l'être humain, tandis que Reclus souligne l'intelligence de l'homme pour conserver l'environnement et l'améliorer, car « non seulement il sait, en qualité d'agriculteur et d'industriel, utiliser de plus en plus les produits et les forces du globe ; il apprend aussi, comme artiste, à donner aux paysages qui l'entourent plus de charme, de grâce ou de majesté. Devenu „la conscience de la terre“, l'homme digne de sa mission assume par cela même une part de responsabilité dans l'harmonie et la beauté de la nature environnante ». L'optimisme dans la nature humaine affiché par Reclus se retrouve chez de nombreux penseurs révolutionnaires de son temps, pour lesquels le comportement destructeur de l'homme n'est que la conséquence du dysfonctionnement produit par la structure inégalitaire et injuste de la société.
Ces thèmes sont à nouveau explorés par le géographe russe Aleksandr Ivanovich Woeikof (1842-1916) qui affirme au début du xxe siècle, qu'on ne peut nier que l'homme, par son imprévoyance et son avidité, exerce une influence néfaste sur son environnement. Il n'exclut pourtant pas que certains des dégâts causés par l'homme puissent être compris et réparés, mais il souligne le caractère mondial de l'évolution des sociétés vers le modèle occidental, la qualifiant ainsi : « On ne peut nier que cette civilisation, telle qu'elle s'est développée au xixe siècle, ne soit extrêmement riche et puissante, mais malheureusement elle est aussi disharmonique à un suprême degré. » Il dénonce l'accroissement des villes où règnent « des conditions malsaines au physique et au moral », et il ajoute que « cette dissociation de l'homme et de la terre est une preuve d'état maladif ». Plus que Marsh mais moins que Reclus, il conserve un certain optimisme et affirme que dans le futur nous saurons mieux utiliser l'énergie solaire sans qu'il soit en mesure, bien sûr, de préciser comment. La pensée de Woeikof connaît une diffusion non négligeable en Europe, car ses textes sont édités en français, en allemand et en russe.
C'est sans doute chez le géographe allemand Ernst Friedrich (né en 1867) que l'on trouve l'analyse la plus forte de l'impact négatif de l'homme sur son environnement, avec son concept de Raubwirtschaft ou « économie de la rapine ». Friedrich souligne que cette question n'est pas seulement morale ; elle est aussi matérielle et il tente de comprendre comment l'évolution des différents modes économiques (depuis la cueillette jusqu'à l'époque industrielle) aboutit à une surexploitation voire à la destruction des ressources naturelles. Il est difficile d'isoler Friedrich et son analyse du contexte particulier de l'Allemagne, car plus qu'ailleurs les questions environnementales mobilisent de très nombreuses personnes (sur la protection des forêts, des oiseaux, des paysages de montagnes...). Cependant, il faut souligner que Friedrich n'a que peu d'influence sur les géographes de son temps, à l'exception notable du Français Jean Brunhes (1869-1930).
La biologie reprend et développe les interrogations environnementalistes
Malgré l'intérêt des publications des auteurs qui viennent d'être cités, on doit conclure qu'elles n'ont pas eu d'impact sur la société. On peut penser que c'est en partie parce que leurs analyses s'appuyaient sur des données fragmentaires et souvent très imprécises. Ces auteurs ont l'intuition de la dégradation de l'environnement, mais ils ne disposent pas d'évaluations précises et globales. De plus, ils n'ont aucun outil conceptuel leur permettant d'aborder les complexes questions environnementales. L'analyse scientifique des problèmes posés par les interventions humaines dans la dégradation de l'environnement et par la conservation des ressources naturelles va venir de la biologie.
C'est en effet un leitmotiv chez de nombreux naturalistes du xixe siècle : ils se lamentent sur les changements observés ou sur l'érosion des populations animales liés à l'action de l'homme : « De nombreuses espèces n'existent déjà plus, d'autres tendent chaque jour à disparaître et celles qui chaque jour sont conquises par la domestication ne compensent pas les espèces sauvages perdues », déplore M. de Confévron, de la Société d'acclimatation, en 1888. Parmi les premières études écologiques, de nombreuses sont consacrées à des problèmes complexes intriquant des aspects biologiques, sociaux et économiques. Ainsi, le zoologiste allemand Karl Möbius (1825-1908) qui forge le concept de biocénose (ensemble des organismes vivant en un lieu précis) dans une étude de 1877 portant sur l'écologie des huîtres : il y démontre qu'on ne peut pas exploiter commercialement ces mollusques au-delà d'un certain seuil sans risquer de les faire disparaître. On trouve une même origine anthropocentrée dans l'intérêt du biologiste britannique Charles Sutherland Elton (1900-1991) pour les questions de fluctuations des populations animales qu'il a découvertes en travaillant pour la Compagnie de la baie d'Hudson. Et comment ne pas voir dans l'essor de l'école botanique initiée par l'Américain Frederic Edward Clements (1874-1945), les impérieuses nécessités de l'agriculture dans les Grandes Plaines touchées par le phénomène du Dust Bowl (tempêtes de poussière) dans les années 1930 ?
La biologie a pu mettre au point des outils de mesure et proposer des concepts permettant de penser les changements induits par l'homme dans son environnement ainsi que leurs conséquences en retour sur l'homme et la biosphère, un objectif que la géographie ne s'est pas fixé. L'analyse des effets des perturbations apportées aux chaînes trophiques est un bon exemple de ces observations. En somme, l'écologie affirme les influences réciproques de l'homme et de son environnement ; plus encore, elle démontre la dépendance de notre espèce à la qualité, sensu lato, de son cadre de vie. C'est donc sans surprise que la quasi-totalité des auteurs qui traitent des questions environnementales de 1948 à 1968 – Vogt, Osborn Jr, Dasmann, Darling, Borgström, Heim, Dorst, Bouillenne, Bates... – sont des biologistes.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Valérie CHANSIGAUD : docteur en sciences de l'environnement, historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire SPHERE, CNRS, UMR 7219, université de Paris-VII-Denis-Diderot
Classification
Autres références
-
ENVIRONNEMENT GLOBAL
- Écrit par Robert KANDEL
- 8 117 mots
- 10 médias
Désormais sujet de débat politique et faisant une entrée remarquée sur la scène diplomatique internationale, la question de la transformation de l' environnement par la civilisation moderne cesse d'être l'unique apanage des scientifiques ou des « amis de la nature ». Devenue globale, la question se...
-
GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
- Écrit par Pierre LASCOUMES
- 1 390 mots
Le Grenelle de l’environnement – de son vrai nom le Grenelle Environnement (GE) – est une concertation politique innovante, menée entre juillet et décembre 2007, peu après l’élection à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy. Son objectif était de définir les grands axes...
-
NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR L'ENVIRONNEMENT - (repères chronologiques)
- Écrit par Jean-Paul DELÉAGE
- 2 611 mots
1968 Première conférence intergouvernementale posant le problème de la conservation et de l'utilisation rationnelle des ressources de la biosphère. Organisée par l'U.N.E.S.C.O., du 4 au 13 septembre, à Paris, elle recommande l'élaboration d'un grand programme mondial de recherches sur l'homme et...
-
SEVESO ACCIDENT CHIMIQUE DE (10 juillet 1976)
- Écrit par Yves GAUTIER
- 375 mots
- 1 média
Le 10 juillet 1976, des vapeurs toxiques de dioxine – précisément de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine, cancérigène et tératogène même à faible dose – s'échappent d'un réacteur chimique produisant du chlorophénol de l'usine Icmesa (filiale de Givaudan), près de Milan (Italie). Ce produit,...
-
ACIDIFICATION DES OCÉANS
- Écrit par Paul TRÉGUER
- 2 202 mots
- 5 médias
Par sa capacité à dissoudre les gaz atmosphériques responsables de l'effet de serre, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Toutefois, l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone (CO2) rejeté par les activités humaines (anthropiques) depuis 1850...
-
AÉRONAUTIQUE CIVILE (INDUSTRIE)
- Écrit par Georges VILLE
- 2 387 mots
Ledéveloppement de la sensibilité environnementale a entraîné une dégradation de l'image du transport aérien. Les constructeurs et les exploitants ont fait beaucoup d'efforts et obtenu des résultats appréciables, mais ceux-ci ont été masqués par la croissance du trafic ; la situation continuera de s'améliorer,... -
AÉRONOMIE
- Écrit par Gaston KOCKARTS
- 4 158 mots
- 11 médias
...rayonnement cosmique corpusculaire avec l'atmosphère ; ceux du troisième cycle sont essentiellement d'origine anthropogénique (dus aux activités humaines). En effet, les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés massivement comme gaz réfrigérants, ou comme gaz propulseur dans les aérosols ont libéré des composés... - Afficher les 236 références
Voir aussi
- SURPOPULATION
- DDT (dichloro-diphényl trichloréthane)
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES
- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- ANTHROPISATION
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- EHRLICH PAUL RALPH (1932- )
- DÉGRADATION DES SOLS
- DUST BOWL
- MARSH GEORGE PERKINS (1801-1882)
- WOEIKOF ALEKSANDR IVANOVITCH (1842-1916)
- FRIEDRICH ERNST (1867-?)
- VOGT WILLIAM (1902-1968)
- OSBORN HENRY FAIRFIELD Jr. (1887-1969)