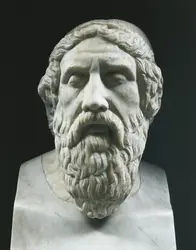ÉPOPÉE
Article modifié le
L'Asie du Sud-Est
L'épopée en Chine n'a pas toujours été clairement perçue en tant que telle. De nos jours, les grands cycles narratifs se présentent d'abord sous la forme de « romans » écrits – » récit transmis » (zhuan), « histoire » (ji) ou « narration amplifiée » (yanyi) – de type chantefable. Les recherches historiques ainsi qu'ethnologiques ont permis de connaître les versions manuscrites et orales qui sont à la base des romans écrits du xive au xvie siècle, tels L'Histoire des Trois Royaumes, Le Voyage vers l'ouest ou Au bord de l'eau. En Inde et en Asie du Sud-Est, jusqu'au xxe siècle, les valeurs de l'oralité et celles de l'écriture ne s'excluent pas mutuellement mais au contraire s'entrelacent l'une à l'autre. Les épopées sont l'expression la plus émouvante des arts de la performance et de la composition. Musique, chant et poésie ont rayonné sur des modes infinis non seulement à partir des cultures de cour, mais encore des cultures paysannes, villageoises et de quartiers en milieu citadin : théâtres d'ombres, de marionnettes, de masques et d'acteurs ont chanté, mimé et dansé les épopées. Toutefois, c'est dans les cultures minoritaires des montagnards sédentaires ou nomades qu'on entend l'expression la plus dépouillée des arts de la performance, l'épopée orale chantée par un aède, seul, avec parfois un accompagnement vocal ou instrumental très simple.
Les influences chinoise et indienne
Plusieurs familles linguistiques s'imbriquent de la manière la plus complexe sur le continent. La péninsule est le lieu où les familles tibéto-birmane, karen, sino-tibétaine, miao-yao, thaï-kadaï, austro-asiatique et austronésienne se jouxtent dans l'espace et le temps, tandis que la situation est plus homogène dans les archipels, avec la famille austronésienne. Sur les populations animistes dites de substrat (mais qui ont elles-mêmes effectué des migrations antérieures, continentales et maritimes), depuis le début de notre ère, diverses civilisations ont déposé leurs sédiments : les épopées l'attestent. En fait, elles forment un ensemble de récits héroïques et poétiques qui sont le réceptacle d'une histoire orale ou semi-littéraire, selon les contextes culturels. La civilisation chinoise a étendu une emprise militaire et politico-administrative le long de la partie orientale de la péninsule jusqu'au ixe siècle, marquant la culture vietnamienne du sceau de la sinisation (écriture en idéogrammes, morale confucéenne), tandis que la civilisation indienne a déployé une influence culturelle, artistique et religieuse, marquant d'abord le Fou-nan, le Tchen-la (qui devait devenir le Kambujā, ou Cambodge) et le royaume Môn ou Pyū (le Siam), puis, vers le ive siècle, Sumatra, Java et les côtes de Kalimantan, du sceau de l'indianisation. Les épopées du Mahābhārata, du Rāmāyana et les syllabaires dérivés de l'écriture brahmi en témoignent. Selon la stèle de Veal Kantel au début du viie siècle, l'épopée fut donnée en intégrale à un sanctuaire du Kampuchéa. Au xe siècle, on connaît une version en kawi d'un des livres de cette épopée : Bishmaparvan. Il y a d'autres versions attestées au Siam et en vieux malais ainsi qu'en Birmanie et au Tibet. De nombreuses compositions littéraires et des épisodes entiers en sont dérivés.
Le Rāmayāna attribué aux Rṣi Vālmiki a été adapté et traduit en version javanaise dès le ixe siècle (temple de Prambanan). On a des versions khmère, thaïe, lao, kawi (javanais, balinais) et malaise de ce grand cycle épique. Par rapport au récit sanskrit, il est nécessaire de distinguer les adaptations poétiques tardives, souvent effectuées pour des rois poètes, des premières traductions effectuées dans les langues vernaculaires à partir du texte original sanskrit.
Au Cambodge, jusqu'en 1975, le répertoire de cette épopée était très vivant tandis que celui du Mahābhārata, attesté sur les bas-reliefs d' Angkor, semblait avoir disparu de la culture de cour et des cultures paysannes. Le héros du Rāmaker, Preah Ram, avatar de Viṣṇu, devient progressivement « être illuminé ». Les grands cuirs, leurs ombres, les danseurs-porteurs accompagnaient le récit du maître conteur, tandis que musique et poésie en cette nuit de chant et de danse de l'épopée avaient le pouvoir de donner la prospérité aux villages. Telle est bien l'efficacité symbolique dont l'épopée est toujours dotée. Le rayonnement de la civilisation d'Angkor avait suscité l'adaptation et la mise en valeur de certains épisodes par les cultures voisines thaïe et lao. Le roi Rāma Ier au xviiie siècle a donné la seule traduction intégrale en thaï, tandis que l'on connaît trois versions singulières de l'adaptation lao. Hikayat Sri Rāma est la version en vieux malais, illustrant ce même cycle épique. On connaît plusieurs manuscrits en caractères jawi depuis le xvie siècle.
L'influence islamique
À partir du xiie siècle à Aceh, et surtout aux xve et xvie siècles jusqu'à nos jours, l'islam n'a cessé de progresser dans l'archipel nusantarien. Par la lecture du Livre (al-Kitab), l'écriture en caractères arabes s'est diffusée, d'abord vers Malacca, Riau, Sunda, dans la partie ouest de Java, suivant les cités-comptoirs du Pasisir. À Sunda, le répertoire du Mahābhārata et du Rāmāyana est interprété par les golek, marionnettes en bois sculptées en ronde bosse, tandis que plusieurs dizaines d'épopées chantent le cycle de Panji, prince de Koripan, et ce répertoire est authentiquement javanais. Les pantun, épopées orales sundanaises, sont de très longues compositions en vers octosyllabiques rimés. Elles sont psalmodiées par un barde qui s'accompagne au kacapi, une cithare horizontale de six à dix-huit cordes. En des milliers de vers et prêtant des voix particulières aux divers personnages, le chant glorifie soit le royaume de Galuh, soit le royaume de Pajajaran. Le chant des épopées clôt le repas de moisson. Désormais, il est entouré de prières musulmanes et se déploie du soleil couchant jusqu'à l'aube. Le Catalogue raisonné des manuscrits musulmans atteste cent quatorze épopées en pays Sunda. Elles relatent la période hindo-bouddhiste, puis elles deviennent des chroniques de l'islamisation. La lecture respectueuse des manuscrits, strophe par strophe, par le copiste, est reprise par le barde selon la technique vocale beluk, et l'auditoire, hommes et femmes, ponctue en chœur la fin de l'énoncé. Le patrimoine de la littérature orale et écrite malaise, qui s'étend d'Aceh jusqu'aux Moluques, englobe des épopées qui relèvent du modèle indien et des épopées qui, en chantant la conquête de l'islam, relèvent d'un modèle musulman, tel Hikayat Amin Rajah.
Peuples de forêt
L'épopée trouve son expression la plus dépouillée en forêt chez les « hommes des hauts », Dayak de Bornéo, montagnards de Palawan, de Mindanao, de Luzon et des hauts plateaux des péninsules indochinoise et malaise. Ici, pas de théâtralisation mais un aède allongé qui, la nuit durant, relate en son plain-chant les épreuves d'un héros et sa quête en mariage. La crise – guerre ou duel – est suivie d'une mort à soi-même et d'une renaissance (alliance, avènement, ordre nouveau). Si, dans les sociétés à État, le héros épique devient emblème au niveau national, dans les sociétés d'échange, le héros est aussi un modèle qui, respectueux des droits et des devoirs entre germains et affins, jette les fondements de la vie familiale et de l'organisation sociale au niveau clanique ou ethnique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeure de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Maria COUROUCLI : chargé de recherche au C.N.R.S.
- Jocelyne FERNANDEZ : docteur d'État (linguistique générale), directeur de recherche au C.N.R.S.
- Pierre-Sylvain FILLIOZAT : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Altan GOKALP : chargé de recherche de première classe au C.N.R.S., responsable de l'équipe cultures populaires, Islam périphérique, migrations au laboratoire d'ethnologie de l'université de Paris-X-Nanterre, expert consultant auprès de la C.E.E. D.G.V.-Bruxelles
- Roberte Nicole HAMAYON : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Ve section (sciences religieuses)
- François MACÉ : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales
- Nicole REVEL : docteur ès lettres et sciences humaines, directeur de recherche au C.N.R.S
- Christiane SEYDOU : directeur de recherche au C.N.R.S.
Classification
Médias
Autres références
-
ILIADE, Homère - Fiche de lecture
- Écrit par Jean-François PÉPIN
- 974 mots
- 1 média
Au milieu du viiie siècle avant J.-C., un poète grec venu d'Asie Mineure, Homère, aurait composé en hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, l'Iliade et l'Odyssée, mais le mystère entoure encore aujourd'hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement existé ? A-t-il...
-
AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures
- Écrit par Jean DERIVE , Jean-Louis JOUBERT et Michel LABAN
- 16 571 mots
- 2 médias
...est vrai pour le conte le sera aussi bien pour le genre parémique (distinction marquée dans certaines nomenclatures entre plusieurs types d'aphorismes) ou pour le genre épique. En langue mandingue, par exemple, l'épopée reçoit une dénomination différente selon qu'elle est historique ou corporative... -
ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures
- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL
- 24 589 mots
- 33 médias
...Parallèlement à ce mouvement, la littérature profane connaît un nouvel essor vers 1125-1150, et voit la création d'œuvres se répartissant en deux groupes : les épopées de clercs et les épopées dites, à tort, de jongleurs. La notion d'empire occupe une place prépondérante dans le Rolandslied d'un... -
‘ANTARA (VIe s.)
- Écrit par Sayed Attia ABUL NAGA
- 532 mots
Grand guerrier et poète arabe préislamique. On lui attribue une cinquantaine de pièces, dont une mu‘allaqā, poème qui aurait été exposé à la Ka‘ba, la Pierre noire de La Mecque. Néanmoins, une grande partie de cette œuvre est apocryphe. Dans ces poèmes, ‘Antara exalte ses faits d'armes et exprime...
- Afficher les 83 références
Voir aussi
- FINNOISE ou FINLANDAISE LITTÉRATURE
- JAVANAISE LITTÉRATURE
- PANTOUM ou PANTUN
- BYZANTINE LITTÉRATURE
- RUNES ou RUNIQUE, écriture
- POÉSIE JAPONAISE
- MONGOLES LANGUE & LITTÉRATURE
- TURQUE LITTÉRATURE
- ARABE LITTÉRATURE
- GRIOT
- JAPONAISE LITTÉRATURE
- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE
- ASIE DU SUD-EST
- SIAM
- CARÉLIE
- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE
- PAROLE
- ORALE LITTÉRATURE
- DEDE KORKUT, épopée turque
- JONGLEURS
- CYCLE, littérature
- RÉCITATION
- DIGENIS AKRITAS ÉPOPÉE DE
- INDE MONDE DIVIN DE L'
- GRECQUE MYTHOLOGIE
- TROIE GUERRE DE
- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge
- INDE, langues et littératures
- CRÉATION MYTHES DE LA
- AFRIQUE NOIRE, littératures
- MONOGATARI, genre littéraire
- GÉSAR ou GUÉSAR DE LING
- ESTONIENNE LITTÉRATURE
- HÉROS & IDOLES
- SANSKRITE ou SANSCRITE LITTÉRATURE
- ULYSSE
- VÉDIQUE LITTÉRATURE
- BRAHMAN, hindouisme
- PÈLERINAGES HINDOUS