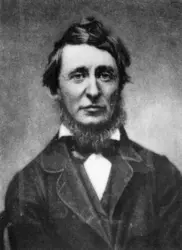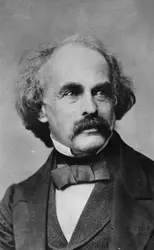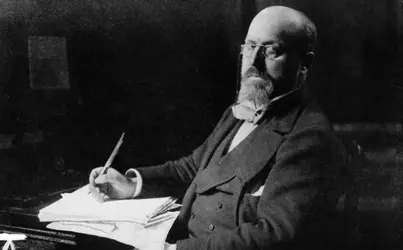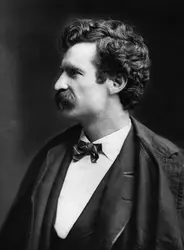- 1. Le problème des origines
- 2. Les thèmes spécifiquement américains
- 3. Du puritanisme au transcendantalisme : une tradition spirituelle et intellectuelle
- 4. Naissance de l'historiographie américaine
- 5. La poésie au XXe siècle
- 6. Le Sud
- 7. La littérature afro-américaine
- 8. Les littératures latinas des États-Unis
- 9. Littératures des minorités
- 10. Bibliographie
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) La littérature
Article modifié le
Les thèmes spécifiquement américains
L'homme de couleur
Pour les Européens, l'événement qui consacrait la naissance d'une littérature américaine était l'apparition de thèmes indigènes, d'une couleur locale comparable à celle que Chateaubriand était allé découvrir aux États-Unis. Le Peau-Rouge et l'esclave noir apportaient le dépaysement que cherchait le lecteur d'une littérature étrangère. Pour les Américains, il s'agissait moins d'une source de pittoresque que d'un problème de conscience. Bonne conscience pour les uns, qui acceptent, comme une évidence, la supériorité du Blanc ; mauvaise conscience pour les autres, qui perçoivent l'injustice fondamentale d'un racisme triomphant. Après Cooper, l' Indien n'est plus pour l'écrivain américain qu'un mauvais souvenir. Il apparaît épisodiquement comme un noble sachem ou un bandit de grand chemin, finalement relégué dans les westerns, ce musée de L'Homme américain. Le Noir, au contraire, vit avec les Blancs, et non en marge de la société qu'il a créée. Dans un pays si dépourvu des signes extérieurs de la hiérarchie sociale, il fournit à l'écrivain sa première image identifiable de l'inégalité et de l'injustice. De La Case de l'oncle Tom et de Huckleberry Finn à Lumière d'août (Light in August, 1932), à L'Homme invisible (Invisible Man, 1952) ou aux Confessions de Nat Turner (1967), de la résignation à la révolte et à la vengeance, le Noir a acquis dans la littérature américaine une place exceptionnelle. Parallèlement aux hommes d'action que sont Martin Luther King ou Malcolm X s'affirment des écrivains comme Ralph Ellison, James Baldwin, Alice Walker et Toni Morrison. Les Blancs eux-mêmes, après avoir créé un monde de la culpabilité qu'illustre bien « L'Ours » de Faulkner, en viennent parfois à identifier leur propre révolte contre la société à celle de l'homme de couleur contre l'oppression raciale ; c'est le Nègre blanc (The White Negro, 1958) de Norman Mailer.
Ainsi se trouve paradoxalement vérifiée la vision puritaine simpliste de l'univers qu'apportaient les premiers pèlerins. Ces pieux Américains firent volontiers du Noir et de l'Indien des symboles du diable qu'il fallait réduire à merci ou détruire. Leurs descendants se voient maintenant encerclés dans l'Enfer ainsi créé : James Baldwin devient le prophète de leur destruction en leur promettant « la prochaine fois, le feu ». Vision biblique de la malédiction céleste que n'est pas loin de partager l'écrivain blanc William Styron, qui leur conseille aussi de « réduire en cendres cette maison ».
Pourtant, si ce thème de la mauvaise conscience est celui auquel nous sommes le plus sensibles, il n'est qu'un contrepoint à celui de la grande espérance qui anime les Américains. Que de sermons ont illustré l'attente de la Terre promise, que de discours ou d'écrits politiques, de Jefferson et Lincoln à Franklin Roosevelt et John Kennedy, ont exalté la victoire de l'homme sur la barbarie politique, morale ou économique ! La réponse que donnait John Crèvecœur à sa question : « Qu'est-ce qu'un Américain ? » est une description de l'homme idéal de son siècle, bon, sain et heureux.
Seules quelques créations folkloriques, équivalents des fabliaux par les témoignages qu'elles contiennent sur la société de l'époque, font vivre cet homme moyen américain, travailleur, optimiste, démocrate, attendant le résultat de ses efforts en ce monde plutôt qu'en l'autre, passionné de justice et d'égalité, le common man, différent de ce que le Français entend par l'homme du peuple. Or, d'Ismaël, le narrateur morose de Moby Dick (1851), ou de Davy Crockett, lequel est le plus américain ? Question insoluble, mais qui met en lumière les deux faces de l'âme d'une nation.
L'homme de la nature
L'Amérique, c'est d'abord la nature au moment où l'homme la découvre. Des mots comme « Maine », « Mississippi », « Oregon », « Grandes Plaines » ont encore un charme magique qui évoque celui du lac Glimmerglass de Cooper, et qu'essayent de sauvegarder ou de recréer artificiellement les parcs nationaux. Il existe un coin sauvage dans la conscience de bien des Américains où l'on part à la pêche et à la chasse avec Ernest Hemingway ou Thoreau.
Cette recherche de la nature comporte une identification avec des forces vives : l'expérience d'une promenade dans les bois pour Emerson ou Thoreau, d'un corps qui se roule dans l'herbe pour Whitman, d'un radeau qui flotte au fil de l'eau pour Mark Twain. Or, au xxe siècle, ce contact, cette rencontre miraculeuse de l'homme et de la nature sont perdus. Ils n'en sont alors que plus passionnément recherchés, sur les grand-routes, dans l'exotisme, la guerre, le crime, la drogue ou les aventures sexuelles. La « frontière » qui, sur le plan mythique, rapprochait l'homme de sa pureté originelle, en se rétrécissant sans cesse a finalement laissé l'Américain face à un vide et à une nostalgie. Celui-ci a définitivement perdu au xixe siècle les bois, la ferme ou le jardin de son enfance. Le Mississippi, comme la Tamise d'Eliot, ne roule plus aujourd'hui que les déchets de la civilisation industrielle.
La nature, c'est aussi pour l'Américain celle que découvre l'agriculteur dans sa ferme : les travaux des champs, la vie patriarcale, les vertus simples, parfois un peu bornées, du colon romain. Le vrai défricheur, le vrai pionnier de la mythologie américaine, est l'homme qui abat des arbres, puis laboure et vit en paix avec ses voisins. Un tel idéal se prête mal aux évocations littéraires, car il ne suggère que le dur labeur et l'ennui et provoque chez l'artiste un sentiment de révolte plutôt que d'admiration. Des œuvres mineures, comme celles de Hamlin Garland, à la fin du xixe siècle, révèlent la misère des fermiers et l'envers du rêve américain. Seul peut-être, Robert Frost a su allier un attachement têtu de Yankee à son coin de terre, le sens de la plénitude qu'on y découvre, à l'âpreté et l'amertume d'une vie d'intellectuel paysan. Mais c'est à la force de l'évocation nostalgique, au début du xxe siècle, que l'on peut mesurer combien l'Amérique s'est longtemps voulue une terre de paysans libres. Dès que la machine, la banque et l'homme politique se liguent pour exploiter le fermier, les hommes de lettres se révèlent passionnément agrariens. Frank Norris commence une épopée du blé et John Steinbeck vendange sur les vignes américaines les « raisins de la colère » (The Grapes of Wrath, 1939). Même le fermier embourgeoisé et presque urbanisé que dépeint Truman Capote dans De sang froid (In Cold Blood, 1965) est, avec toute sa famille, un modèle de la vertu austère et prospère de l'Amérique.
Du contact avec une nature rebelle, sauvage, présentant aux hommes des obstacles parfois démesurés, les Américains ont enfin gardé l'image d'un affrontement cruel, souvent d'une lutte à mort. Moby Dick reste, au niveau d'interprétation le plus simple, l'histoire de la défaite d'un homme face à un monstre marin, et ce récit fait écho à celui de terrifiantes chasses à l'ours dans les légendes de l'Ouest. La nature est, au premier abord, redoutable et même hostile, comme en firent l'expérience les premiers pèlerins débarquant en Nouvelle-Angleterre. Dans ses déserts ou ses forêts règne la loi du plus fort. Norris situe, tout naturellement, dans la Vallée de la mort le duel entre deux brutes qui sert de dénouement à McTeague (1899). La violence de la nature justifie celle de l'homme, celle des hors-la-loi des westerns ou d'Ishmael Bush dans La Prairie (The Prairie, 1828) de Cooper, et elle lui laisse le goût du sang, comme le montre Norman Mailer dans Pourquoi sommes-nous au Vietnam ? (Why Are We in Vietnam ?, 1967). Dans la littérature contemporaine, si préoccupée des rites de passage et des actes qui assurent la transition symbolique de l'enfance à l'âge d'homme, on retrouve sans cesse ce rôle prédominant accordé à la blessure, aux armes de chasse ou de guerre, qui permettent à l'homme de découvrir simultanément l'existence du mal et sa propre virilité. Il y a dans les œuvres de Stephen Crane, Hemingway, Dos Passos, Faulkner un sens de la victoire et de la défaite ambiguës de l'homme dans la guerre et la violence.
Promeneur dans les bois, fermier, chasseur ou vacancier, l'Américain dans la nature reste seul, en tout cas rarement accompagné d'une femme. Devant un horizon qu'il perçoit illimité, il est tenté de se laisser griser par les délices d'une communion romantique, comme au jardin d'Éden, ou de combler cet espace, ce vide, et de construire une civilisation au milieu du désert. Pour cet Américain solitaire, l'« autre » peut être un compagnon ou un ennemi qui empiète sur son domaine. Fraternité et assassinat sont les deux pôles de la vie comme de la littérature américaines.
Si, à la question, « Qu'est-ce qu'un Américain ? » la littérature des États-Unis répond : « C'est un homme de la nature », avec toutes les ambiguïtés de cette formulation, on comprend pourquoi cet Américain « authentique » n'existe plus au xxe siècle. Le héros américain est maintenant un adolescent qui a perdu son rêve.
L'homme du progrès
Même si les bois de Concord ou du Michigan, l'étang de Walden ou les rives du Mississippi et, de nos jours, la nature domestiquée des jardins de faubourgs résidentiels et des ports du cap Cod semblent être immédiatement accessibles, ils ne sont perçus et décrits que dans un univers dominé ou cerné par la machine, le chemin de fer, le bateau à vapeur, l'automobile, l'avion. Les valeurs de la nature sont, presque dès l'origine, vécues par contraste avec celles de la ville, de la civilisation et de la société mécanisée. L'Américain, comme Rousseau au moment d'écrire le Discours sur les sciences et les arts, sait que l'homme a irrémédiablement choisi le progrès, mais il s'abandonne à la nostalgie d'une pureté originelle.
Sans doute, en 1900, Sister Carrie prend-elle le train pour Chicago et quitte-t-elle sans regret son village natal, et vingt ans plus tard Carol Kennicott, prisonnière de Main Street, se révoltera-t-elle contre le provincialisme étroit d'une ville minuscule du Middle West ; mais, en contrepoint à cette fuite vers la capitale, vers les capitales, Chicago, Washington, New York, Greenwich Village ou Montparnasse, à cette haine de la vie rurale et de l'esprit de clocher, s'installe une nostalgie encore plus forte de l'Amérique perdue, celle de l'innocence, d'une enfance dans le Michigan, en Virginie, en Caroline. Winesburg, Ohio finit là où commence Sister Carrie : sur le quai d'une gare de campagne. Là se situe la charnière entre deux Amériques irréconciliables.
Si Carl Sandburg a voulu écrire une poésie de la vie moderne, de la ville et de la machine, de la démocratie américaine au xxe siècle, beaucoup ont au contraire choisi l'Amérique du passé, comme Faulkner dans son comté de Yoknapatawpha, où il voit d'un œil soupçonneux la montée des Snopes, ou Steinbeck lorsqu'il s'attendrit sur une Californie d'opérette où l'on côtoie de bons clochards et des prostituées généreuses. Mais ce choix devient de plus en plus illusoire, car le monde rural ou provincial de Carson McCullers, Flannery O'Connor, John Cheever n'est pas un refuge, mais un enfer, guère différent de celui des citadins dans lequel se promène, terrifié, Holden Caulfield, le jeune héros de Salinger.
Pour les écrivains juifs ou noirs, l'image nostalgique de la vie rurale a un sens différent. Les uns, en effet, connaissent un mode de vie traditionnellement urbain, les autres associent la campagne au souvenir de l'esclavage de leurs ancêtres. Ils n'ont donc pas la même mythologie personnelle que le lecteur « blanc, anglo-saxon et protestant ». C'est sur ce plan surtout que des divergences très nettes apparaissent dans la création littéraire aux États-Unis, car les écrivains juifs et noirs réagissent en fonction d'un code, d'un passé et de valeurs souvent différents (mais un Richard Wright ou un Arthur Miller n'en luttent pas moins pour les droits de l'homme). Désormais, tout ce qui entre dans des catégories très générales, comme existence moderne, vie urbaine et mécanisée, rapports humains stéréotypés, influence dominante de l'argent, individu perdu dans la foule anonyme, ne se détache plus sur le souvenir d'une démocratie provinciale et bon enfant. Le passé, pour certains parmi les Juifs et les Noirs, ce sont les ghettos d'Europe centrale ou les plantations du Sud, et le présent, les ghettos urbains. Même le shtetl d' Isaac Bashevis Singer est trop violent et fabuleux pour faire figure de paradis perdu. Les Désaxés(The Misfits, 1960) d'Arthur Miller, par exemple, illustrent la décomposition lamentable du mythe de l'Ouest. L'« autre pays », titre d'un roman de Baldwin, ne se découvre pas seulement dans la solidarité raciale, la drogue, les aventures sexuelles mais aussi, pour Alice Walker, par exemple, en Afrique même.
La dialectique ville-campagne, la tension entre le présent et le passé, entre la tête et le cœur, qui offraient aux auteurs un riche champ d'exploration et une multiplicité de points de vue n'ont plus grand sens pour un Bellow, un Malamud, un Baldwin. Plus qu'un divorce racial, il y a là sans doute un fait de civilisation contemporaine (le contraste Paris-Province n'est-il pas un thème épuisé ? ), dont des hommes, en un sens sans passé, ont pu mieux et plus vite prendre conscience.
Au cours de la rapide évolution qui a transformé les États-Unis pendant ces dernières décennies, l'écrivain américain a dû aussi renoncer à découvrir l'Amérique et à se découvrir lui-même en se transplantant. Alors qu'Henry James, T. S. Eliot, Ezra Pound, Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, Scott Fitzgerald fuyaient en un temps l'Amérique et s'installaient en Europe, les uns pour y trouver un sens plus pur des valeurs esthétiques et une tradition, les autres pour y vivre plus intensément, de nos jours l'Amérique éprouve moins le besoin d'envoyer ces « ambassadeurs », et, juste retour des choses, c'est à « Woollett » ou à Albany que les écrivains européens vont parfois prendre la mesure du monde moderne.
Le déraciné
Pendant longtemps, en effet, l'un des grands thèmes a été celui de l'enracinement et du déracinement, les deux faces d'un même problème. Hawthorne ou Cooper fouillent les origines de l'histoire nationale. D'autres, en revanche, se contentent du présent et, comme Whitman ou Twain, ils puisent dans l'expansion géographique et l'immensité du continent leur sentiment national. De même Faulkner crée son univers de fiction autour de souvenirs du vieux Sud et s'enracine dans le temps, tandis que Jack Kerouac, qui vagabonde à travers les États-Unis, s'enracine dans l'espace. L'Amérique est, en somme, pour eux une terre natale qui se découvre de l'intérieur et dont il s'agit de prendre les dimensions.
Pour d'autres, au contraire, le déracinement et la distance ont été les seuls moyens de trouver un terme de référence, un point de vue par rapport auquel il serait possible de juger et de comprendre les États-Unis. Pendant près de soixante-dix ans, de la guerre de Sécession à la crise de 1929, c'est un thème central dans les lettres américaines, qu'il s'agisse de Hawthorne dans son dernier roman, Le Faune de marbre (The Marble Faun, 1860), de James, auteur en particulier de L'Américain et des Européens, d'Edith Wharton, de poètes comme Eliot, Pound, Amy Lowell qui vont participer au mouvement imagiste en Angleterre, et bien entendu enfin des exilés célèbres, Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald, Thomas Wolfe, E. E. Cummings, avec leur doyenne, Gertrude Stein, qui dans une œuvre au titre révélateur, The Making of Americans (1925), s'interroge sur la formation complexe et ambiguë du peuple américain.
Ni la prise de conscience de l'intérieur, ni la prise de distance de l'extérieur n'ont apporté de réponse simple et satisfaisante. L'Amérique doit se résigner à une multiplicité d'images et de tensions internes qui, toutes, la définissent imparfaitement. Le mythe de l'homme de la nature, bon sauvage, fermier, chasseur, cow-boy, enfant ou même simple d'esprit, n'est sans doute pas mort, mais il est en train de s'y substituer un homme de la culture qui accepte le pluralisme américain.
Si, avec la Première Guerre mondiale, la littérature américaine a atteint sa majorité, peut-être peut-on dire qu'avec la seconde elle est parvenue à la maturité. La mise en cause de l'Amérique s'est scindée en un certain nombre de provinces, du côté de chez Bellow et du côté de chez Baldwin, les beatniks, métamorphosés en hippies, et puis enfin la vieille maison lézardée du Sud frappée du médaillon de William Faulkner.
Solitude du moi et mystère de l'univers
En tant que littérature nationale, la littérature américaine n'a donc pas réussi à répondre aux questions fondamentales qu'elle se posait, celle de son origine et celle de son patrimoine. On en revient toujours au constat d'indigence établi par James : il se demandait quel pouvait être l'objet d'une œuvre littéraire qui n'avait pas, à proprement parler, de société à dépeindre et qui était privée de milieu culturel pour se développer. Question purement rhétorique, en un sens, puisque la littérature américaine prouvait précisément son existence en s'alimentant aux sources mêmes de ce problème. Prisonnier de la solitude de son moi et de l'univers encore sans signification qui l'entoure, l'écrivain américain est alors condamné soit à une subjectivité radicale soit à la construction d'un monde symbolique.
Des raisons historiques bien connues font de l'Américain un solitaire : la tradition protestante qui souligne le rapport direct entre Dieu et l'homme et le libère ainsi de la tutelle du prêtre et de l'Église, la tradition des pionniers qui favorise l'esprit d'entreprise et l'initiative individuelle, le culte du succès enfin qui, dans une société où, au départ, les hiérarchies sociales n'existaient plus, donnent à chacun la possibilité d'être un jour fils de ses œuvres. À ces différentes formes de solitude s'ajoute celle de l'homme de lettres et de l'artiste, qui trouvent encore mal leur place dans une société où leurs valeurs ne sont pas reconnues. On pense à cette vaste demeure de la fiction imaginée par James, où chaque écrivain se penche à la fenêtre pour observer le spectacle du monde à la longue-vue, mais dans laquelle il ne s'est pas soucié de percer une porte qui donne sur la rue.
Emerson, auteur d'une des meilleures analyses du moi américain, le représente comme un « œil transparent » (et non comme un cerveau pensant ou un cœur ouvert à Dieu ou à la nature) autour duquel s'inscrit l'univers en cercles concentriques. Univers purement intérieur aussi que celui d'Emily Dickinson, poète solitaire d'Amherst, et univers du moi en expansion chez Walt Whitman, qui part de Paumanock et en porte, par l'imagination, les limites jusqu'aux rives du Pacifique et d'une Inde fabuleuse. De même, autour d'Ismaël s'organise le Pequod, véritable microcosme créé par Melville, et autour de Thoreau se dessine l'horizon de Walden Pond, des bois de Concord et de l'Ouest lointain.
À partir de ce centre, l'auteur ou son héros se comportent en poètes, en ce sens qu'ils ne cherchent pas à se soumettre au réel, mais qu'ils construisent un monde de fiction. Il ne s'agit pas ici du vieux problème du « réalisme », tel qu'il se pose chez Balzac ou Dickens. Le but de ces écrivains n'est pas la « peinture de la société », puisque celle-ci n'existe pas encore. Faute d'un ordre social fondé de longue date qui rende la société intelligible, les Américains y substituent un ordre métaphysique et moral qui sous-tend la réalité et l'éclaire de l'intérieur.
La Lettre écarlate (The Scarlet Letter, 1850) de Hawthorne, par exemple, n'a de sens que si l'on admet la présence et l'omniprésence réelles de cette lettre, de ce symbole ; c'est le véritable personnage central de l'ouvrage. Les rapports psychologiques entre les coupables sont en définitive conçus en fonction d'une vérité abstraite sur la nature humaine plutôt que d'une observation exacte du comportement d'individus. On comprendra mieux Moby Dick après avoir lu Spenser (1552-1599) et les poètes métaphysiques anglais du xviie siècle qu'en le comparant aux romans européens du xixe siècle. Même le monde si subtil de James apparaît comme le théâtre où s'affrontent les valeurs de l'Europe et celles de l'Amérique, l'innocence et la corruption, la beauté et la banalité, et non point comme une galerie de personnages. Pour Frank Norris, le chemin de fer est un poulpe qui étouffe le monde rural ; pour Dreiser, les hommes d'affaires s'entretuent comme des crustacés dans un aquarium. Et lorsque Hemingway, Steinbeck, Baldwin, Styron intitulent leurs œuvres Le soleil se lève aussi(The Sun also Rises, 1926), Les Raisins de la colère, Va le clamer sur la montagne (Go Tell it on the Mountain, 1953) ou Réduis en cendres cette maison (Set this House on Fire, 1960) – le titre de la traduction française, La Proie des flammes, n'a pas les mêmes résonances – , il ne faut pas concevoir ces expressions comme de simples allusions bibliques, comme des citations ayant une valeur décorative. Elles donnent, en fait, à l'ouvrage une infrastructure aussi essentielle que celle des cercles de l'enfer chez Dante. Seul Camus, parmi les écrivains français du xxe siècle, fait un usage comparable du symbole dans La Peste ou dans La Chute, et peut-être son enfance et sa jeunesse algériennes dans des « villes sans passé » expliquent-elles cette conception en quelque sorte américaine de la fiction. Contrairement aux Français qui, de Racine à Jean Anouilh ou à Sartre, utilisent l'intrigue et les personnages de l'Antiquité classique à des fins personnelles, les Américains découvrent une vérité fondamentale sur la nature humaine, dans les mythes bibliques ou chrétiens, qui chargent de signification les actes les plus divers, ceux d'un pêcheur cubain pour Hemingway ou ceux d'un caporal de l'armée française pour Faulkner. C'est ici l'essence même de l'attitude transcendantaliste, une recherche intuitive de la réalité sous les apparences et une expression de cette réalité sous la forme d'une métaphore organique. Il s'agit en somme d'une vision du monde poétisée et spiritualisée qui fait de la réalité, telle que nous la révèlent les sens, un vaste théâtre allégorique dont l'art nous donne une image intelligible.
L'écrivain américain nous propose donc toujours, dans une certaine mesure, une énigme à déchiffrer, la quête spirituelle d'un sens. La maison d'Usher ou celle des sept pignons, Poynton, la demeure de Sutpen sont des maisons maudites vouées à l'anéantissement, comme le corps de l'homme est une demeure impure qui sera détruite pour qu'un homme nouveau renaisse dans sa pureté originelle.
Ainsi se recoupent quelques-uns des grands mythes qui nourrissent l'imagination américaine, et plus particulièrement la création littéraire aux États-Unis. Orphelin en quête de ses ancêtres, homme de la nature en quête de son innocence, conscience solitaire en quête d'une signification à donner au monde, l'Américain est engagé dans une contestation permanente de la civilisation dans laquelle il vit. Pris entre le souvenir d'un jardin d'Éden qu'il a reçu et qu'il a perdu et son aspiration à fonder une Cité de Dieu ou une Cité des hommes, dont il voit sans cesse la réalisation s'éloigner de lui, il se raccroche à quelque impossible « rêve américain ». Là se révèle sans doute la clef d'une littérature paradoxale qui, dans un pays né sous le signe du droit au bonheur, offre un tableau de mort et de destruction d'autant plus noir que l'espérance qui l'habite était, et reste malgré tout, plus radieuse.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CHÉNETIER : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de littérature américaine à l'université d'Orléans
- Rachel ERTEL : professeur des Universités
- Yves-Charles GRANDJEAT : professeur des Universités à l'université Bordeaux-Montaigne
- Jean-Pierre MARTIN : professeur d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Provence
- Pierre-Yves PÉTILLON : professeur de littérature américaine à l'université de Paris IV-Sorbonne et à l'École normale supérieure
- Bernard POLI : auteur
- Claudine RAYNAUD : professeure des Universités
- Jacques ROUBAUD : écrivain
Classification
Médias
Voir aussi
- CAHAN ABRAHAM dit ABE (1860-1951)
- DORT SYNODE DE (1619)
- FANTE JOHN (1911-1983)
- PRICE REYNOLDS (1933-2011)
- TOOLE JOHN KENNEDY (1937-1969)
- TYLER ROYALL (1757-1826)
- WALKER MARGARET (1915-1998)
- DE CAPITE MICHAEL
- MCSORLEY EDWARD (1902-1966)
- PANUNZIO CONSTANTINE M. (1884-1964)
- SULLIVAN J. W.
- THORPE THOMAS BANG (1815-1878)
- DIASPORA JUIVE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE
- MÉTISSAGE
- MINORITÉS
- PRÉDICATION
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- MASON-DIXON LIGNE
- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'
- ÉGLISES & SECTES
- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- YIDDISH LANGUE ET LITTÉRATURE
- YIDDISH THÉÂTRE
- CHICANOS
- CANADA, histoire jusqu'en 1968
- HIJUELOS OSCAR (1951-2013)
- DANTICAT EDWIGE (1969- )
- CHRONIQUE
- IMMIGRATION
- NATURE IDÉE DE
- ART NÈGRE
- JUIVE LITTÉRATURE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865
- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- MEXICAINE LITTÉRATURE
- AMÉRICAIN THÉÂTRE
- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES
- AFRO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- CRÈVECŒUR HECTOR SAINT-JOHN DE (1735-1813)
- HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE
- RHODE ISLAND
- READING, poésie américaine
- REXROTH KENNETH (1903-1982)
- JOHNSON EDWARD (1598-1672)
- PARKMAN FRANCIS (1823-1893)
- WINTHROP L'AÎNÉ JOHN (1587-1649) & WINTHROP LE JEUNE JOHN (1638-1707)
- ANTIN DAVID (1932-2016)
- BLACKBURN PAUL (1926-1971)
- CORMAN CID (1924- )
- MATHEWS HARRY (1930-2017)
- O'HARA FRANK (1926-1966)
- OBJECTIVISTES, poésie américaine
- RAKOSI CARL (1910-2004)
- REZNIKOFF CHARLES (1898-1980)
- ROTHENBERG JEROME (1931-2024)
- SPICER JACK (1925-1965)
- WALDROP ROSEMARIE (1932- )
- LONGSTREET AUGUSTUS BALDWIN (1790-1870)
- TOOMER JEAN (1894-1967)
- MATTHEWS JAMES BRANDER (1852-1929)
- ÉCRITURES LES
- ROMANTISME, littérature
- DROITS POLITIQUES
- AFRO-AMÉRICAINS ou NOIRS AMÉRICAINS
- DÍAZ JUNOT (1968- )
- ALVAREZ JULIA (1950- )
- SANTIAGO ESMERALDA (1948- )
- CASTILLO ANA (1953- )
- LATINOS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- ANZALDÚA GLORIA (1942-2004)
- RODRIGUEZ RICHARD (1944- )
- VILLARREAL JOSÉ ANTONIO (1924-2010)
- FAUSET JESSIE REDMON (1882-1961)
- LARSEN NELLA (1891-1964)
- MINSTREL SHOW
- BLACK LIVES MATTER