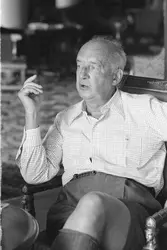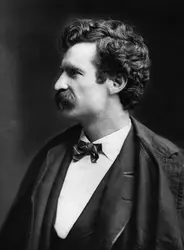- 1. Le problème des origines
- 2. Les thèmes spécifiquement américains
- 3. Du puritanisme au transcendantalisme : une tradition spirituelle et intellectuelle
- 4. Naissance de l'historiographie américaine
- 5. La poésie au XXe siècle
- 6. Le Sud
- 7. La littérature afro-américaine
- 8. Les littératures latinas des États-Unis
- 9. Littératures des minorités
- 10. Bibliographie
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) La littérature
Article modifié le
Littératures des minorités
« J'ai décidé un jour d'écrire l'histoire des immigrants en Amérique. J'ai découvert alors que les immigrants étaient l'histoire de l'Amérique. » Cette formule lapidaire d'Oscar Handlin dans The Uprooted (1951) a le mérite de résumer la formation de la nation américaine mais le défaut de masquer la complexité du problème.
L'asservissement des Noirs, l'ethnocide des Indiens – péchés originels de la nation – constituent la conscience malheureuse de l'Amérique et structurent, explicitement ou non, sa pensée et sa création.
Les souvenirs des vagues d'immigration qui ont déposé sur les côtes du Nouveau Monde les alluvions bigarrées de populations diverses – fierté de la nation – modèlent d'une toute autre façon le rêve américain.
Vint un temps où l'Indien, le Noir, l'immigré et ses descendants cessèrent d'être uniquement objets de l'écriture pour en devenir les sujets. Ils prirent la parole pour dire leur univers tant matériel qu'émotionnel, imaginaire et symbolique.
Les immigrés le firent d'abord dans leurs idiomes natifs. Ainsi se développèrent sur le sol américain une presse, des maisons d'édition, des théâtres qui diffusèrent les œuvres de créateurs qui, tout en vivant aux États-Unis, continuaient à produire dans leurs langues d'origine. Mais, parallèlement, se dégageaient, au sein même de la littérature « américaine », des littératures minoritaires dans la langue hégémonique. Celles-ci relevaient de trois ensembles : la société d'origine, la société d'insertion et la société minoritaire, résultante du rapport dialectique entre les deux premières.
L'un des obstacles qui s'est longtemps opposé à la reconnaissance de ces littératures est leur utilisation de l'américain. C'est là en effet un des problèmes cruciaux auxquels se heurte toute production minoritaire. Pourtant, dans la mesure où toute écriture est nécessairement le « produit de l'homogénéité du dire et du vivre » (H. Meschonnic), elle ne peut qu'intégrer et assimiler, suivant des processus qui lui sont propres, les divers espaces culturels et linguistiques, même résiduels (souvenirs réels ou imaginaires, mémoires fragmentées), auxquels l'auteur appartient.
Le second obstacle tient au seuil numérique à partir duquel on est en droit de parler de la naissance ou de l'éclosion d'une littérature minoritaire. Un auteur isolé, minoritaire ou immigré, quel que soit son génie (Nabokov ou Kazan, par exemple) ne peut fonder le phénomène à lui seul.
La littérature, comme la langue, est le fruit d'un producteur collectif : le changement quantitatif entraîne un changement qualitatif et transforme la nature même du fait. L'abondance des créateurs au sein d'une société minoritaire traduit sa volonté, consciente ou inconsciente, d'exister.
Aussi les études consacrées à ces littératures sont-elles encore peu nombreuses. Il s'agit en outre de capter un phénomène éminemment variable, soumis aux changements du contexte politique et historique international (tels les flux migratoires) et national (situation économique et politique, caractère plus ou moins assimilationniste ou exclusif de la société d'accueil). Par ailleurs, la capacité de maintenir une existence aussi bien institutionnelle et culturelle que littéraire au sein d'une société majoritaire diffère d'un groupe à l'autre.
Parmi ces auteurs, certains ont une inspiration et une audience purement minoritaires, créant l'équivalent d'une sorte de littérature régionaliste ; d'autres, au contraire, utilisent des matériaux, puisent à des sources culturelles spécifiques et atteignent l'universel à travers le particulier.
Le naturalisme tourmenté des écrivains irlandais
Parmi les auteurs irlandais de la fin du xixe siècle, J. W. Sullivan, dans ses Tenement Tales (1895), malgré le caractère parfois mélodramatique de certains de ses contes, parvient à capter les déchirements et les frustrations des immigrés qui, pour échapper à leur condition, ne trouvent parfois d'autres issues que les bas-fonds et la criminalité. Si les Vignettes of Manhattan de Brander Matthews semble une œuvre moins authentique, dans laquelle l'auteur exploite de manière plus systématique les effets de couleur locale, ses évocations de l'influence du milieu (Before the Break of the Day) sur les destins individuels ne manquent pas de force. D'autres auteurs mériteraient d'être mentionnés, tels Edward W. Townsend (Chimmie Fadden, Major Max and Other Stories, 1895), Jim Tully (Shanty Irish, 1928, et Shadows of Men, 1930), Howard Breslin qui, dans Let Go of Yesterday (1950), décrit de façon convaincante l'influence de l'Église catholique sur la communauté irlandaise, l'emprise de la famille sur un adolescent et ses émois face à la découverte de la sexualité. D'une qualité littéraire supérieure, les romans d' Edward McSorley, Our Own Kind (1946) et Kitty I Hardly Knew You (1959), s'attachent à évoquer avec sensibilité et lyrisme la maturation d'adolescents dans un milieu catholique et conservateur, leur découverte de l'amour, des conflits interethniques et des tragédies qui peuvent en découler.
Les auteurs les plus prestigieux qui se rattachent à ce groupe, tout en figurant parmi les écrivains les plus significatifs de la littérature américaine, sont Stephen Crane, James T. Farrell et Eugene O'Neill.
Stephen Crane, dans Maggie : A Girl of the Streets, reprend un des thèmes récurrents des auteurs précédemment cités, celui de la jeune fille acculée à la prostitution pour échapper à son milieu social. Mais le talent de l'écrivain, sa maîtrise stylistique et architectonique, la puissance de son écriture font de Maggie et de ses autres romans des chefs-d'œuvre de la littérature américaine. La prostitution de Maggie devient le symbole de la corruption d'une société et, au-delà, pose les questions éthiques et métaphysiques de la condition humaine.
Toute l'œuvre de James T. Farrell plonge ses racines dans la subculture irlando-américaine de Chicago dont il est issu. Il s'emploie à recréer un milieu aux confins de la petite bourgeoisie et du prolétariat médiocre, vulgaire, bigot, corrompu et corrupteur. Sa trilogie (Young Lonigan, 1932 ; The Young Manhood of Studs Lonigan, 1934 ; Judgment Day, 1935) mène son héros, à travers une enfance trouble, une adolescence inquiète, une jeunesse pervertie par les promiscuités de la rue, l'ivrognerie, les désordres de la sexualité, les maladies vénériennes, jusqu'à la déchéance et la mort. Ce destin, évoqué dans un long monologue intérieur par le père au cours de la veillée funèbre au chevet de son fils, devient emblématique des tares de la société tout entière. Le témoin de la déchéance de Studs Lonigan, Danny O'Neill, est le héros d'un autre roman-fleuve (A World I Never Made, 1936 ; No Star is Lost, 1938 ; Father and Son, 1940 ; My Days of Anger, 1943), qui rappelle le récit précédent par ses techniques naturalistes, mais élargit la vision du milieu américano-irlandais et prend des allures d'éducation aussi bien sentimentale qu'intellectuelle et artistique. La perception psychologique et sociologique des Irlando-Américains de James T. Farrell atteint une plus grande profondeur et sa technique littéraire et narrative plus de finesse dans Gas-House McGinty (1933), portrait d'un homme mûr qui mène une vie étriquée et navrante, mais dont la richesse intérieure compense l'univers médiocre de la quotidienneté. Les recueils de nouvelles, Cabico Shoes (1934), Guillotine Party (1935), Can all this Grandeur Perish (1937), répondent aux mêmes préoccupations et explorent le même milieu et les mêmes thèmes dans des raccourcis souvent saisissants.
L'origine irlandaise d' Eugene O'Neill n'est pas non plus tout à fait étrangère à la thématique et à la forme empruntées par son œuvre dramatique. L'envoûtement de ses sombres drames tient à une sorte d'étrange syncrétisme entre les rêves-cauchemars américains, les légendes celtiques, les mythes grecs et un christianisme perverti et culpabilisant. Le tellurisme et le primitivisme de Beyond the Horizon (1920), The Emperor Jones (1920), The Hairy Ape (1922) atteignent une sorte de grandeur farouche à travers la brutalité même du symbolisme. Desire under the Elms (1924) comme Mourning Becomes Electra (1931) mêlent les mythes grecs et la sourde inquiétude d'un monde voué à la damnation, les crimes et les châtiments infernaux d'êtres emmurés dans leurs fantasmes.
L'envers italien du « rêve américain »
Si la littérature italo-américaine n'a pas dégagé de talents de l'envergure d'un Stephen Crane, d'un James T. Farrell ou d'un Eugene O'Neill, la créativité du groupe ayant emprunté d'autres voies (notamment celles du cinéma), elle a produit néanmoins des œuvres dignes d'intérêt.
Dans son autobiographie, The Soul of an Immigrant, Constantine M. Panunzio, comme nombre d'autres immigrés, dénonce l'exploitation à laquelle ses compatriotes sont soumis, leurs espoirs, leurs frustrations et leur aliénation. Pietro Di Donato est probablement parmi les plus représentatifs des auteurs italo-américains. S'inspirant de sa propre expérience de fils d'immigrés, il créa, avec Christ in Concrete (1939), un roman autobiographique très émouvant, sinon toujours satisfaisant du point de vue formel, qui exprime la révolte devant les promesses non tenues du rêve américain. Three Circles of Light (1960) reprend les mêmes thèmes, mais le « jeune homme en colère » a désormais acquis une plus grande distance, teintée de touches nostalgiques et humoristiques.
Wait Until Spring, Bandini (1938) et Ask the Dust (1939) de John Fante sont des romans d'une grande sensibilité qui peignent les humiliations, les revanches et les malentendus qui empoisonnent les rapports les plus intimes entre les êtres. Mais c'est dans la nouvelle que John Fante excelle, comme le prouve sa série de vignettes Dago-Red (1940). La concision du genre libère Fante des contraintes structurales, de la nécessité d'élaborer des personnages secondaires ; elle donne une plus grande vivacité à son dialogue et rend son écriture plus percutante.
Michael De Capite est un auteur plus ambitieux, dont la formation universitaire est à l'origine à la fois de ses qualités et de ses faiblesses. Son premier roman, Maria, est une étude classique des conditions d'existence dans le ghetto. Il présente les tribulations et les tentations d'une jeune femme qui émerge d'une série d'épreuves, fortifiée, régénérée, rayonnante de force et de tendresse. L'œuvre maîtresse de Michael De Capite, No Bright Banner (1944), est probablement à la littérature italo-américaine ce que, toutes proportions gardées, Les Aventures d'Augie March, de Saul Bellow, est à la littérature juive américaine. De Capite conduit son héros, Paul Barrone, de son point de départ – les taudis de Cleveland – à travers son éveil intellectuel, à l'Université, jusqu'à sa vie de bohème dans Greenwich Village et à son engagement dans la Seconde Guerre mondiale sur le front européen. Les méditations philosophiques du héros – souvent porte-parole de l'auteur –, même si elles sont parfois naïves, n'en posent pas moins certains problèmes qui se trouvent au cœur de la littérature américaine : la contradiction fondamentale entre le sens moral de la nation et son impitoyable cruauté face aux démunis et aux différents.
Ces auteurs italo-américains, auxquels il faut ajouter des poètes comme Thomas Del Vecchio et Vincent Ferrini, ou des prosateurs comme Guido d'Agostino, Michael Fiaschetti, John A. Moroso, Joseph Tucchio et bien d'autres encore, même s'ils ne sont pas des écrivains majeurs, ont imprimé leur marque directement ou indirectement sur l'ensemble de la littérature américaine.
C'est également le cas d'un auteur portoricain comme Piri Thomas, qui décrit la vie de misère et de violence du ghetto new-yorkais dans Down these Mean Streets (1967).
Littératures juives en yiddish et en anglais
L' écriture fut toujours la forme d'expression privilégiée du peuple du Livre. Le pluricentrisme de la société juive maintenait des liens vivaces entre les diverses communautés de la diaspora. La nature particulièrement tragique de leur histoire au xxe siècle, le traumatisme du génocide donnaient à l'identité juive son caractère douloureux et inéluctable. Et les vagues successives de réfugiés et de rescapés l'imposaient à ceux-là mêmes qui auraient été tentés de l'oublier. Enfin, la création de l'État d'Israël, qui, de territoire mythique, devenait réalité politique, exacerbait encore les problèmes d'identification.
Pour toutes ces raisons, la littérature juive existe sur le sol américain depuis plus d'un siècle. En yiddish, elle a donné naissance à une presse foisonnante, atteignant jusqu'à onze quotidiens entre 1915 et 1940 et tirant à 600 000 exemplaires pour une population estimée à 4 650 000 en 1937.
Le théâtre connut un extraordinaire développement, multipliant les troupes d'amateurs et de professionnels. En 1918, rien qu'à New York il en existait vingt, d'une qualité inégale d'ailleurs. Certaines d'entre elles introduisirent aux États-Unis les recherches scénographiques les plus modernes. Celles de Stanislavski, de Vakhtangov, de Meyerhold, d'Otto Brahm (L'Artef, la Folksbine ou l'Art Theatre de Maurice Schwartz) et suscitèrent une pléiade d'acteurs prestigieux (Jacob Ben Ami, Rudolph Shildkraut, Joseph Buloff, Adler...).
La permanence de la littérature yiddish ne se démentit à aucun moment. Le groupe des poètes prolétariens (David Edelstadt, Morris Vintchevsky, Morris Rosenfeld) fut suivi par Di Yunge (« Les Jeunes » : Avrom Liessin, Yehoash, Roïzenblat, Mani-Leïb, M. L. Halpern, H. Leivick), qui voulurent prendre leurs distances à l'égard des idéologies tant nationales qu'universalistes, certains créant une écriture de demi-teintes et de demi-tons presque verlainienne. L'Insihism (introspectionnisme), mouvement moderniste, entreprit la dislocation du vers ; intellectuel, systématique, savant, il intégrait à la poésie yiddish les techniques expérimentales européennes.
L'abondante et remarquable production en prose (Scholem Asch, J. Opatoshu, I. J. Singer, I. Bashevis Singer) se développe en symbiose avec la création yiddish d'Europe de l'Est.
Mais, en même temps, le plurilinguisme, inhérent à l'existence diasporique millénaire de cette société favorise la naissance d'une littérature juive de langue américaine.
Ce furent d'abord les voix du ghetto, œuvres autobiographiques ou semi-autobiographiques (Mary Antin, Anzia Yezierska), qui cherchèrent essentiellement à témoigner et à célébrer leur insertion dans la société nouvelle. Abe Cahan (David Levinsky, The Imported Bridegroom and Other Stories of the New York Ghetto) révèle les problèmes de continuité et de discontinuité, les déchirements et les renoncements que suppose toute acculturation.
Avec la grande crise, les auteurs juifs s'imposent par leur engagement politique, par leur présence massive dans les revues de l'époque et par leur création romanesque décrivant l'exploitation capitaliste et les luttes révolutionnaires qui, seules, permettront à l'homme de retrouver sa dignité (Michael Gold, Albert Halper, Meyer Levin). On voit aussi apparaître le roman de la ville avec The Old Bunch de Meyer Levin, l'expression de la haine de soi avec Jerome Weidman (I Can Get It for You Wholesale...), avec Budd Schulberg (What Makes Sammy Run ?) et s'esquisser déjà certaines formes d'humour attendri ou noir et d'auto-ironie, avec la remarquable trilogie de Daniel Fuchs (Summer in Williamsburg, Homage to Blenholt, Low Company).
Transcendant ces œuvres, se plaçant entre Kafka et Dada, Nathanael West crée alors une sorte d'entre-deux-mondes avec The Dream-Life of Balso Snell, Miss Lonelyhearts, A Cool Million et The Day of the Locust.
Henry Roth, dans Call It Sleep (1934), tout en puisant ses matériaux dans la vie des immigrés, nourrit son roman de l'exploration des zones troubles du psychisme de l'enfant qui se débat dans les rets où l'enferme son histoire familiale. Le récit s'attache à peindre la lutte qui doit aboutir à la libération du fils par une mise à mort symbolique du père. Soixante ans plus tard, son autobiographie (À la merci d'un courant violent, 1994 et 1995) portera un jour nouveau sur ce roman.
Dorénavant, la littérature juive américaine peut entrer dans sa phase la plus féconde. L'intelligentsia juive, en dépit de ses différences et de ses divergences, forme un groupe social d'une étonnante cohésion. Malgré des auteurs traditionnels et bien-pensants comme Leon Uris, Herman Wouk, Chaïm Potok, la majorité de ces écrivains fut à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler la « littérature de l'aliénation », point de convergence de plusieurs courants de pensée et de sensibilité. La notion marxienne de réification s'y associe au sens de l'absurde propre à l'existentialisme et aux conceptions de la psychologie et de la psychiatrie, qui abolissent la distinction rigide entre le normal et l'anormal. Le héros que le roman juif américain met en scène est écartelé entre plusieurs univers culturels, déphasé par rapport à une réalité dont les contours sont désormais brouillés, en rupture avec le monde social et ses normes, avec un univers qui désormais est sorti de ses gonds. Ainsi, des auteurs juifs, comme Isaac Rosenfeld, Charles Reznikoff, Norman Mailer, E. L. Wallant, Bernard Malamud et avant tout Saul Bellow, créaient, paradoxalement, le héros culturel de l'Amérique moderne. De leur malaise existentiel, de leur quête ontologique commune, ces écrivains ont fait naître des univers imaginaires extrêmement divers et fortement individualisés par un art à la fois personnel et subtil.
Les grandes espérances et les grandes désillusions des années 1960 ont fait apparaître, par réaction contre l'intellectualisme, le moralisme, l'esprit de sérieux des auteurs précédents, une contre-culture juive, distincte de celle qui remettait en cause l'ensemble de l'Amérique. Marquée essentiellement par l'humour (souvent par l'humour noir), cérébrale, tournée, par nostalgie parfois, par choix toujours, vers la côte est et l'Europe (à l'inverse de la marche vers l'ouest de l'Amérique de ces années) elle va permettre l'éclosion des talents de Joseph Heller (Catch 22), Philip Roth (Portnoy's Complaint), Herbert Gold, Bruce Jay Friedman, Wallace Markfield, Jerome Charyn (Once upon a Droshky), Stanley Elkin, Grace Paley (The Little Disturbances of Man), Tillie Olsen (Telle Me a Riddle), Cynthia Ozick (The Pagan Rabbi and Other Stories), Woody Allen et bien d'autres encore...
La littérature juive américaine a utilisé tous les genres : la poésie (Charles Reznikoff, Delmore Schwartz, Karl Shapiro, Allen Ginsberg...), le théâtre (Clifford Odets, Arthur Miller...) et surtout le roman, avec une récurrence particulièrement fréquente du roman d'idées, de la chronique familiale, des éducations, du roman picaresque et de la parabole, les recoupements entre ces diverses formes romanesques étant bien entendu constants. Ses personnages les plus représentatifs sont le luftmensch (l'homme qui vit de l'air du temps, de rêves et d'expédients), l'intellectuel tourmenté, aliéné, solitaire dans la mégalopolis moderne, écartelé entre divers univers culturels et des valeurs éthiques contradictoires, et enfin le shlemiel, ce malchanceux qui, par le comique, verbal la plupart du temps, essaie d'apprivoiser un univers hostile, de le vaincre en le réinterprétant. Le shlemiel a été élevé, lui aussi, à travers la littérature et le cinéma (Woody Allen), au niveau d'un mythe culturel.
Le mode d'écriture le plus typique, à côté d'un lyrisme parfois débridé, est cet humour juif – parfois amer, le plus souvent auto-ironique et attendri – qui est la parole du shlemiel. Celle-ci a introduit non seulement une foule de yiddishismes dans la langue américaine mais a donné naissance à un style qui rend compte de façon particulièrement adéquate des caractéristiques culturelles de la société juive, de sa sensibilité particulière, avec les inflexions de la langue d'origine (même oubliée) et qui reste parfaitement limpide et familier à un lecteur extérieur à ce groupe.
Il va sans dire que les auteurs juifs ont abordé tous les thèmes, mais certains d'entre eux, récurrents, obsédants même, donnent à ces écrivains leur marque spécifique, leur cohérence, peut-être leur unité en tant que groupe.
Parmi ces thèmes figurent la centralité de la famille ainsi que ses conflits, emblématiques des affrontements entre divers univers culturels. L'écartèlement, le déchirement que suppose cette situation a donné naissance à la « littérature de l'aliénation » ; il se traduit par une sorte d'exil intérieur, par le bannissement hors d'une histoire que ces auteurs ont sans cesse cherché à s'approprier en amont par la quête des origines comme en aval par la conquête du politique et de l'éthique.
Évolution commune et traits caractéristiques
La saisie des littératures minoritaires apparaît comme un défi. En premier lieu parce que celles-ci sont protéiformes et infinies par définition. Par ailleurs, les littératures minoritaires sont avant tout des littératures : l'ethno-analyse n'est donc qu'une approche parmi d'autres et ne peut rendre compte que de certains aspects des œuvres.
Cette méthode permet de dégager des caractéristiques communes dans l'immense variété des littératures minoritaires. On peut dire, en schématisant, que leur évolution passe par quatre étapes principales.
La naissance des littératures minoritaires est liée à la grande vague d'immigration de la fin du xixe et du début du xxe siècle. La brutalité de l'industrialisation et de l'exploitation par le capitalisme sauvage d'une Amérique en pleine expansion entassa les nouveaux arrivants dans les taudis des grands centres urbains de la côte est ou dans les cabanes des ouvriers migrants le long des chemins de fer ou des canaux en construction. La misère qu'elle engendra fut à l'origine d'un vaste mouvement de protestation et de réforme qui coïncida, dans le domaine littéraire, avec l'apparition du réalisme et du naturalisme. Le point de départ des diverses littératures des immigrés s'inscrivit dans cette esthétique de la « vérité ». En essayant de donner une vision de l'intérieur du groupe minoritaire, de l'expliquer à la société d'insertion, l'auteur fit appel à la couleur locale, au pittoresque, à « l'étrangeté » de son matériel humain et social. Il devint le porte-parole de son groupe et prêta sa voix aux ghettos.
Dans un second temps, l'auteur se voulut redresseur de torts. Il s'érigea contre les iniquités du système, contre la discrimination politique, économique et sociale.
Le troisième stade offre une complexité esthétique et une richesse thématique plus grandes. Il relève déjà de cette « double vision » qui vient de l'appartenance simultanée à deux ensembles sociaux, culturels et imaginaires, celui du groupe d'insertion et celui du groupe minoritaire. Il traduit la posture et l'esthétique du « dehors-dedans » qui est typiquement celle du minoritaire.
Avec l'émergence du mouvement de la « nouvelle ethnicité », l'auteur minoritaire retrouve sa fonction de porte-parole du groupe et de critique social mais enrichie par les expériences précédentes qui ont fait naître une forme de nostalgie pour un passé souvent mythifié (et fécond sur le plan symbolique et formel), tout en favorisant l'expérimentation de combinaisons et de synthèses nouvelles et inédites.
Un certain nombre de thèmes récurrents caractérisent ces littératures minoritaires aux États-Unis. L'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Monde apparaît dans de multiples variantes dont la complexité va croissant. Dans un premier temps, le rejet de l'Ancien Monde et le désir d'identification avec l'Amérique constitue un véritable leitmotiv. Le symbolisme religieux est presque constant. Il a recours principalement à deux métaphores : la mort et la résurrection ou la lente conversion à l'américanité. Celle-ci ne va pas sans affres ou sans heurts entre les générations et s'accompagne le plus souvent d'un conflit culturel avec la société dominante. Ce conflit trouve son incarnation ou sa dramatisation dans la relation amoureuse. L'abîme qui sépare l'Ancien Monde du Nouveau ne peut être aboli que par l'union de deux êtres appartenant à ces deux sphères opposées. Les déchirements que connaissent les héros donnent à l'œuvre sa tension. Souvent la femme minoritaire incarne les forces telluriques, l'enracinement, par opposition aux valeurs de la société dominante. Le rejet de ses origines par l'un ou l'autre des protagonistes prend des allures de trahison et emprunte ses ressorts dramatiques au dilemme faustien : la perte de l'âme – de l'identité – en échange de la réussite sociale.
À mesure que ces littératures deviennent plus complexes et plus raffinées, les thèmes abordés gagnent en profondeur, notamment dans l'exploration du rapport à l'histoire. Par opposition au continent américain, symboliquement vierge et tourné vers l'avenir, l'Europe et le passé minoritaire deviennent l'incarnation de l'histoire.
Paradoxalement, le personnage minoritaire en vient à symboliser le héros moderne de l'Amérique par son écartèlement entre deux mondes, entre deux cultures. Il devient l'homme « aliéné » dans le sens social et dans le sens psychiatrique du terme, caractérisé par une « schizophrénie », une fêlure de l'être qui se marque par une ambivalence foncière des pensées, des sentiments et des conduites. Cette tension émotionnelle se décharge en force créatrice qui fait souvent des héros de ces œuvres des artistes, des écrivains en puissance ou en devenir.
Sur le plan formel, les littératures minoritaires présentent la même diversité que la littérature américaine en général. Dans les deux cas la notion de producteur collectif ne nie pas le talent individuel, elle lui est complémentaire. Mais dans les deux cas des récurrences sont observables.
La dynamique à laquelle les littératures minoritaires obéissent est soumise à des forces contradictoires. Celles-ci dépendent tout d'abord du lectorat même. Toute littérature se crée pour une masse de lecteurs hétérogènes. Mais les littératures minoritaires s'adressent toujours à deux ensembles distincts, s'engagent sur un double « contrat de lecture » (Philippe Lejeune). Il leur arrive alors de se cantonner dans une attitude explicative, défensive, prudente, qui est un frein à l'innovation.
À l'inverse, la situation intermédiaire des auteurs minoritaires a eu souvent pour résultat de jeter un pont entre l'Amérique et l'Europe, l'Afrique, l'Asie et de faire passer un souffle cosmopolite sur une culture qui, étant donné l'immensité du continent américain et sa puissance économique et politique, n'aurait peut-être pas résisté à la tentation du repli sur soi.
Enfin, la marginalité existentielle des écrivains minoritaires par rapport aux deux ensembles sociaux dont ils font partie a souvent été propice à l'innovation et à l'expérimentation formelles. Elle a donné naissance à une écriture de l'ambivalence qui a pris la forme de la distanciation soit ironique soit poétique. Dans les deux cas, il s'agit de choix non pas formels mais ontologiques. Ironie, humour, autodérision deviennent des modes d'être. La poésie ne dévoile pas au lecteur les univers culturels à la lisière desquels l'auteur se tient sans pouvoir lui-même y pénétrer : elle lui fait partager les mystères qu'ils recèlent.
Le même processus affecte la langue utilisée par ces auteurs : on assiste tantôt à sa contamination par les idiomes minoritaires, même s'ils sont inconnus, oubliés, refoulés, tantôt à sa « déterritorialisation » (Deleuze et Guattari).
Toutes les littératures minoritaires ne présentent pas l'ensemble de ces caractéristiques. Certaines se sont arrêtées en route après avoir épuisé leur fonction de littérature de ghetto par l'absorption du groupe dans la société dominante. D'autres n'ont peut-être pas encore porté tous leurs fruits ou bien la minorité a adopté d'autres formes d'expression. Seule la littérature juive semble avoir couvert l'ensemble du spectre évoqué, parce que l'expression littéraire est son mode de création privilégié et parce qu'elle a rencontré un terreau favorable dans la culture d'insertion. L'existence de ces littératures minoritaires n'en reste pas moins capitale, d'abord comme indice du caractère ouvert d'une société, ensuite comme contribution indispensable à la richesse, à la polyphonie de toute littérature. Au-delà, elle démontre qu'à l'origine de toute grande culture se trouve le métissage et prouve une fois de plus la supériorité de l'impur sur le pur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Marc CHÉNETIER : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de littérature américaine à l'université d'Orléans
- Rachel ERTEL : professeur des Universités
- Yves-Charles GRANDJEAT : professeur des Universités à l'université Bordeaux-Montaigne
- Jean-Pierre MARTIN : professeur d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Provence
- Pierre-Yves PÉTILLON : professeur de littérature américaine à l'université de Paris IV-Sorbonne et à l'École normale supérieure
- Bernard POLI : auteur
- Claudine RAYNAUD : professeure des Universités
- Jacques ROUBAUD : écrivain
Classification
Médias
Voir aussi
- CAHAN ABRAHAM dit ABE (1860-1951)
- DORT SYNODE DE (1619)
- FANTE JOHN (1911-1983)
- PRICE REYNOLDS (1933-2011)
- TOOLE JOHN KENNEDY (1937-1969)
- TYLER ROYALL (1757-1826)
- WALKER MARGARET (1915-1998)
- DE CAPITE MICHAEL
- MCSORLEY EDWARD (1902-1966)
- PANUNZIO CONSTANTINE M. (1884-1964)
- SULLIVAN J. W.
- THORPE THOMAS BANG (1815-1878)
- DIASPORA JUIVE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions
- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE
- MÉTISSAGE
- MINORITÉS
- PRÉDICATION
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- MASON-DIXON LIGNE
- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'
- ÉGLISES & SECTES
- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- YIDDISH LANGUE ET LITTÉRATURE
- YIDDISH THÉÂTRE
- CHICANOS
- CANADA, histoire jusqu'en 1968
- HIJUELOS OSCAR (1951-2013)
- DANTICAT EDWIGE (1969- )
- CHRONIQUE
- IMMIGRATION
- NATURE IDÉE DE
- ART NÈGRE
- JUIVE LITTÉRATURE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865
- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- MEXICAINE LITTÉRATURE
- AMÉRICAIN THÉÂTRE
- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES
- AFRO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- CRÈVECŒUR HECTOR SAINT-JOHN DE (1735-1813)
- HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE
- RHODE ISLAND
- READING, poésie américaine
- REXROTH KENNETH (1903-1982)
- JOHNSON EDWARD (1598-1672)
- PARKMAN FRANCIS (1823-1893)
- WINTHROP L'AÎNÉ JOHN (1587-1649) & WINTHROP LE JEUNE JOHN (1638-1707)
- ANTIN DAVID (1932-2016)
- BLACKBURN PAUL (1926-1971)
- CORMAN CID (1924- )
- MATHEWS HARRY (1930-2017)
- O'HARA FRANK (1926-1966)
- OBJECTIVISTES, poésie américaine
- RAKOSI CARL (1910-2004)
- REZNIKOFF CHARLES (1898-1980)
- ROTHENBERG JEROME (1931-2024)
- SPICER JACK (1925-1965)
- WALDROP ROSEMARIE (1932- )
- LONGSTREET AUGUSTUS BALDWIN (1790-1870)
- TOOMER JEAN (1894-1967)
- MATTHEWS JAMES BRANDER (1852-1929)
- ÉCRITURES LES
- ROMANTISME, littérature
- DROITS POLITIQUES
- AFRO-AMÉRICAINS ou NOIRS AMÉRICAINS
- DÍAZ JUNOT (1968- )
- ALVAREZ JULIA (1950- )
- SANTIAGO ESMERALDA (1948- )
- CASTILLO ANA (1953- )
- LATINOS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
- ANZALDÚA GLORIA (1942-2004)
- RODRIGUEZ RICHARD (1944- )
- VILLARREAL JOSÉ ANTONIO (1924-2010)
- FAUSET JESSIE REDMON (1882-1961)
- LARSEN NELLA (1891-1964)
- MINSTREL SHOW
- BLACK LIVES MATTER