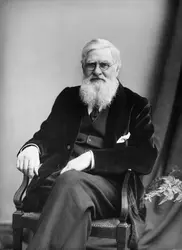ETHNOLOGIE Histoire
Article modifié le
De la Renaissance à la révolution industrielle
À partir du xve siècle, l'expansion européenne bouleverse les univers culturels relativement isolés jusque-là, et des humanités « nouvelles » apparaissent dans le savoir et la conscience européens. La découverte de l'Amérique, en particulier, parce qu'elle n'était pas prévue, apporte un choc dont les répercussions se font sentir dans tous les domaines de l'entendement et de la sensibilité. L'humanité même des Américains, comme celle des Africains à partir de l'exploration et de l'esclavage portugais au xve siècle, est en question. Il ne s'agit pas seulement d'une interrogation métaphysique ; il s'agit d'une question politique, économique et concrète urgente. Après une brève période, variable selon les régions (et qui se reproduit au xviiie siècle dans le Pacifique), de vision « paradisiaque » de l'humanité américaine, qui prolonge la mythologie médiévale, les dures réalités de la conquête, puis de l'exploitation économique, des mécanismes de domination politique et de l'effrayante mortalité amérindienne (par les maladies du contact) imposent la création d'un nouveau savoir. Les auteurs sont multiples – conquistadores, missionnaires, administrateurs, colons, marins, théologiens, négociants, moralistes et philosophes, historiens et juristes – mais les interrogations sont toutes les mêmes. Où doit-on placer ces humains dans le tableau général (biblique) de l'humanité ? Quels rapports historiques entretiennent les Américains avec l'humanité connue ? Quelle place occupent les nouveaux phénomènes observés dans la nature ? Quelle est la nature et l'origine de leurs institutions et de leurs croyances ? Les réponses successives, contradictoires et passionnées, qui sont apportées à ces questions constituent sans doute la première grande source de l'ethnologie. Cet ébranlement initial du savoir instaure une tradition continue d'examens et de débats, entretenue par les réalités du mercantilisme et de la christianisation. Des bouleversements connexes, dans d'autres domaines de la connaissance (les débuts de l'anatomie et de la physiologie, la révolution copernicienne), remettent en cause l'européocentrisme spontané : ni la Terre, ni le corps, ni l'Europe ne sont plus le centre et la mesure de toute chose.
Dès la fin du xvie siècle, pour ne citer qu'un exemple, Joseph de Acosta publie L'Histoire naturelle et morale des Indes orientales (1589, Séville). Non seulement il propose un tableau général des productions naturelles de l'Amérique et de ses peuples, à partir d'une expérience directe d'observateur et de la lecture d'une masse impressionnante de témoignages, y compris indigènes, mais encore justifie l'autonomie relative d'un projet scientifique, en le jugeant « utile » (à la christianisation et à la colonisation), et avance, dans sa classification des peuples, un argument théorique qui la fonde. La complexité croissante des formes de gouvernement repose sur une acquisition graduelle de la rationalité. L'idée est empruntée à Aristote ; son application mène à l'évolutionnisme. Pour séduisante que soit l'anthropologie de J. de Acosta, elle ne représente qu'un aspect des spéculations de l'époque. Il faut considérer aussi le choc en retour. Depuis Jean de Léry et Montaigne, la multiplication des expériences humaines, naturelles et morales, connues, favorise l'esprit critique et l'examen relativiste de nos institutions, coutumes et croyances.
Au xviiie siècle, un triple mouvement intellectuel va donner naissance au projet scientifique de l'anthropologie. Les sauvages et les barbares, contemporains lointains mais synchrones de l'Européen, vont être situés dans une histoire universelle. À partir de Lafitau, l'un des premiers à systématiser la comparaison entre le sauvage et les Anciens (1724), le sauvage devient un primitif ; il prend place dans une série ordonnée, qui part du simple et progresse vers le complexe, et qui a valeur universelle. La question ne sera plus « pourquoi le sauvage est ce qu'il est ? », mais « comment n'a-t-il pas progressé au même rythme que nous ? » On conçoit qu'il est moins malaisé de répondre à la seconde qu'à la première. Dans la seconde moitié du siècle, en France, en Allemagne et en Écosse, les « histoires de l'homme » se multiplient, et un schéma évolutionniste à quatre stades devient lieu commun ; certains auteurs (Kames, Dunbar) proposent même une théorie matérialiste du passage d'un stade à l'autre. Par ailleurs, la société, ou la sociabilité, devient un objet spécifique d'enquête et de réflexion. Montesquieu, dans L'Esprit des lois, qui insiste sur la nécessaire interdépendance des phénomènes sociaux, est un fonctionnaliste avant la lettre ; sa distinction entre la « nature » de la société et son « principe » (les passions, qui en sont le moteur) rend possible la considération comparative de l'organisation sociale. Il n'y a qu'un pas de la considération du politique à celle du social ; et c'est Démeunier qui, avec plus d'ambition que de profondeur, inaugure, dans L'Esprit des usages et coutumes des différents peuples ou Observations tirées des voyageurs et des historiens (1776), la comparaison systématique des coutumes et des institutions des peuples du monde, en suivant le plan « récapitulatif », où la phylogenèse reproduit l'ontogenèse. Enfin, le xviiie siècle voit naître la science de la nature ; la nature n'est plus, chez Linné, le merveilleux résultat de la Création ; le système de la nature, en revanche, l'est. À partir de Linné, on cherche, non seulement à améliorer la classification, mais à constituer une histoire de la nature. L' homme, tout en demeurant un être naturel et moral, fait partie du système et doit donc appartenir aussi à l'histoire naturelle. Les différences raciales deviennent l'objet, non plus seulement de descriptions interprétatives, mais de systématisation, de collectes et de séries, de mesures et de corrélations. Le dernier quart du xviiie siècle voit une imposante floraison de travaux sur la nature (et les variétés) de l'homme, de Buffon à Blumenbach et Camper.
Ces trois grands courants de pensée sont loin d'être des compartiments étanches : à partir de 1760, un nombre croissant de savants tentent de penser systématiquement et scientifiquement le problème de l'homme, physique et moral, social et naturel, variable historiquement et naturellement, mono-spécifique et racialement divers. En 1772, l'historien allemand Schlözer utilise pour la première fois le terme ethnographisch, voulant caractériser « une méthode linnéenne pour traiter de l'histoire particulière », celle de chaque peuple. Dans les universités du nord de l'Allemagne, liées à l'Angleterre, des « historiens de l'humanité » esquissent, dans des cours et des publications, le programme de l'ethnologie. Ils constituent des recueils systématiques et formulent des hypothèses générales (C. Meiners, G. Forster, qui participe à la seconde circumnavigation du capitaine Cook). En 1799, une partie des Idéologues, ainsi que des médecins, naturalistes et historiens se constituent en société pour observer l'Homme : la Société des observateurs de l'homme (1799-1805), première société savante à vocation ethnologique, publie des mémoires originaux et surtout les célèbres Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages. Ce mémoire de J. M. de Gérando (1800) est un véritable guide d'enquête, qui doit servir à l'expédition du capitaine Baudin dans les mers du Sud, mais il est aussi une proclamation, dans le style lyrique et pompeux caractéristique des écrits de cette époque, de la nécessité d'établir une science nouvelle, une « science de l'homme ». Ainsi, dans l'Europe des Lumières, on trace le programme de l'anthropologie ou « histoire naturelle de l'homme » ; ce programme reste abstrait et le lien entre des propositions générales, un corpus de données et une méthode de collectes et d'analyse n'est pas traduit dans une pratique ; néanmoins, il annonce et l'éclosion des chaires universitaires, sociétés savantes, voyages d'exploration plus systématiques et la réalisation d'une nouvelle entreprise du savoir humain dans la seconde moitié du xixe siècle, même si, selon les termes de Kant en 1788, « pour la plupart des questions un blanc pourrait rester ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Patrick MENGET : assistant à l'université de Paris-X
Classification
Médias
Autres références
-
AFRICAINS CINÉMAS
- Écrit par Jean-Louis COMOLLI
- 1 131 mots
L'histoire des cinémas africains se sépare difficilement de celle de la décolonisation. Il y eut d'abord des films de Blancs tournés en Afrique. Puis, à partir des années soixante, les nouveaux États africains ont été confrontés au problème de savoir quel rôle, quelle orientation, quels...
-
ANTHROPOLOGIE
- Écrit par Élisabeth COPET-ROUGIER et Christian GHASARIAN
- 16 161 mots
- 1 média
En Europe, le terme « anthropologie » désigna longtemps l'anthropologie physique, ce qui explique l'usage général du mot« ethnologie » pour les études s'appliquant à l'aspect social et culturel des populations, tandis que la préhistoire, l'archéologie et la linguistique constituaient des domaines... -
ANTHROPOLOGIE RÉFLEXIVE
- Écrit par Olivier LESERVOISIER
- 3 449 mots
...dans la prise de conscience de la nécessité de ne plus passer sous silence les effets de la dimension intersubjective de l'enquête de terrain. En dévoilant les frustrations et les colères de l'ethnologue contre ses hôtes, l'ouvrage révèle le caractère illusoire d'une observation neutre et montre... -
ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 847 mots
- 3 médias
...développé cette même problématique des zones hors de l’État, cette fois à propos des hauts plateaux entre Soudan et Éthiopie. Combinant archéologie et ethnologie, il recense les diverses stratégies qu’ont adoptées différents groupes ethniques face à l’État, certains ayant opposé une résistance radicale,... - Afficher les 37 références
Voir aussi