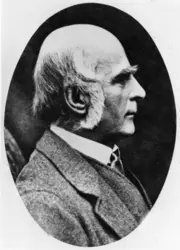EUGÉNISME
Article modifié le
Vers un nouvel eugénisme ?
Si l'invention des techniques de stérilisation n'avait pas suivi de près celle de la théorie eugénique, les thèses des nombreuses sociétés d'eugénisme qui venaient de naître n'auraient pu déboucher que sur l'exacerbation de pratiques politiques, d'inspiration protectionniste ou raciale, déjà présentes ici ou là. La possibilité, grâce à la stérilisation, d'interdire une descendance pour certaines personnes, sans attenter à leur existence même, fut le premier tribut payé par la science médicale à l'eugénisme contemporain.
Une pratique illusoire
Il faut ici expliquer pourquoi l'interdit de procréation imposé à certaines personnes n'avait aucune chance de répondre au but eugénique en éliminant la contribution d'individus déficients (ou considérés comme tels) au futur patrimoine génétique de l'espèce. En fait, un tel projet, même s'il avait été maintenu au fil de plusieurs générations, n'aurait pu éviter des obstacles d'au moins trois natures différentes, obstacles qui condamnaient le projet à demeurer une catharsis plutôt qu'une attitude rationnelle.
Le premier de ces obstacles est dans la différence entre l'identité génétique et la réalité de chaque personne. On sait aujourd'hui que ce que nous sommes (le phénotype) résulte d'interactions complexes entre ce qui nous fut donné à la fécondation (le génotype) et les influences apportées par le milieu environnant. Ce qui signifie qu'on ne peut déduire les caractéristiques génétiques d'une personne en considérant seulement ce qu'elle est devenue, et donc que la sélection de certains phénotypes ne constitue qu'une illusion dans le projet de sélection des génotypes. Un second obstacle est inhérent à l'arbitraire de la qualification des personnes. Si on sait définir les qualités qu'on exige des animaux ou plantes utiles à l'homme (justement parce que ces espèces furent sélectionnées selon des besoins humains) on est incapable de dire ce que l'homme apporte à l'espèce humaine. Tel athlète honoré dans l'arène olympique a-t-il une « valeur » supérieure à tel poète immortel ou tel mathématicien ? A contrario tel voleur de poules est-il de « valeur » inférieure à un gagnant du tiercé, un chanteur à la mode, ou un patron compétitif ? Toute réponse à ces propositions est référée à des choix idéologiques ou sociaux qui n'ont aucune signification pour l'espèce biologique que l'eugénisme prétend défendre. Enfin une troisième contradiction au simplisme des théories eugéniques me semble déterminante : même en faisant abstraction des distorsions entre le génome et la personne, même en admettant qu'un jury de sages soit capable de distinguer certaines personnes, meilleures ou pires que les autres, il reste que les mécanismes biologiques de la procréation annulent l'ambition eugénique de reproduire le meilleur ou de contrecarrer le pire. Il suffit de considérer qu'un seul couple humain serait capable de générer autant d'individus différents entre eux que la terre compte d'habitants. Pour le dire autrement, chaque spermatozoïde et chaque ovule sont issus d'une loterie génétique dont les solutions sont tellement variées que, par exemple, parmi les cent millions de spermatozoïdes que produit chaque jour n'importe quel homme, il n'est pas deux gamètes identiques. On comprend immédiatement que tout eugénisme conséquent se devrait d'examiner les gamètes plutôt que leurs géniteurs, examen qui demeure hors de portée de la biologie moderne. C'est pourquoi la stérilisation de personnes jugées déficientes (physiquement, mentalement ou socialement), telle qu'elle fut pratiquée dans les pays démocratiques, n'avait pas plus de valeur scientifique que les crimes nazis.
Mais la fin du cauchemar nazi ne peut être assimilée à la disparition de l’idéologie eugénique. Seul le mot devient tabou au milieu du xxe siècle. À tous les substantifs qui, au cours des derniers siècles, avaient désigné le désir obsessionnel de qualité humaine (callipédie, gonocritie, mégalanthropogénésie, aristogénie, anthropotechnie, sociotechnie, sociobiologie, orthobiose, hominiculture, biocratie, eubiotique, etc.) se sont substitués récemment de nouveaux termes, à prétention médico-scientifique, comme « orthogénie » ou « progénisme ». La déqualification de l'eugénisme après la barbarie nazie a accompagné le triomphe du concept des droits de la personne dans les pays industrialisés : la loi du plus fort contre les libertés et la dignité s'est trouvée presque unanimement repoussée, au moins dans les discours et les législations.
Le déplacement de la question
Puisqu'il n'était plus question d'intervenir sur les citoyens contre leur gré, l'eugénisme a pris des formes nouvelles, principalement en proposant des solutions que les intéressés eux-mêmes pouvaient revendiquer plutôt que subir.
L' insémination artificielle fut, dès l'après-guerre et particulièrement aux États-Unis, la technique de choix pour une pratique d'eugénisme positif, grâce au recrutement de géniteurs sélectionnés dont la semence est proposée selon les lois du marché.
Une autre pratique eugénique récente mérite d'être citée : ne s'embarrassant d'aucune technologie, elle puise sa modernité dans le système économique libéral et l'évitement de toute contrainte sur les individus. Il s'agit du dispositif d'aide à la famille imaginé à Singapour, basé sur l'hypothèse simple (simpliste !) que la compétitivité est fille de l'intelligence, laquelle se mesure à l'ampleur des diplômes obtenus. Tout couple de diplômés est alors fortement récompensé pour son activité procréatrice tandis que tout couple dont les deux membres sont dépourvus de diplômes est également passible de récompense, mais seulement s'il s'abstient de procréer...
Par ailleurs les analyses de laboratoires sont devenues capables de déceler des anomalies dans le nombre de chromosomes (aneuploïdies) ou des mutations de certains gènes, et, couplées à l'échographie fœtale, ces examens apportent une information déterminante à la femme enceinte pouvant motiver l'interruption médicale de grossesse (I.M.G.). Ces techniques constituent pour la première fois une approche rationnelle et fiable de la normalité des enfants. La prééminence abusive de la génétique dans la science contemporaine amène cependant à imaginer une incidence sociale à partir de corrélations statistiques entre la présence de tel gène ou telle caractéristique d'une personne. Mais la complexité du vivant, en particulier pour les comportements humains, est telle que toute information génétique se trouve noyée dans ses interactions avec l'environnement. C'est alors par abus statistique, en même temps que par pesanteur idéologique, que certains imaginent prévoir le comportement d'un enfant à partir de l'analyse de son génome.
La première intervention de la science génétique dans la procréation médicalement assistée est apparue en France en 1973 à l'occasion de l'insémination artificielle avec donneur de sperme (I.A.D.). Le choix d'un donneur par la médecine met alors en jeu des critères complémentaires de ceux requis par l'analogie phénotypique entre le donneur et le mari stérile. En pratique on évite par exemple d'utiliser le sperme d'un donneur dont la famille a connu des cas de diabète, maladies cardio-vasculaires, asthme, etc., pour une femme issue d'une famille où sont apparues les mêmes affections. Une telle pratique « d'appariement de couples reproducteurs » (expression utilisée par les banques de sperme) reprend le projet améliorateur de l'eugénisme galtonien, avec des différences évidentes que nous évoquerons plus loin.
Pour autant, à ce point de l'histoire récente de l'eugénisme, il apparaît que les pratiques médicales ont été jusqu'ici impuissantes à la réalisation des fantasmes eugéniques de la société. Soit leur emploi relève de l'utopie en négligeant l'importance des hasards biologiques (stérilisation ou I.A.D.), soit elles surviennent en aval de ces hasards, sur le fœtus déjà constitué (I.M.G.), et leur impact est alors circonscrit à la famille et limité par la pénibilité des interventions.
Une proposition technique à la hauteur du projet eugénique défini par Galton devrait répondre à plusieurs exigences : la pertinence, qui implique que la sélection porte sur le génotype des individus et non sur leur phénotype ; la sagacité, obtenue par le recours à des moyens précis d'analyse de caractéristiques précises ; l'efficience qui augmente avec la pluralité des caractéristiques analysées au cours d'un même acte médical, l'acceptabilité, grâce à laquelle la proposition médicale peut susciter une adhésion massive.
Un eugénisme désirable ?
Pour la première fois, une perspective eugénique adaptée à ces exigences est apparue et elle devrait connaître des développements importants dans les prochaines décennies. Il s'agit de la sélection ultraprécoce des meilleurs produits de conception pour chaque couple, aussi nommée diagnostic pré-implantatoire des embryons (D.P.I.). Cette méthode, encore balbutiante, est aujourd'hui considérée par ses promoteurs comme une façon d'éviter l'I.M.G. en éliminant les embryons déficients avant même le début de la grossesse. Pourtant, tout porte à croire que le D.P.I. va se développer selon une stratégie où l'eugénisme se démontrera de mieux en mieux. L'enjeu est de multiplier abondamment le nombre d'embryons produits simultanément par un même couple, actuellement à l'occasion d'une fécondation in vitro. Ces embryons, tous différents entre eux quand bien même ils seraient des milliers, seront ensuite analysés selon de multiples critères génétiques et le « meilleur » pourra être reconnu pour ses promesses de résister à des pathologies variées ou d'être capable de certaines performances. C'est ce meilleur (ou les quelques meilleurs) embryon généré par chaque couple, qui sera finalement à l'origine de la grossesse et de la naissance d'un enfant. Dans L'Œuf transparent (1986), nous imaginions le glissement du concept même de « handicap » grâce à la nouvelle permissivité apportée par le tri embryonnaire, nous caricaturions l'avenir en évoquant l'élimination de la myopie ou du strabisme...C'est fait ! La Haute Autorité britannique pour la procréation médicalisée a autorisé en 2007 une clinique londonienne à recourir au D.P.I. pour éviter la naissance d'un enfant atteint de strabisme.
Avec une telle stratégie, l'eugénisme ne fait pas que se débarrasser de violences devenues aujourd'hui inadmissibles comme la castration ou l'infanticide. Il admet que chaque personne, chaque couple, est capable du meilleur comme du pire, et promet de débusquer le meilleur. Ce faisant il peut accéder à la fois à l'efficacité, toujours prétendue mais jusqu'ici illusoire, et à la reconnaissance massive. Dans un article écrit avec Bernard Sèle en 1998, nous avons montré que les savoir-faire nécessaires pour ce nouvel eugénisme se mettent en place rapidement. Finalement on voit bien que le comble de l'eugénisme serait de fixer des « génomes d'intérêt » grâce à leur reproduction à l'identique, en faisant l'économie de la hasardeuse procréation sexuée : le comble de l'eugénisme est bien le clonage.
Incontestablement, la biologie contemporaine produit donc des connaissances et des technologies qui révolutionnent la capacité des humains à maîtriser les caractéristiques de leurs enfants. Un débat s'est ouvert depuis plusieurs années pour déterminer si les nouvelles pratiques médicales dont il est question ici (appariement dans l'I.A.D., élimination dans l'I.M.G., sélection dans le D.P.I.) relèvent ou non de l'eugénisme. Les arguments pour refuser cette appartenance font état du caractère médical des actes (ils concernent des pathologies et non des facteurs esthétiques ou des qualités intellectuelles), du volontariat des personnes qui y participent (souvent demandeuses et jamais contraintes) et de la mise en œuvre de ces actes dans des cas particuliers plutôt que pour des populations. Fort heureusement, le nouvel eugénisme n'a pas le caractère autoritaire et les effets mutilants de sa première version « scientifique » du début du xxe siècle. Pourtant c'était déjà avec la caution et même avec la recommandation médicale que des individus furent stérilisés pour les raisons les plus variées. Plutôt que laisser croire que la sélection des embryons n'a rien à voir avec la castration des adultes, mieux vaut s'interroger sur les angoisses et les désirs qui nourrissent l'une et l'autre. Et aussi sur le risque totalitaire que comporterait la systématisation de pratiques sociales prétendant réaliser de tels fantasmes, même si c'est au nom du progrès et de la compassion.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André PICHOT : chercheur au C.N.R.S. en épistémologie et histoire des sciences
- Jacques TESTART : directeur de recherche honoraire à l'INSERM
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Média
Autres références
-
ABORIGÈNES AUSTRALIENS
- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI
- 7 154 mots
- 5 médias
...chasses semi-nomades et souvent de pratiquer leurs rites et d'élever eux-mêmes leurs enfants. Au début du xxe siècle, un missionnaire allemand, T. J. Bishof, appointé « protecteur » des Aborigènes du Nord-Ouest, proclama, en plein accord avec les doctrines eugénistes régnant à cette époque, que... -
BIOLOGISME
- Écrit par Sébastien LEMERLE et Carole REYNAUD-PALIGOT
- 2 772 mots
...Durant l’entre-deux-guerres, ces thématiques sont encore omniprésentes, la psychologie des peuples connaît un grand succès au sein du monde académique. L’eugénisme connaît également un réel engouement chez les élites (Charles Richet, Alexis Carrel). De la Libération jusqu’à la fin des années 1960, le... -
CARREL ALEXIS (1873-1944)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 699 mots
Chirurgien, sociologue et biologiste, qui a reçu en 1912 le prix Nobel de physiologie et de chirurgie physiologique pour la mise au point d'une méthode de suture des vaisseaux sanguins et qui jeta les premières bases des études ultérieures sur la transplantation des vaisseaux sanguins et des organes....
-
DARWINISME
- Écrit par Dominique GUILLO et Thierry HOQUET
- 5 497 mots
...sociales « supérieures », afin que la composition biologique – et, donc, selon lui, la composition intellectuelle et morale – de la population s'améliore. Tels sont les principes de ce qu'il nomme l'eugénisme, courant qui connaît un vif succès dans une partie des élites occidentales aux xix... - Afficher les 15 références
Voir aussi
- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES
- DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE
- PAUVRETÉ
- DÉGÉNÉRESCENCE
- INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE (IMG)
- STÉRILISATION HUMAINE
- EMBRYON HUMAIN ET BIOÉTHIQUE
- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945
- INSÉMINATION ARTIFICIELLE
- AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE
- DIAGNOSTIC PRÉNATAL
- POLITIQUE SOCIALE
- NÉODARWINISME
- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA