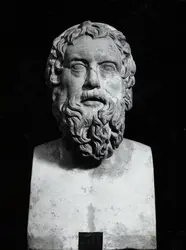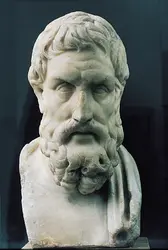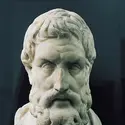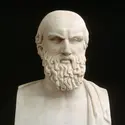EURIPIDE (env. 480-406 av. J.-C.)
Article modifié le
Euripide en son temps
Mais ce sont aussi des problèmes éternels, déjà vieux comme le monde. Il ne s'ensuit pas qu'Euripide se désintéresse des questions particulières à son temps. Gardons-nous de l'observer sans mesure avec nos yeux d'aujourd'hui. Le risque est de donner à ses mythes un sens philosophique étranger au réel et de recomposer de lui, avec des traits épars, artificiellement classés, une image trop abstraite pour être vraie.
Même si nous ignorons les actes de sa vie, nous connaissons son époque et il s'impose de le regarder dans cette époque, au milieu et vers la fin du ve siècle d' Athènes, avec les yeux de ses concitoyens athéniens. Périclès n'a pas eu de successeur de sa taille ; son siècle va s'achever dans l'écroulement de l'empire, moins sous les coups des cités grecques rivales, que victime des fautes et des faiblesses de cet empire. Maintenant l'homme de théâtre se transforme en homme d'action ; Euripide apparaît plus vivant que jamais, car il est athénien jusqu'au fond du cœur. Maintenant, contradictions résolues, on découvre en lui, sinon son unité, du moins sa continuité. Il pensait être poète, philosophe, homme de lettres, auteur tragique. Sa conscience de citoyen, le nombre de ses auditeurs, maîtres de la politique, l'obligent à élargir le champ de ses responsabilités, et à dire son mot sur les problèmes du jour. Il est venu à point nommé, dans la force de l'âge, en un monde actuel, bouleversé par la guerre.
Euripide a près de cinquante ans quand éclate ce conflit, mondial pour les Grecs, qui va durer vingt-sept ans, et dont les dieux lui épargneront de voir la fin. De ses pièces conservées, seule Alceste est d'avant-guerre. Les premières des suivantes ne portent pas la marque, ou à peine, de la guerre. Une foi se dessine pourtant dans les destinées d'une Athènes dont la démocratie est dirigée par la main ferme de Périclès. Athènes est encore grande par ses vertus de bienfaisance et d'humanité qui la distinguent des autres cités grecques et des pays barbares. Périclès disparu, Euripide met Thésée sur la scène pour faire de lui, peu à peu, le modèle des hommes d'État, presque un saint. Sans être belliciste par nature, il fait vibrer dans son public la corde patriotique et jette l'anathème sur Sparte et sur ses alliés. Vers l'époque de l'éphémère et trompeuse paix de Nicias (421), il fait jouer des pièces, comme Les Héraclides, Les Suppliantes, Érechthée, Ion, où passe le souffle d'un impérialisme guerrier. Légitime est la fierté d'appartenir à la première cité du monde, qui mérite son hégémonie.
L'année 415 marque un tournant. Lorsque le peuple athénien, oublieux des leçons de Périclès, écoutant Alcibiade et non Euripide, lance follement une armada contre la Sicile, l'Athéna des Troyennes renverse ses alliances et passe brutalement dans le camp troyen. Les éloges d'Athènes ne sont plus qu'une clause de style et la guerre de conquête est stigmatisée. La tragédie d'Hélène souligne amèrement, trois ans plus tard, cette catastrophe de Sicile, dont Athènes, prolongeant neuf ans une lutte désespérée, ne se relèvera pas. Plusieurs pièces de ce temps traduisent l'ébranlement, puis la perte de sa foi dans la démocratie, son mépris pour les démagogues, sa passion pour la paix, et le rêve utopique d'une union entre les Grecs, en des heures où les politiciens excitent le peuple à s'entêter dans une guerre fratricide à laquelle il n'est plus un seul homme dans Athènes – sauf Alcibiade peut-être, mais peut-on compter sur cet être changeant ? – pour apporter une issue victorieuse.
Euripide subit la déchéance de sa patrie et baisse la tête. Or voici qu'Archélaos de Macédoine – un tyran et un Barbare, ô ironie du sort ! mais un despote éclairé protecteur des arts et des lettres – l'invite à fuir l'atmosphère irrespirable d'une Athènes aux abois. Part-il en mission officielle ? C'est douteux. Il s'en va, à soixante-dix ans passés, pour retrouver, comme le Iolaos des Héraclides, la jeunesse miraculeuse d'Hippolyte. L'air pur des grandes forêts du Nord lui rend toutes les fraîcheurs de son inspiration.
Coup sur coup, Euripide métamorphosé écrit quatre pièces dont les deux conservées peuvent être appelées ses chefs-d'œuvre. Adieu guerre, vains débats, adieu intellectuels, hommes politiques ! Place à la pure poésie ! Il remet sur le chantier un sujet déjà marqué par Eschyle et compose avec feu un mystère grandiose sur les cultes orgiastiques et la religion de Dionysos, ce dieu qui vient de l'Orient. Il chante sa délivrance dans le drame sacré des Bacchantes. Il exprime le même soulagement, renforcé par l'éloignement de la foule, dans la plus racinienne de ses pièces, Iphigénie en Aulis, où le penseur s'efface devant le poète épris de toutes les formes de l'art. Il mettait la dernière main à cette tragédie dernière, dans le courant de l'année 406, quand la mort, seule capable de résoudre ses contradictions suprêmes, lui apporte, à soixante-quinze ans, un peu avant Sophocle, la seule paix durable. Mais il meurt trop tôt pour jouir de l'ultime succès que lui vaudra cette tragédie devant le peuple d'Athènes qui n'avait pas su l'écouter à temps.
Tel fut Euripide, aux yeux de ses concitoyens. On le dit moderne ; et c'est vrai. Mais l'est-il plus qu'Homère, que Thucydide ou que Platon ? Le plus ancien et aussi le plus fin des critiques apporte sur lui, bien qu'il soit d'un contemporain, donc privé des services rendus par le recul du temps, un jugement définitif. Juste après la mort d'Euripide, dans sa comédie des Grenouilles, Aristophane, l'inventeur et le maître du genre des « à la manière de », qu'il manie avec une aisance merveilleuse par son aptitude à discerner les traits marquants de l'auteur et de l'homme, le met en balance avec Eschyle. Comme il cherche le poète le plus capable de sauver par son œuvre la cité en péril, la balance penche finalement en faveur d'Eschyle ; l'école de volonté qu'est son théâtre forme mieux les citoyens en des temps critiques ; elle les rend plus vertueux, plus équilibrés, plus courageux, alors qu'Euripide risque d'enseigner le doute et, sans aller jusqu'à démoraliser ses auditeurs, leur montre moins de grandeur, sauf dans les femmes. Son enseignement peut être dangereux dans la mesure où il suscite des vocations de sophistes au lieu de donner par des exemples une pleine définition de l'homme.
Mais la sentence d'Aristophane dépasse le domaine de la morale et traverse les besoins de l'actualité. Derrière la moquerie qui masque le sérieux transparaît aussi l'admiration. Avec son goût très sûr, il réprouve d'une part les excès du pathétique, le penchant à la discussion qui frise le bavardage ; mais de l'autre il découvre en Euripide les qualités qui, dans son élan de libre recherche, le rendent moins abrupt qu'Eschyle, la simplicité, le goût du réel, l'art de toucher le cœur par les sentiments les plus vrais. Aussi, comme Racine qui l'a étudié, commenté vers par vers, lui rend-il un rare hommage, celui de savoir ses tragédies, même anciennes, par cœur. Par cette preuve de mémoire qui davantage encore est un signe de fascination, le maître de la comédie ancienne consacre pour toujours un des princes du théâtre éternel.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Édouard DELEBECQUE : professeur émérite à l'université de Provence
Classification
Médias
Autres références
-
IPHIGÉNIE À AULIS, Euripide - Fiche de lecture
- Écrit par Florence BRAUNSTEIN
- 941 mots
- 1 média
Des grands tragiques grecs, Euripide (480 env.-406 av. J.-C.) est sans doute celui qui a le plus nettement contribué au renouvellement du genre. Iphigénie à Aulis est sa dernière pièce, l'ultime tragédie qu'il composait lorsqu'il mourut en 406 avant J.-C. Comme Antigone, Iphigénie...
-
ARISTOPHANE (445-380 av. J.-C.)
- Écrit par Jean DEFRADAS
- 4 637 mots
- 1 média
L'attaque contreEuripide est menée à fond dans Les Thesmophories, où les femmes, comme dans Lysistrata, qui est de la même année, jouent le rôle principal. Au cours de la fête des déesses Thesmophores, qui est interdite aux hommes, les femmes, réunies à la Pnyx, décident de mettre à mort Euripide... -
DELPHES
- Écrit par Bernard HOLTZMANN et Giulia SISSA
- 9 621 mots
- 9 médias
...« que la clarté fumeuse des torches a vu franchir la roche à la double pointe où les Nymphes coryciennes viennent en dévotes filles de Bacchos. » Pour Euripide aussi, Dionysos conduit une oribasie en tant que dieu « du rocher pythien ». Ainsi, le chœur de Ion invoque « les roches escarpées du Parnasse... -
GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - La religion grecque
- Écrit par André-Jean FESTUGIÈRE et Pierre LÉVÊQUE
- 20 092 mots
- 8 médias
...dieux grecs renforcent considérablement l'emprise qu'ils exercent sur les consciences. Tel est le cas de Dionysos, au sujet de qui les Bacchantes d' Euripide constituent, à la fin du ve siècle, un témoignage exceptionnel : elles mettent en scène les Thébaines qui se livrent dans les halliers du Cithéron... -
GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - Langue et littérature
- Écrit par Joseph MOGENET et Jacqueline de ROMILLY
- 8 261 mots
- 2 médias
...raconte que, le jour de cette bataille à laquelle participait Eschyle, le jeune Sophocle conduisit le péan de la victoire ; ce jour-là aussi naquit Euripide. Cette légende, en réunissant les noms des trois grands poètes tragiques, non seulement résume toute l'histoire de la tragédie athénienne, mais... - Afficher les 8 références
Voir aussi