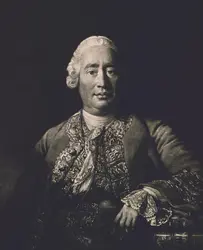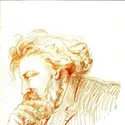EXPÉRIENCE
Article modifié le
Théorie et expérience
Le programme empiriste logique d'une réduction du langage de la science à des données observables rencontre des limites analogues. Alors que le positivisme classique (celui de Comte et de Mill) entendait réduire la science à l'énoncé de « lois des phénomènes », le positivisme viennois reformule le problème dans un cadre linguistique. Selon le célèbre « critère de signification » des Viennois, seuls sont doués de sens les énoncés qui tombent d'un côté ou de l'autre de la barrière analytique/synthétique, et seuls ont une signification « cognitive » les énoncés qui donnent lieu à des observations permettant de les confirmer ou de les infirmer, c'est-à-dire qui permettent de dériver, avec des règles d'inférences logiques et des règles auxiliaires, des énoncés d'observation.
D'une part, cela délimite la science et la métaphysique, comme le sens opposé au non-sens. D'autre part, le langage de la science (par exemple celui de la physique) se trouve scindé en deux langages distincts : le langage théorique, qui contient des termes désignant des entités inobservables tels que « atome » ou « électron », et le langage observationnel, contenant des termes publiquement observables, tels que « chaud » ou « rouge ». La corrélation entre les deux vocabulaires est établie, selon Carnap, par des « règles de correspondance », qui montrent comment les termes du vocabulaire théorique, qui ne sont que « partiellement » interprétés, reçoivent leur interprétation complète avec les termes du vocabulaire observationnel. Par exemple, « température » s'interprète, moyennant des règles sur la mesure, par des énoncés observationnels rapportant des constats sur un thermomètre.
Cette analyse est conforme à la conception hypothético-déductive classique des théories scientifiques : celles-ci sont des ensembles de lois, soumises au verdict de l'expérience par le biais des prédictions qu'on peut en déduire (moyennant des hypothèses auxiliaires ou des conditions initiales) et par là vérifiées ou infirmées. L'histoire du positivisme logique au xxe siècle s'identifie aux tentatives faites par les philosophes de cette tradition pour spécifier la « base empirique » adéquate et pour établir la corrélation recherchée entre termes théoriques et termes observationnels.
Le critère de signification empirique subit des reformulations constantes (Hempel, in Jacob, 1980). Carnap finit par admettre, dans les années 1950, que les termes théoriques étaient probablement inéliminables, en partie sous l'influence de Popper, qui soutient que le seul véritable critère de « démarcation » de la science et de la métaphysique est la réfutabilité des énoncés scientifiques, plutôt que leur confirmabilité. Selon la conception rationaliste de Popper (1936), les scientifiques formulent des théories audacieuses, qu'ils soumettent à des tests sévères. Le contact des hypothèses et de l'expérience est essentiellement négatif, et l'on doit renoncer à l'inductivisme qui sous-tend la conception positiviste : la relation entre théorie et expérience n'est pas celle d'une confirmation, mais celle d'une infirmation. À cela s'ajoute le fait que toute tentative pour fonder une « logique de la confirmation » des théories scientifiques échoue, si l'on entend réduire le raisonnement scientifique à une forme de raisonnement inductif (cf. Popper, in Jacob, 1980). Une autre critique du réductionnisme positiviste est venue de Quine (1960), qui soutient que la notion de signification – et par conséquent de signification empirique – est trop indéterminée pour pouvoir se prêter au rôle fondationnel que lui assignait Carnap. Il s'ensuit, selon Quine, que la distinction analytique/synthétique, entre des énoncés vrais indépendamment de l'expérience et des énoncés vrais en vertu de leur signification seule, n'est pas tenable, et qu'à la limite tout énoncé, y compris logique, est en principe susceptible de révision. Quine affirme un « holisme » radical : nos énoncés sur la nature ne rencontrent pas l'expérience un à un, mais en totalité, sans qu'aucun énoncé individuel puisse infirmer une théorie. Ce holisme s'inspire directement de la fameuse thèse que Duhem (1906) avait soutenue au sujet des théories physiques : il n'y a pas d'expérience « cruciale » en physique, c'est-à-dire d'expérience pouvant à elle seule confirmer ou infirmer une théorie.
À ces critiques philosophiques du programme empiriste en philosophie des sciences s'ajoutent celles des historiens des sciences. Au moment où, en France, dans les années 1950, le « rationalisme appliqué » de Bachelard (1949) s'opposait à des versions plus classiques du positivisme, pour affirmer la préséance de la théorie sur l'observation, des philosophes américains soutenaient la thèse selon laquelle toute observation scientifique est imprégnée de théorie, et suppose une interprétation des données que les empiristes essayaient d'isoler comme purement observationnelles. Par exemple, Hanson (cf. Jacob, 1980) soutient que Ticho Brahe (partisan du géocentrisme) et Kepler (partisan de l'héliocentrisme) ne voyaient pas la même chose en voyant le soleil se lever. Bien que leurs données visuelles fussent apparemment identiques, les jugements théoriques qui affectaient leur observation changeaient les contenus de leurs expériences. L' expérimentation scientifique même, dans la mesure où elle recourt à des instruments, est « chargée de théorie ». Il s'ensuit que la distinction positiviste entre termes théoriques et termes observationnels doit être abandonnée. Kuhn (1962) tire une conséquence extrême d'analyses de ce type : que chaque théorie scientifique porte avec elle des interprétations et des significations spécifiques des termes qu'elle avance, en sorte que ces termes n'ont aucune référence commune d'une théorie à une autre. Par exemple, « masse » ne peut pas signifier, ni par conséquent désigner, la même chose en physique newtonienne et en physique relativiste. Les théories elles-mêmes sont sous l'influence de « paradigmes », c'est-à-dire de formes globales d'interprétation de l'expérience qui sont essentiellement « incommensurables ».
Si ces réactions contre la philosophie empiriste des sciences sont fondées, sommes-nous néanmoins tenus d'admettre les conséquences qu'on en tire ? Tout d'abord, la notion d'une incommensurabilité des théories scientifiques contredit apparemment la pratique scientifique elle-même, s'il est vrai que la réfutation d'une théorie suppose que les savants soient en mesure de parler de la même chose, donc de donner une référence commune à leurs termes. Même si elles « construisent » et informent l'expérience, les théories scientifiques ne sont pas de pures fictions, créant une réalité plutôt que se confrontant à elle. De même, l'idée de « schèmes conceptuels » (ou d'« épistèmès », dans l'épistémologie structuraliste française des années 1960) qui organiseraient l'expérience conduit à une forme de relativisme douteuse : pour qu'on puisse établir la prétendue incommensurabilité entre les schèmes, il faut pouvoir les rapporter à des systèmes de coordonnées communes ; il faut pouvoir traduire les conceptions « étrangères » à un schème donné dans notre langage pour pouvoir éventuellement conclure à des différences locales, mais non globales. En ce sens, l'idée relativiste (si prégnante, par exemple, en anthropologie) d'une expérience, relative à un langage ou à une culture, radicalement différente de la nôtre est a priori douteuse (Davidson, 1969). Ensuite, comme on l'a vu plus haut, le fait que des jugements théoriques influencent la perception des données n'implique pas qu'il n'y ait pas dans les processus « modulaires » de traitement de l'information, des données indépendantes de ces jugements. Pourquoi alors l'idée empiriste de données observationnelles « pures » ne serait-elle pas partiellement justifiée, ou tout au moins compatible avec l'influence des inférences théoriques à un stade distinct de la théorisation scientifique (Fodor, 1984) ? On pourrait ainsi concilier le caractère autonome du donné avec le caractère inférentiel des croyances scientifiques.
Le postulat de base de l'empirisme est celui d'une homogénéité de principe entre la perception et la science, et cette philosophie est une tentative, très ambitieuse, pour réconcilier l'image « manifeste » (W. Sellars) du monde que nous donne l'expérience commune avec l'image sophistiquée que nous en donne la science. Cette philosophie échoue à concilier l'objectivité de cette dernière avec la subjectivité intrinsèque de la première, s'il y a bien, comme le montre l'histoire des sciences, une rupture entre science et perception. La démarche transcendantale partage pourtant le même postulat : les formes a priori de l'expérience possible doivent concorder avec les données de l'expérience réelle, telle que la science les fournit. La conclusion qui semble s'imposer est que tout projet de fonder la connaissance sur ce postulat paraît voué à l'échec. Il ne s'ensuit pas que tout projet fondationnel soit caduc (cf. Granger, 1984), ni que la vérité des théories scientifiques puisse être établie indépendamment de tout recours à quelque chose que l'on doit bien appeler des « faits » ou une « expérience ». Et il ne s'ensuit pas que l'image « scientifique » du monde soit seule réelle, si la vision subjective que nous en donne l'expérience est irréductible.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pascal ENGEL : maître de conférences de philosophie, université de Grenoble-II et C.N.R.S
Classification
Média
Autres références
-
EXPÉRIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 783 mots
Une dualité de sens rend complexe l’approche philosophique de la notion d’expérience, puisque ce terme renvoie aussi bien à l’expérience existentielle qu’à l’expérimentation scientifique. L’expérience existentielle se dédouble elle-même dans l’expérience sensible, dans le sens où...
-
CONSCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 719 mots
...thermomètre indiquant que la température est fort agréable. Mais si je dis simplement « j’ai froid », qui pourrait contester que je ressens dans mon corps une impression de froid sans doute tout à fait « subjective », mais qui exprime cependant l’expérience indiscutable que je suis en train de vivre ? -
AVENARIUS RICHARD (1843-1896)
- Écrit par Pierre KAUFMANN
- 852 mots
Philosophe allemand, né à Paris, Richard Avenarius enseigna à Zurich de 1877 à sa mort, et prit part à la création du Cercle académico-philosophique de Leipzig. Bien qu'il se soit inscrit dans l'histoire des idées comme l'un des fondateurs en 1877 du Vierteljahrschrift für...
-
BACHELARD GASTON (1884-1962)
- Écrit par Jean-Jacques WUNENBURGER
- 3 479 mots
- 1 média
...construction expérimentale du phénomène que l'on cherche à expliquer. De plus en plus, Bachelard soutient que cette dialectique externe entre théorie et expérience, ne dispense pas d’une dialectique interne entre les concepts eux-mêmes jusqu’à parfois solliciter la puissance de la contradiction, par recours... -
BACON chancelier FRANCIS (1560 ou 1561-1626)
- Écrit par Michèle LE DŒUFF
- 2 171 mots
- 1 média
Né à Londres dans une famille qui a déjà fourni à la Couronne anglaise quelques grands serviteurs mais qui n'appartient pas à la noblesse terrienne, Bacon fut élève de Trinity College (Cambridge) et étudia le droit à Gray's Inn (Londres). Il séjourna en France de 1576 à 1578 (ou 1579) auprès de l'ambassadeur...
- Afficher les 59 références
Voir aussi
- OBSERVATION
- CLASSES, logique
- THÉORIE
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- OBJECTIVITÉ
- EXPÉRIMENTATION
- SIGNIFICATION
- HYPOTHÈSE, épistémologie
- DÉDUCTION
- EMPIRISME LOGIQUE
- SUBJECTIVITÉ
- MENTALES FONCTIONS
- MESSAGE SENSORIEL
- PARTICULIERS, logique
- VÉRITÉ, logique
- CRITIQUE, philosophie
- SENSATION, philosophie
- QUALITÉS SENSIBLES
- A PRIORI CONNAISSANCE
- SCHÈME, philosophie et psychologie
- CONFIRMATION, épistémologie
- TRANSCENDANTAL, philosophie
- HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIF, logique