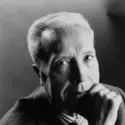FANTASTIQUE
Article modifié le
Le fantastique dans l'art
L'exclusion du réel
Le domaine de l'art fantastique, de prime abord, semble indéfiniment extensible. Dans les ouvrages qui lui sont consacrés, figurent aussi bien des chapiteaux romans et gothiques, des monnaies grecques et gauloises, des sculptures primitives, archaïques ou naïves, des symboles astrologiques ou alchimiques.
Parfois, la part de l'ethnographie est prépondérante (avec des objets, des motifs, des masques provenant de la Nouvelle-Guinée, du Mexique, du Bénin, du Kafiristan, de l'Afrique occidentale, etc.). D'autres fois, des tapisseries médiévales voisinent avec des miniatures orientales, avec des images d'Épinal, des cartes postales, des peintures d'aliénés et des illustrations d'œuvres littéraires.
Dans ces conditions, il devient évident que le sens du terme « fantastique » est purement négatif : il désigne tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'éloigne de la reproduction photographique du réel, c'est-à-dire toute fantaisie, toute stylisation et, il va de soi, l' imaginaire dans son ensemble. Pour la littérature, l'application du même principe, qui consiste à se garder de partir d'une définition préalable, conduirait à rassembler dans une anthologie fantastique, pêle-mêle, l'Apocalypse de saint Jean et les Fables de La Fontaine (puisque les animaux y parlent), un conte d'Edgar Poe et Gargantua, un procès-verbal de l'Institut métapsychique, un récit de science-fiction, un extrait de l'Histoire naturelle de Pline, en un mot tout texte qui s'écarte de la réalité, volontairement ou non, à quelque titre que ce soit.
La démarche est parfaitement défendable, mais l'ampleur de son libéralisme risque d'appauvrir à l'extrême une notion qui se révèle couvrir un monde immense, hétéroclite. Aucun autre moyen de renseigner sur elle ne subsiste que de préciser ce qu'elle excepte et qui est peu, à savoir la représentation fidèle et adroite des choses et des êtres familiers, car la gaucherie est souvent à son tour estimée source de fantastique.
Il est cependant d'usage de réduire l'art fantastique aux arts plastiques, en particulier à la peinture, et plus particulièrement encore aux œuvres des artistes qui manifestent une volonté délibérée de représenter un monde irréel. Ce répertoire du fantastique pictural essentiel comprend généralement des Italiens : surtout Bracelli et Bellini ; des Allemands ou apparentés : Dürer, Grünewald, Schongauer, Baldung Grien, Cranach, Urs Graf, Altdorfer, Nicolas Manuel Deutsch ; des Flamands : Bosch et Bruegel ; des isolés : Monsu Desiderio, Arcimboldo, Goya, Blake ; quelques peintres de l'époque symboliste : Gustave Moreau et Odilon Redon ; enfin, après le douanier Rousseau et Marc Chagall, l'épanouissement surréaliste ou surréalisant avec Dali, Max Ernst, Chirico, Léonor Fini, Delvaux, Magritte, de nombreux autres. Avec Callot, Antoine Caron et Piranèse, d'une part ; avec Munch, Füssli et Fuchs, de l'autre, voici accompli le tour des œuvres qui semblent s'imposer, quels que soient les goûts et les critères personnels des enquêteurs. Il faut bien avouer que ce catalogue, quoique étrangement étroit, demeure fort disparate et qu'il réunit, lui aussi, des œuvres éminemment hétérogènes, que rassemble seulement ce qu'elles excluent : le réalisme.
Le fantastique déclaré : jeu et système
Ainsi, les tableaux d'Arcimboldo (xvie siècle) frappent par leur apparence délirante. Il est sans doute d'une aimable fantaisie d'assembler savamment des fleurs, des fruits et des poissons, de façon à faire surgir à la fin des visages ou des personnages composés uniquement d'éléments appartenant à une même série. Mais qui n'aperçoit qu'il ne s'agit là que d'un jeu, que d'une gageure ? Plus tard, on s'est diverti à représenter Napoléon III et bien d'autres célébrités du jour en entrelaçant une multitude de corps de femmes nues. Le ressort est le même. Plutôt qu'un fantastique indubitable, il n'y a là qu'un procédé amusant, systématiquement employé, et qui, les règles une fois données, ne dépend plus que de l'habileté de l'artiste. Ranger de telles œuvres dans l'art fantastique, alors que leur nature de pure prouesse à la fois conventionnelle et mécanique saute aux yeux, paraît aberrant ou étrangement léger.
L'art d'Arcimboldo est parfois présenté comme surgissant par miracle, création absolue ou issue de douteuses influences extrême-orientales. La vérité est plus simple : durant tout le xve siècle, de nombreux enlumineurs se sont ingéniés à composer des initiales faites de plantes, d'animaux ou d'hommes tordus et contorsionnés de façon à prendre la forme de lettres lisibles, mais dont chaque élément demeure bête, monstrueuse ou non, racine ou vrille, jongleur ou acrobate, sinon squelette désarticulé, chacun dessiné aussi fidèlement que possible et avec un grand luxe de détails. À l'origine, le procédé est clairement ornemental. Arcimboldo l'adopte, s'affranchit sans doute de l'alphabet, mais utilise le même détour pour faire surgir visages ou paysages de combinaisons industrieuses de formes à la fois indépendantes et appartenant à un même groupe naturel. Il s'agit d'inviter l'œil à décomposer et à reconstruire tour à tour l'image totale. Le stratagème est plaisant, mais il faut de la bonne volonté pour l'estimer mystérieux. Les paysages anthropomorphes de Joos de Momper, de Kircher, ceux qu'on pouvait acheter à Paris chez L. Dubois vers 1810-1820, ceux surtout du Maître des Pays-Bas méridionaux au xvie siècle relèvent d'une plus subtile recherche. Mais, jeu pour jeu, gageure pour gageure, les fantoches cubiques de Dürer (1525), de Ehard Schön (1543), de Luca Cambiaso (1527-1585), les robots des Bizzarie de Bracelli (1624), sans compter, au premier rang peut-être, les menuiseries fabuleuses de la Geometria et perspectiva de Lorenz Stoer procurent une plus dépaysante impression.
Une fois lancé sur cette piste, est-il possible de s'arrêter si vite ? Jérôme Bosch, que beaucoup tiennent pour le peintre fantastique par excellence, ne procure pas à tout le monde l'impression d'étrangeté irréductible, qu'il est après tout raisonnable de proposer, jusqu'à plus ample informé, comme pierre de touche du fantastique. Pourtant chaque détail y fait preuve d'une invention prodigieuse : les règnes s'y croisent, les plus lointaines alliances y sont courantes, et un homme perforé par les cordes d'une harpe est un des moindres spectacles que représentent de redondantes accumulations de merveilles. Mais, justement, ces merveilles accumulées finissent par constituer une cohérence ; elles dérivent d'un parti pris qui fait de la féerie une manière de norme ; elles sont là par obligation, pour illustrer la loi d'un univers tout entier insolite. Il est ainsi des gravures naïves qui représentent, par exemple, le monde à l'envers, les bœufs dirigeant la charrue où les hommes sont attelés, les poissons tirant les pêcheurs hors de la rivière, et le tout à l'avenant. Le fantastique n'est fantastique que s'il apparaît scandale inadmissible pour l'expérience ou pour la raison. Si quelque décision irréfléchie ou, circonstance aggravante, méditée, en fait le principe d'un nouvel ordre des choses, il est ruiné du même coup. Il ne saurait plus provoquer d'angoisse ni de surprise. Il devient l'application conséquente, méthodique, d'une volonté délibérée qui n'entend rien laisser hors du nouveau système.
En fait, le monde de Bosch est précisément systématique. Il a d'abord émergé dans les chapiteaux, les linteaux, les tympans des églises romanes. Il prolifère dans les marges des manuscrits, tout autour du texte qu'il enserre de sinuosités capricieuses. Il annexe les visions de l'Apocalypse, les supplices de l'Enfer, des hallucinations des anachorètes tentés dans le désert. Il déborde des flores, des bestiaires, des recueils de proverbes, de sentences drolatiques, de prodiges et d'oracles. Il est nourri d'une géographie fabuleuse et d'une histoire prétendue naturelle où fourmillent atlantes et sciapodes, basilics et griffons. S'évadant des encadrements et des clefs de voûte, grotesques et grylles, têtes à jambes et autres truculences s'étalent désormais au cœur de l'œuvre d'art. En même temps, le document est confondu avec le présage, le didactique avec l'allégorique.
Qui plus est, une tératologie généralisée épuise les permutations d'organes et d'ustensiles. Elle essaie les plus effarantes combinaisons à l'intérieur d'un règne, entre les règnes, sinon entre l'inerte, le vivant et le fabriqué. La croupe, la grotte et la cabane deviennent interchangeables, comme la pelle et la nageoire, la main, la griffe et la cuillère, la plume et l'écaille, la carapace et l'armure, la pelle, la béquille et la roue, l'entonnoir, la bouche et l'anus, les ailes (de papillon ou de moulin), les antennes, les palpes, les ouïes, les ventouses. Des sphères transparentes descendent les mages au fond des mers, tandis que des voilures de chauve-souris, de démon ou de vaisseau élèvent les poissons en plein ciel. Chaque substitution est risquée à tour de rôle par mille greffes successives, un peu comme dans les jeux enfantins où chaque partie d'un pantin démontable est remplacée par des parties mobiles appartenant à d'autres personnages ou à d'autres organismes.
Ici, toutefois, le clavier des métamorphoses s'étend à l'ensemble de l'univers créé et à toute invention de l'industrie humaine. C'est par là qu'il peut être dit fantastique. L'obscène s'y conjugue avec le burlesque, la parodie avec la cruauté. L'innocent monde à rebours de La Nef ou du Miroir des fous est perverti en anti-monde diabolique et sacrilège, où tout devient à la fois tentation et damnation, convoitise et châtiment. On recherche l'impossible en soi et l'interdit par excellence. La déraison épidémique se répand « comme une dépravation », estime Jurgis Baltrusaïtis qui a passé au tamis ces alluvions infernales et reconstitué la géographie de ces échanges. Il y reconnaît une véritable « physiologie du disparate et du difforme ». C'est peu dire : insectes et reptiles, marmites et rôtissoires, jongleurs et ribaudes, grenouilles et stropiats réussissent les hybridations les plus déconcertantes et d'inconcevables bâtardises.
À la fin, cet univers apparaît si bien inversé, disloqué, brouillé comme un puzzle après brassage des pièces, que l'insolite n'y a plus de place, parce qu'il est partout. Or il n'est rien, il n'apparaît pas, s'il ne transgresse et ne déchire soudain une régularité bien établie et qui semblait imperturbable.
À cause de cet empire sans partage du chaotique et de l'aberrant, les tableaux de Jérôme Bosch n'apportent pas à un degré proportionné à l'éventail et à l'énormité des moyens mis en œuvre le sursaut d'irréductible étrangeté que d'autres provoquent plus intense, plus tenace, à de bien moindres frais.
Le fantastique d'institution
Pour des raisons analogues, les raffinements de l'enfer tibétain, les divinités inextricables du panthéon hindou, les chimères, les sphinx et les centaures de la mythologie classique, les miracles de l'hagiographie chrétienne, ni, pour le mode mineur, les illustrations, par exemple, des Contes de Perrault ne peuvent passer pour les types d'un fantastique affranchi de la volonté de surprendre ou d'effrayer et qui, pour ainsi dire, étonne ou inquiète malgré lui. En effet, le fantastique le plus digne de ce nom est aussi le moins aisément réductible à une bizarrerie locale, à une donnée inconnue ou à une décision délibérée. Le fantastique de parti pris, c'est-à-dire les œuvres d'art créées expressément pour dérouter le spectateur par l'invention d'un univers imaginaire, féerique, où rien ne se présente ni ne se passe comme dans le monde quotidien, le fantastique volontaire et forcé, qui naît de la simple décision de peindre à tout prix des œuvres propres à déconcerter, celui qui est le résultat d'un jeu, d'un pari, d'une esthétique ou d'une école, ne peuvent rivaliser à la longue avec celui qui surgit malgré l'obstacle de la réalité, sans doute avec la complicité et par l'entremise de l'artiste, mais presque en lui forçant l'inspiration et la main ; dans certains cas extrêmes, à son insu.
Il convient également de récuser le fantastique d'institution, c'est-à-dire le merveilleux des contes, des légendes et de la mythologie, l'imagerie pieuse des religions et des idolâtries, les délires de la démence et jusqu'à la fantaisie désinvolte. Sans doute est-ce renoncer également aux hallucinations d'anachorètes, aux danses macabres du Moyen Âge, aux triomphes de la mort, aux supplices des Enfers ou de l'Enfer, aux squelettes anticipés qu'aperçoivent dans leur miroir de jeunes femmes inquiètes de leur brève beauté, aux sabbats présidés par le Bouc et aux sorcières chevauchant le balai, en un mot à toute monnaie courante de la crédulité ou même de la foi.
De même, ne fait pas bonne mesure l'étrangeté qui dérive des mœurs en usage et des croyances reçues sous quelque latitude lointaine ou proche, à quelque époque révolue ou présente. En effet, ces illustrations, replacées dans leur contexte, font partie du lot des images généralement acceptées : elles n'y apparaissent nullement fantastiques. Cette sévérité s'explique par le fait que fantastique signifie d'abord inquiétude et rupture. S'il existe un fantastique permanent et universel, il est issu, plutôt que du sujet, de la manière de le traiter.
Le fantastique insinué
Les récits des mythologies et les mystères des religions ne sont pas en eux-mêmes sources suffisantes de l'intrusion fantastique, et cela précisément parce que le merveilleux y est installé de droit divin et que tout y est par principe prodige ou miracle. Il semble pourtant injuste et, en fait, inexact de ne pas admettre qu'un élément étranger ou rebelle peut venir s'y greffer et réussir en quelque sorte à les dénaturer, à les rédimer de leur caractère surnaturel. Alors s'ouvrent la fissure, le décalage, la contradiction, par lesquels s'infiltre d'ordinaire le fantastique. Quelque chose d'insolite, d'inadmissible, de contraire à leur nature se trouve paradoxalement introduit dans ces univers trop libres, sans lois ni régularité.
Certaines illustrations des Métamorphoses d'Ovide, plusieurs œuvres d'inspiration religieuse, de Niccolo Dell Abbate et de Jacques Bellange notamment, où le sujet se trouve comme contredit par la manière de le traiter, les sorcières de Baldung Grien, qui sont simples femmes nues, quoique tordues par d'étranges soubresauts, démunies au demeurant des accessoires rituels, sauf de la cassolette maléfique, et qui forment un groupe où le souffle de la magie naissante n'est plus trahi que par l'invisible tempête qui couche les chevelures, ces divers exemples manifestent également l'élément résiduel qui subsiste, après analyse, dans les mythes, les superstitions, les orthodoxies. Cet élément qui à la fois les dépasse et les soutient continue, en effet, après leur disparition, de projeter son ombre sur l'imagination humaine.
Deux compositions significatives peuvent servir à illustrer pareille conception. Les tentations de saint Antoine sont d'ordinaire l'occasion de multiples diableries : monstres épouvantables, toutes griffes dehors, hérissés et squameux, crachant le feu, à la fois dragons et basilics. Or, plutôt que ces cauchemars redondants, Jan Gossaert (1478 env.-1536 env.) a représenté une tentation calme, solennelle, presque abstraite (musée de Kansas City). Au premier abord, il n'y a d'insolite que l'architecture. Deux colonnes somptueuses encadrent une énorme porte ronde pratiquée dans la muraille d'on ne sait quel édifice, œil-de-bœuf démesuré qui donne sur une cour, plus loin sur un verger, à l'horizon sur des rochers tourmentés et plantés d'arbres, qui forment une grande arche de pierre. Cette voûte naturelle est située dans l'exact prolongement de la porte humaine. Les deux ouvertures se répondent et semblent indiquer une mystérieuse direction. Sous le portique, d'un côté, le saint est assis ; de l'autre, à demi agenouillée, une reine lui présente un vase précieux qu'on devine enfermer quelque merveille ou talisman. Quelle raison de refuser semblable offrande, si ne dépassait de la robe de la visiteuse la patte d'oiseau, la serre de rapace à laquelle on reconnaît les démons ?
Le même recours à un fantastique insidieux de préférence à un fantastique déclaré apparaît dans une arche de Noé qui illustre un des nombreux ouvrages du P. Athanase Kircher (1602-1680), grand maître méconnu en cet empire de l'insolite. Devant le hangar flottant, parmi des croupes, des membres d'hommes et de chevaux, agonisent des poissons monstrueux, bicéphales ou aux yeux circonscrits de pétales de crucifères, submergés eux-mêmes par l'irrésistible inondation et comme suffoqués par l'abondance de leur propre élément. L'horrible est qu'ils semblent épargnés par la pluie, dont le rideau tombant d'effrayantes nuées d'orage s'arrête mystérieusement devant la troupe apeurée de ces épaves. On ne songeait pas auparavant que le déluge avait dû détruire jusqu'aux êtres aquatiques.
Classification
Cette distinction étant posée entre un fantastique de parti pris expressément voulu par l'artiste et un fantastique qui sourd de l'œuvre spontanément et sans recherche délibérée, il est possible, d'un autre point de vue, pour une exploration plus systématique de cette région de l'art, d'envisager quatre rubriques principales, où la part de fantastique est de plus en plus manifeste, sinon agressive, jusqu'au point où le fantastique, ne ressortant sur aucun fond, semble se renier lui-même.
Le message est clair pour l'émetteur (l'artiste) et pour le destinataire (le spectateur)
C'est le cas général. C'est le cas des œuvres non fantastiques, tableaux d'histoire, tableaux de genre, portraits, paysages ou natures mortes. Cependant, il arrive que l'impression du fantastique se dégage d'une œuvre où rien ne paraît d'abord capable de la provoquer, et sans que le spectateur, de son côté, puisse reconnaître ce qui cause son malaise ou son désarroi. La scène la plus banale, la plus terre à terre, suscite alors une inexplicable interrogation. Ce genre de fantastique, qui est le plus rare et le plus discret, est aussi celui dont le charme s'avère le plus résistant. Il ne dépend pas de l'anecdote, qui souvent le contredit. C'est le style du peintre qui le fait naître.
Le message est clair pour l'émetteur, mais obscur pour le récepteur
Il faut ici subdiviser, car Le Sacre de Napoléon ou La Cène doivent être totalement déconcertants pour un Papou, un Fuégien ou un Hottentot. Il suffit que le tableau illustre une donnée familière au peintre, mais étrangère aux connaissances de l'observateur. C'est un peu ce qui se produit pour Les Énervés de Jumièges de E. V. Luminais (1821-1896, musée de Rouen), avant que le spectateur ne s'informe. C'est aussi ce qui explique la présence de fétiches et d'idoles des antipodes dans certains ouvrages européens consacrés au fantastique par des auteurs qui n'y mettraient pas des Annonciations, des Résurrections ou des Jugements derniers.
Il peut se faire aussi que le message, destiné à des initiés ou accompagné d'explications, paraisse « fantastique » à qui ne dispose pas des données suffisantes pour l'interpréter correctement. Tel est, par exemple, le cas des Ars memorandi où l'on articulait en un seul dessin les différents éléments destinés à rappeler le texte d'un ou plusieurs chapitres d'un livre pieux ou savant. Les recueils d'emblèmes, à la mode du xvie siècle, quoique répondant à un propos différent, entrent dans la même catégorie : des dessins ingénieux illustrent des devises, des sentences ou des quatrains sans lesquels ils demeureraient à jamais inintelligibles.
Enfin, l'obscurité peut être calculée à dessein pour décourager la curiosité indigne et lui dérober le sens du message. Les gravures alchimiques offrent un excellent exemple de pareille démarche. Les opérations successives du Grand Œuvre sont représentées par autant de savantes allégories, parfois d'un exceptionnel intérêt artistique, et qui sont destinées à la fois à communiquer et à dissimuler un savoir, à guider et à égarer. Contrairement aux emblèmes moraux où la légende correspondante est claire, cette fois le texte n'est guère plus éloquent que l'image, et l'on se demande lequel est destiné à dévoiler le secret de l'autre.
Le message est obscur pour l'auteur, mais susceptible d'être déchiffré par un spectateur averti
Cette éventualité est restreinte : elle ne concerne guère que les œuvres créées dans un état d'hypnose, de demi-inconscience, sous l'effet d'une impulsion irrésistible ou d'un délire graphique, ou pour reproduire quelque vision ou image hallucinatoire. Ainsi de la persévérance de l'œil ou de l'araignée dans l'œuvre d'Odilon Redon, des ruines et des explosions dans celle de Monsu Desiderio. Un psychologue peut y déchiffrer une signification qui échappe au peintre ou au dessinateur. Les médecins le font communément avec les tableaux des malades mentaux qu'ils soignent.
L'observateur un peu attentif voit fréquemment une manière de mythologie affleurer dans l'œuvre des peintres. Sur leurs toiles reviennent maints éléments comme obsessionnels. Il arrive même à ceux-ci de se composer en un début de langage. D'autres fois, ils ne sont que détails à peine visibles dont la répétition est sans doute passée inaperçue à l'auteur même, distrait ou impatient. En tout cas, que celui-ci s'accommode de ces présences récurrentes ou qu'il les exploite, qu'il les néglige ou qu'elles lui échappent, il est d'autant plus loin de connaître leur signification exacte qu'il ne les a pas cherchées, qu'elles le hantent à son insu. Dès lors, une analyse perspicace et informée peut, sur ce point, en apprendre au peintre et prétendre fournir l'explication véritable de l'énigme de ses tableaux.
Le message est obscur à la fois pour l'émetteur et pour le destinataire
Un peintre souhaite exprimer ou représenter une atmosphère, un rapport, une scène qu'il imagine et qui l'émeut sans qu'il sache bien pourquoi, qu'il pressent significative sans en deviner parfaitement la portée. Il s'efforce alors délibérément de communiquer son impression, en espérant que le spectateur éprouvera la même révélation confuse, un ravissement analogue, non moins mystérieux et non moins envoûtant. L'inexplicable est alors accepté, subi peut-être avec un secret plaisir, mais qui reste associé au besoin d'une explication, sinon stimulé par cette attente, même si à ce besoin de clarté s'ajoute le soupçon inavoué que la clarté désirée pourrait être fatale à l'enchantement.
Il se peut que pareille crainte, d'abord honteuse, devienne si obsédante que le peintre conscient de cet état d'esprit en arrive à souhaiter prémunir son œuvre contre le danger d'éclaircissement qui en menace le charme. À partir de ce moment, il recherche décidément et laborieusement l'inintelligible. Il n'a de cesse de procurer des images qui soient à l'abri de toute exégèse. Il ne s'agit même plus pour lui de poser une question dont la réponse soit la plus difficile possible, mais d'inventer une question à laquelle il soit assuré que nulle réponse ne peut convenir. L'artiste essaie de créer une image qui, en aucun cas, ne puisse admettre un début d'explication. Tel est le but véritable que s'assigne la peinture surréaliste, même si l'artiste ne s'en rend pas compte nettement. Mais, objectivement, c'est ce résultat précis qu'il cherche à obtenir, si bien que le moindre semblant de cohérence qui subsiste dans ses toiles lui apparaît comme une négligence ou comme une faiblesse. On peut nommer « infinies » ces sortes d'images qu'on qualifierait aussi bien de « nulles » ; car, au sens fort du mot, elles ne veulent rien dire, ou plutôt veulent ne rien dire, dans le temps même où elles laissent tout entendre.
Ce sont des pièges à rêveries, des machines à dérouter, adaptées à leur fin aussi parfaitement qu'il est possible. Elles présentent toutefois une faiblesse, qui est d'avoir été expressément conçues dans cette intention, et qu'on le sait. À l'inverse des allégories où se trouve enfoui quelque secret à découvrir ou qui, du moins, invitent à une quête peut-être vaine, ces images ne guident ni ne nourrissent la rêverie. Elles la déconcertent et la découragent. Elles proclament d'avance que la recherche est inutile.
Peut-être une telle facilité, un tel excès permettent-ils d'entrevoir la loi fondamentale du genre : il faut au fantastique quelque chose d'involontaire, de subi, une interrogation inquiète non moins qu'inquiétante, surgie à l'improviste d'on ne sait quelles ténèbres, que son propre auteur fut obligé de prendre comme elle est venue et à laquelle il désirait lui-même, parfois éperdument, pouvoir donner réponse.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Roger CAILLOIS : homme de lettres
- Éric DUFOUR : professeur des Universités, université Paris-Diderot
- Jean-Claude ROMER : journaliste, conseiller en recherches cinématographiques, historien du cinéma fantastique
Classification
Médias
Autres références
-
CRITIQUE LITTÉRAIRE
- Écrit par Marc CERISUELO et Antoine COMPAGNON
- 12 922 mots
- 4 médias
...vision à travers un instrument déterminé) utilisés par le texte conçu comme « machine à faire voir ». Si l'étude prenait pour objet principal la littérature fantastique, et notamment les nouvelles d'E. T. A. Hoffmann (la lorgnette de Nathanaël dans L'Homme au sable, le miroir de Théodore dans... -
JEUX DE RÔLE
- Écrit par Emilie BLOSSEVILLE et Cécile DELANGHE
- 2 425 mots
- 1 média
L'existence des jeux de rôle est indissociable du nom d'un Américain, Gary Gygax, nourri de jeux et d'histoires fantastiques, qui s'inspire de l'univers du Seigneur des anneaux, ouvrage de Tolkien, pour lancer en 1973 le premier et le plus célèbre jeu de rôle : Donjons... -
JEUX EN LIGNE
- Écrit par Erwan CARIO
- 2 562 mots
...l'écran, la première étape du nouveau joueur en ligne est de créer son avatar, c'est-à-dire son alter ego numérique. Dans le cas de Wow, qui se passe dans un environnement médiéval-fantastique – un dérivé de l'univers du Seigneur des anneaux de Tolkien –, il peut s'agir d'un humain ou d'une créature... -
MILNER MAX (1923-2008)
- Écrit par Encyclopædia Universalis
- 400 mots
Historien de la littérature français. Président de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, professeur émérite de littérature à l'université de Paris-III-Sorbonne, Max Milner fut, à l'image de Mario Praz ou de Jurgis Baltrušaitis, un de ces « grands transversaux...
Voir aussi
- AMÉRICAIN CINÉMA
- MAGNÉTOSCOPE
- DRACULA
- RIPPERT OTTO (1869-1940)
- FISHER TERENCE (1904-1980)
- FREDA RICCARDO (1909-1999)
- EXTRATERRESTRES VIE ET INTELLIGENCE
- FANTASTIQUE LITTÉRATURE
- JAPONAIS CINÉMA
- INSOLITE
- CONDYLURA
- FULGORE
- SURRÉALISME & ART
- MÖBIUS BANDE DE
- CINÉMA FESTIVAL DE
- ROMAN NOIR ou ROMAN GOTHIQUE
- FANTASTIQUE ART
- FANTASTIQUE CINÉMA
- WHALE JAMES (1896-1957)
- ANGLAIS CINÉMA
- FRANÇAIS CINÉMA
- ITALIEN CINÉMA
- EXPRESSIONNISME, cinéma
- CASSETTE VIDÉO ou VIDÉOCASSETTE
- EFFETS SPÉCIAUX, cinéma
- HORREUR CINÉMA D'