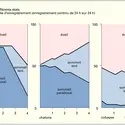FATIGUE
Article modifié le
Principales formes et causes
La fatigue musculaire survient après un travail musculaire, général ou local, de niveau et durée suffisants : l'épuisement est d'autant plus précoce que la puissance développée est grande. Au cours du travail local, la fatigue est liée à l'épuisement des réserves d'énergie intramusculaires, aux modifications biochimiques (acidité) survenant à l'intérieur des fibres musculaires, et à l'insuffisance de la circulation dans le muscle, laquelle apporte à celui-ci le glucose, les lipides et l'oxygène dont il a besoin ; ce dernier facteur prédomine dans le travail statique, qui comporte une diminution partielle ou totale de l'irrigation sanguine. Ce même mécanisme peut jouer chez le malade atteint d'artérite des membres inférieurs, qui présente une limitation de la durée de marche connue sous le nom de claudication intermittente. Au cours du travail général, une insuffisance des mécanismes de transport de l'oxygène s'ajoute aux facteurs locaux : la capacité d'adaptation des fonctions respiratoire et cardio-vasculaire possède ses propres limites.
On doit distinguer de la fatigue musculaire normale, survenant chez le sportif ou le travailleur de force, la courbature (phénomène douloureux consécutif à une activité musculaire inhabituelle par son niveau élevé et sa durée excessive) et la crampe (accidentelle ou professionnelle) due à la répétition d'un même geste ou au maintien d'une même posture, la force utilisée étant intense. Chez les sportifs, la méforme peut être considérée comme un état de fatigue lié à un surentraînement, se traduisant par une baisse des performances.
La fatigue nerveuse fait suite à une tâche mentale ou psychosensorielle. L'activité nerveuse consiste en un traitement d'information à un régime défini par la nature et la fréquence des signaux reçus, la complexité des choix et la nature des décisions à prendre. La fatigue se manifeste par l'impossibilité de suivre le régime initial, l'augmentation des erreurs ou des omissions. Elle peut être objectivée par des tests de coordination psychomotrice, de barrage, de choix binaire, de dégradation de l'écriture (J. W. Kalsbeck) ou par l'étude de l'activité électrique cérébrale (F. Lille). Elle correspond soit à une baisse de la vigilance lorsqu'une attention trop soutenue est demandée (fatigue de l'écolier), soit à une augmentation du seuil de sensibilité des organes sensoriels.
La fatigue auditive est mise en évidence sur un audiogramme établi chez le sujet qui vient d'être exposé au bruit. La baisse d'acuité auditive régresse progressivement ; ce caractère transitoire distingue la fatigue auditive de la surdité, baisse d'acuité définitive, liée à un processus pathologique ou à une exposition, notamment professionnelle, au bruit.
La fatigue écologique est celle de la vie en société, qui impose des rythmes artificiels (horaires de travail, prise des repas en commun et à heure fixe, déplacements, repos hebdomadaire...) et des contraintes psychologiques (milieu familial et de travail, logement...) qui interfèrent avec des rythmes biologiques naturels (nyctémère, saison, digestion, veille-sommeil...). Ces conditions de vie sociale rendent les individus plus sensibles à la fatigue musculaire ou nerveuse.
La fatigue pathologique accompagne de nombreuses affections ; il s'agit d'une fatigabilité musculaire ou nerveuse anormale ; elle apparaît pour des activités réalisées à très bas régime. L'insuffisance surrénale lente (ou maladie d' Addison) comporte un épuisement rapide, malgré une conservation assez bonne de la force musculaire : il s'agit d'un trouble des métabolismes glucidiques et hydrominéral. La myasthénie (ou maladie d'Erb-Goldflam) comporte une baisse de la force de contraction des muscles de la face (chute des paupières, perte de la mimique) et des membres (anomalie du maintien des attitudes posturales) : la cause en est un trouble de la transmission neuromusculaire. La survenue de la fatigue n'est pas nécessairement liée à une activité antérieure du muscle. Des perturbations biochimiques générales sont à l'origine de certaines fatigues : c'est le cas des maladies dites « asthéniantes » tels la grippe ou l'ictère infectieux.
La fatigue subjective est une sensation perçue par des sujets, qui généralement présentent aussi des signes objectifs de fatigue musculaire, nerveuse ou écologique. Elle est ressentie soit au cours de l'activité, soit lorsque celle-ci cesse. Elle peut être éclipsée par l'effort d'attention nécessaire à la réalisation de la tâche ou par une autre sensation (faim, soif, peur, sommeil...) ; elle est d'autant plus extériorisée que l'individu est moins bien inséré dans les groupes sociaux auxquels il appartient. La fatigue peut être considérée comme un signe d'inadaptation générale à une situation ou à une activité données. Certains y sont peu sensibles et l'acceptent comme un événement naturel ; d'autres, au contraire, en font l'objet de leur préoccupation constante. Pour un même régime, les individus se distinguent donc les uns des autres par une infatigabilité propre qui dépend, en dernière analyse, de leur aptitude maximale dans le domaine considéré. La difficulté majeure de l'étude de la fatigue subjective réside dans le grand nombre des éléments qui peuvent être retenus pour la décrire, d'où la confusion possible avec les sensations voisines telles que la lassitude ou l'ennui. En pathologie, on observe des dissociations : la sensation de fatigue peut exister alors que la capacité de travail (physique ou mentale) est intacte, permettant parfois des performances remarquables. La fatigue des maladies mentales n'est donc pas liée à une activité antérieure : il s'agit d'une perception sans objet, définition même de l'hallucination.
Aussi bien pour le sujet normal que pour le malade, les recherches actuelles ont établi des corrélations entre la sensation de fatigue (phénomène psychologique) et les signes physiologiques qui l'accompagnent. On peut supposer, en effet, qu'à un état de fatigue correspond un mode particulier de fonctionnement de l'ensemble des neurones du système nerveux, réalisant ce que les neurophysiologistes nomment un pattern spatio-temporel d'activité neuronique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Hugues MONOD : professeur à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie, directeur du Laboratoire de physiologie du travail du C.N.R.S.
Classification
Autres références
-
ASTHÉNIE
- Écrit par Georges TORRIS
- 382 mots
Pour Hippocrate, l'asthénie est « la condition la plus voisine de la maladie » ; c'est un état qui favorise la venue de la maladie et explique qu'elle atteigne des sujets robustes. Dans la médecine classique, les asthénies sont les maladies caractérisées par la prostration, la langueur – générale...
-
SOMMEIL
- Écrit par Patrice FORT , Michel JOUVET , Patrick LÉVY et Véronique VIOT-BLANC
- 18 119 mots
- 6 médias
Théorie restauratrice : comme la faim et la soif, lafatigue mentale et physique entraîne une réponse homéostasique destinée à restaurer un équilibre dans le système nerveux central. Alors que l'éveil est ergotrope, le sommeil est trophotrope selon l'expression de Hess. Il reste cependant à démontrer... -
TROUBLES ANXIEUX
- Écrit par Dominique SERVANT
- 6 545 mots
Voir aussi