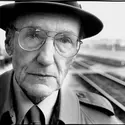FOUS LITTÉRAIRES
Article modifié le
Folie et langage
La langue souveraine
Tout locuteur affronte, lorsqu'il prend la parole, la contradiction suivante : c'est lui qui parle, et pourtant ce n'est pas lui, mais la langue. Je parle en effet ma langue : elle me sert d'instrument, traduit mes pensées et les communique à autrui, est soumise à ma maîtrise. Je dis ce que je veux dire et je veux dire ce que je dis. Mais en même temps je sais bien que, même si je m'exprime dans ma langue maternelle, je subis les contraintes du système : je dois me battre avec mes moyens d'expression, et ne suis jamais pleinement satisfait de ce qu'ils me permettent de dire, même si je ne vais pas jusqu'à adopter l'hypothèse de Whorf-Sapir selon laquelle la pensée d'un locuteur lui est dictée par la structure de la langue qu'il utilise (si bien que la vision du monde d'un Indien Hopi ne peut jamais ressembler à celle d'un anglophone). Tout énoncé sera donc un compromis entre les deux termes de cette contradiction. La spécificité du fou littéraire – c'est là qu'il se distingue du locuteur « sensé » et de l'écrivain – est qu'il ne passe pas de compromis. Son expression est donc marquée par cet excès : un des deux pôles y domine, la langue parle dans son texte. En effet, le locuteur qu'est le fou littéraire n'est pas maître de ce qu'il dit : ce qui signifie non qu'il est incohérent – quoi de plus cohérent qu'un texte de paranoïaque ? – mais que ce n'est pas lui qui parle, mais la langue. L'écrivain au contraire, même s'il prend des risques avec le langage, conserve en principe cette maîtrise : c'est lorsqu'il cède à cet excès qu'il devient, comme Roussel, un fou littéraire.
Une rhétorique de l'excès
On pourra décrire cet excès de multiples façons. Entendu mécaniquement, par exemple, il consiste à ajouter une contrainte aux règles de la langue (par exemple, que tous les mots doivent commencer par la même lettre), ou bien à en retrancher une, par exemple en acceptant qu'un mot soit découpé en ses constituants plus d'une fois (c'est ce que pratique Brisset). Le résultat est qu'on laisse parler la langue, le texte étant produit non plus selon les exigences d'un vouloir-dire mais selon les possibilités autorisées par un système de contraintes (tout versificateur débutant a ainsi vécu l'angoisse de la rime). Que son choix soit celui d'un excès de cohérence (par addition de contraintes) ou d'incohérence (par soustraction), le fou littéraire efface la position du sujet locuteur au profit d'un procédé. Mécanique au départ, et générateur d'excès textuel (ainsi la réanalyse des mots découpés en morphèmes par Brisset ne s'arrête jamais), le procédé est lui-même soumis à la loi de l'excès : il évolue, devient de plus en plus englobant, et finit par être la clé de tous les énoncés. Nous reviendrons sur le procédé narratif de Roussel et le procédé de traduction de Wolfson. Celui de Brisset est étymologique : l'origine batracienne de l'humanité, qui est la plus célèbre de ses thèses, est « prouvée » par un incessant découpage étymologique, qui évoque un almanach Vermot tournant à vide. Où l'« ancêtre » était-il logé ? L'eau j'ai – au bord de lacs ; l'haut j'ai – dans des maisons montées sur pilotis ; loge ai – dans des cabanes ; l'auge ai – où il se nourrissait. Et ainsi de suite : qui doutera alors que l'« ancêtre » ait été une grenouille ?
Les anagrammes de F. de Saussure, que J. Starobinski analyse dans Les Mots sous les mots, constituent un autre exemple d'un tel procédé : on sait que ce qui commença comme un principe d'explication de la composition des vers saturniens devint bientôt la clé qui ouvrait l'interprétation de tous les textes, et que Saussure, qui découvrait des anagrammes jusque dans les Commentaires de César et les lettres de Cicéron, se vit contraint de soutenir l'idée que l'anagramme était le procédé fondamental de composition des textes latins, mais que personne n'en avait jamais parlé ou ne semblait s'en être aperçu avant lui. La différence entre Saussure et le fou littéraire est que malgré sa conviction le linguiste persista à traiter cette découverte comme une hypothèse et que, faute de pouvoir la fonder par des preuves, il finit par l'abandonner, et renonça à publier le résultat de ses recherches. Mais le cas limite de Saussure montre que le procédé du fou littéraire n'est pas si éloigné de techniques respectées d'interprétation ou d'opérations que la langue elle-même pratique : les anagrammes sont bien là où Saussure les trouve, même si personne ne les y a placées. Le fou littéraire ne fait que systématiser ce que le philosophe fait aussi. Ainsi l' étymologie pratiquée par Brisset rappelle étrangement l'étymologie philosophique, qui était monnaie courante avant l'apparition de l'étymologie scientifique au xixe siècle. Depuis les stoïciens jusqu'à Isidore de Séville et à ses successeurs, les relations entre les mots se faisaient non selon la filiation attestée mais selon la ressemblance : on a pu ainsi tirer une interprétation du mythe de la Chute de la similitude existant entre mālum (la pomme) et malum (le mal). Des étymologistes, la technique est passée aux poètes (les traductions de Sophocle par Hölderlin – qui, il est vrai, appartiennent à la période de son aliénation mentale, mais sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre de traduction poétique – font appel à l'étymologie, aux dépens du sens communément accepté). On la rencontre enfin chez certains philosophes : chacun sait à quel point Heidegger tire ses concepts d'analyses étymologiques de termes allemands ou grecs, analyses qui parfois forcent la langue. Le profit philosophique qu'il tire de l'opération dépend de ce travail sur la langue. Si nous allons plus loin, nous constaterons que la langue elle-même produit ces étymologies fausses : on appelle cela l'étymologie populaire.
Situations du locuteur
Si le fou littéraire se laisse aller à quelque excès langagier, on voit qu'il ne fait que suivre l'exemple de la langue. La différence avec le locuteur « normal » est que celui-ci s'arrête plus tôt, résiste mieux aux sollicitations de son langage. Cela montre cependant la fragilité de la maîtrise du locuteur sur sa parole. Cette perte de maîtrise n'est pas le propre du fou littéraire, et l'on peut dresser l'inventaire (par ordre de maîtrise croissante) de ceux qui laissent parler la langue. Le possédé ne parle même pas sa langue : il parle « en langues », pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Il ne se distingue du fou littéraire qu'en ce qu'il a fait secte : le parler en langues, qui est le contenu du miracle de la Pentecôte, est encore pratiqué dans les sectes pentecôtistes aux États-Unis. Le bavard vient ensuite, dont la meilleure illustration littéraire se trouve dans le roman de Louis-René des Forêts qui porte ce titre : son excès langagier tient au temps, car lui non plus ne sait pas s'arrêter, et sa parole est compulsive. Puis le sot – Bouvard et Pécuchet en sont la parfaite incarnation –, qui ne parle que par expressions stéréotypées, clichés et proverbes. En fait, ce n'est pas lui qui parle, c'est la langue en tant qu'inventaire fini de discours figés. Le littéraliste se laisse imposer ses sens par l'énoncé qu'il entend ou lit : il ne comprend pas les métaphores, prend les actes de langage indirects au pied de la lettre. Lui demande-t-on, à table : « Pouvez-vous me passer le sel ? », il se contentera de répondre : « Oui, je le peux » et n'agira pas. On est ici proche du « fou », de telles stratégies étant caractéristiques des schizophrènes. Puis vient le linguiste, locuteur fragile en tant que possédé par son « amour de la langue », pour reprendre le terme de J.-C. Milner, qui s'il ne le pousse pas toujours à inventer des langues (l'esperanto est une incarnation du « procédé »), laisse toujours parler la langue au moment où il parle d'elle. Enfin, mariant heureusement la plus grande préoccupation (et parfois la plus intense possession) et la plus haute maîtrise, vient le poète. Du point de vue qui nous occupe, on verra en lui un fou littéraire qui a réussi à rester du bon côté des murs de l'asile.
Nous sommes sur le point de retomber dans le mythe du poète-fou. Mais ce qu'il nous faut modifier alors, c'est peut-être notre concept de délire. Il faut dé-psychiatriser le concept, et voir dans le délire non une simple déréliction, un symptôme dramatique, mais un mode de fonctionnement de la langue, correspondant au pôle de la contradiction : « la langue parle ». On trouvera une conception non négative du délire dans Logique du sens de G. Deleuze et dans l'Anti-Œdipe de G. Deleuze et F. Guattari. Le premier texte oppose le schizophrène à la petite fille, le langage maîtrisé et pervers des surfaces qui caractérise le nonsense littéraire de Lewis Carroll au cri, issu des profondeurs du corps, que l'on entend dans la poésie d'Artaud. Le second texte, centré sur les flux d'énergie, les machines qui les segmentent, et non sur le système et sur ses règles, permet de penser le délire comme le surgissement du sens, et non comme sa perte. L'accent est donc mis sur la production du sens, et non sur sa réduction par l'interprétation. L'opposition à la psychanalyse, qui donne son titre à cet essai, est justifiée par le fait que celle-ci est une technique d'interprétation, habile à affirmer les réponses universelles avant que les questions spécifiques ne soient posées, « triangulant » ainsi le sujet dans les contraintes du complexe d'Œdipe et lui interdisant de produire son propre sens. De ce point de vue, le texte délirant du fou littéraire est une véritable expression, qui n'a pas été « châtrée » par les règles de la langue ou la structure de la famille. Pour ce courant philosophique, pour lequel la notion principale est celle de désir, les textes des fous littéraires constituent un corpus privilégié.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Jacques LECERCLE : professeur de langue et littératures anglaises à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Autres références
-
ARTAUD ANTONIN (1896-1948)
- Écrit par Paule THÉVENIN
- 3 393 mots
- 1 média
...écrit alors à Rivière non tant pour défendre leur facture que pour tenter de faire comprendre pourquoi il « propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Je souffre, écrit-il, d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. » Et il tient d'autant plus à ce que soit reconnue... -
BLAVIER ANDRÉ (1922-2001)
- Écrit par Jean-Didier WAGNEUR
- 658 mots
Né le 23 octobre 1922 à Hodimont (Belgique), André Blavier commence à se passionner pour les « fous littéraires » alors qu'il est jeune bibliothécaire à Verviers. Il va rassembler ce qui deviendra une des plus belles bibliothèques consacrées non seulement à ce thème, mais aussi au surréalisme et...
-
BURROUGHS WILLIAM (1914-1997)
- Écrit par Gérard-Georges LEMAIRE
- 1 918 mots
- 1 média
Un thème, l'exploration de la drogue, et un procédé formel, le cut-up, suffisent généralement à caractériser ce qui ne recouvre en réalité qu'une partie de l'œuvre de W. S. Burroughs. Du Festin nu aux Cités de la nuit écarlate, en passant par la Révolution électronique...
-
CAMPANA DINO (1885-1932)
- Écrit par Jean-Charles VEGLIANTE
- 1 107 mots
Dino Campana est né le 20 août 1885 à Marradi, entre Florence et Ravenne. Enfant turbulent et brutal – en particulier avec sa mère –, fugueur, emprisonné une première fois à dix-huit ans, puis périodiquement admis dans divers hôpitaux psychiatriques entre deux voyages ou vagabondages et des études...
Voir aussi