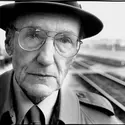FOUS LITTÉRAIRES
Article modifié le
Deux récits de cas
Raymond Roussel
Le lecteur des Impressions d'Afrique de Raymond Roussel risque d'être surpris. Car l'auteur – étrange conseil pour un romancier – lui recommande de sauter les dix premiers chapitres. Ils sont en effet singuliers : une série de tableaux vivants, dans lesquels des hommes utilisent d'incroyables machines pour accomplir les actions les plus bizarres. Un tireur d'élite parvient à séparer d'un coup de fusil le blanc et le jaune d'un œuf mollet. Une statue d'ilote, faite de baleines de corset, repose sur des rails en mou de veau. Une pie la fait basculer en actionnant de son bec un mécanisme. La suite du roman fournit une explication de ces merveilles. Elle est elle-même merveilleuse : un paquebot échoué sur la côte africaine, un souverain local capricieux qui impose à ses captifs, pour sa distraction, ces tours de force. Mais le lecteur devra attendre un texte posthume : « Comment j'ai écrit certains de mes livres », pour recevoir la véritable explication : ces aventures sont le fruit d'un procédé narratif. Dans sa première version, celui-ci consiste à énoncer deux phrases, aussi proches que possible par le son, aussi éloignées que possible par le sens, bref deux phrases composées de mots à double sens. Entre « les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard » (missives d'un explorateur blanc concernant un souverain noir et ses troupes) et « les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard » (caractères tracés à la craie sur les bandes de feutre qui entourent une table de billard), il n'y a d'autre différence que ce que les linguistes appellent une paire minimale : p/b. Le procédé consiste à écrire un conte commençant par l'une de ces phrases et se terminant par l'autre. Roussel dit que les deux phrases citées sont à l'origine d'Impressions d'Afrique. Mais le procédé a en fait déjà évolué, car le roman ne commence ni ne finit par ces phrases. En réalité, les aventures se multiplient selon une règle de proportion : on prendra deux mots à double sens, et on aura entre eux deux relations : l'une, la plus évidente, sert d'origine et est effacée dans le roman ; l'autre, dérivée de la première, est le centre de l'action ou de la machine extraordinaire. Ainsi l'expression « le gras du mollet » (relation d'origine effacée par la suite) donne naissance à cet œuf mollet que le tireur vise avec un fusil de marque Gras. La vue d'une baleine nageant près d'un îlot suggère des baleines de corset qui composent la statue d'un ilote. Si dans une classe un élève mou est raillé par ses camarades, on ne s'étonnera pas de trouver dans le roman un rail en mou de veau. Ce procédé étant sans doute trop accessible, Roussel essaie de le compliquer : « j'ai du bon tabac » devient « jade, tube, onde, aubade », et engendre un récit où ces quatre objets apparaissent. Lorsqu'il fait subir le même sort à l'adresse de son bottier, Roussel se met à parler un langage purement privé : l'excès s'est emparé du procédé, et le texte devient complètement hermétique. On remarquera toutefois que si le procédé met gravement en cause les règles de la narration mimétique, il ne semble pas dérégler le langage : la syntaxe est totalement respectée, et la sémantique n'est pas gravement affectée par la multiplication des calembours. L'excès langagier de Roussel est plutôt du côté du cliché, du déplacement du désir sur le fonctionnement de machines : les deux aspects se rejoignent dans le fait que le texte ressemble davantage au catalogue d'une exposition universelle qu'à un roman. Mais bien sûr, derrière cette application tatillonne des règles de la grammaire et cette multiplication des règles, de surcroît, qui caractérise le procédé, il faut voir un dérèglement du langage communicatif : c'est la langue – les possibilités de sens qu'elle impose au locuteur – qui détermine ici les personnages et les actions ; c'est parce qu'elle parle que l'inquiétude et l'incertitude saisissent le lecteur.
Louis Wolfson
Cette inquiétude, Louis Wolfson la ressent au plus haut point. Juif new-yorkais, traité depuis son enfance pour schizophrénie, vivant avec sa mère divorcée, il ne supporte pas d'entendre ou de lire l'anglais, sa langue maternelle, et a inventé un procédé linguistique pour résister à cette agression permanente. Il narre son expérience dans un texte écrit en français, Le Schizo et les langues.
Le procédé de Wolfson consiste à traduire immédiatement toute phrase anglaise en une phrase en langue étrangère, composée de mots ayant le même son et le même sens. On voit que la chose est assez facile, si les langues sont parentes, dans le cas de mots ayant la même origine ; et qu'elle est pratiquement impossible dans tous les autres cas, sauf à faire preuve d'une extrême ingéniosité. Mais c'est là une qualité que le fou littéraire possède au plus haut point. Ainsi, Wolfson ne peut s'empêcher de lire sur un écriteau : Don'ttrip over the wire (Faites attention au fil de fer). Cette phrase est traduite par lui en : « Tu nicht trébucher überethhezwirn », où « tu nicht », « über » et « zwirn », mots allemands, ont la même origine, et le même sens, que les mots anglais qu'ils remplacent, où « trébucher » allitère (par pur hasard) avec « trip », qu'il traduit effectivement, et « ethhe » sont deux mots grammaticaux hébreux qui n'ont pas le même sens que « the ». Mais l'excès de Wolfson n'est pas seulement dans les libertés que son procédé le force à prendre avec le sens : il est dans le fait même de traduire plusieurs langues à la fois – ce qui, pour un traducteur, est le plus grand des scandales. L'excès se lit aussi dans l'évolution du procédé : comme chez Saussure, sa découverte donne lieu à une illumination, et il devient bientôt une technique si puissante qu'il permet de traduire n'importe quelle phrase, mais au prix d'une trahison toujours plus grande, c'est-à-dire d'un relâchement croissant des contraintes. Ainsi, l'adverbe early (tôt) se voit assigner les « traductions » suivantes : « sur-le-champ », « de bonne heure », « matinalement », « dévorer l'espace ». La justification du dernier syntagme est qu'il contient, comme early, les phonèmes « r » et « l », dans cet ordre. Mais quelle suite de mots, suffisamment longue, ne les contient pas ? Il est clair que, dans ces excès, la langue parle. Elle parle d'abord dans le texte français de Wolfson (et n'est-ce pas une singulière tactique, pour un homme que la langue fait souffrir, que de devenir écrivain ?). Car il écrit très bien cette langue, mais ses phrases sont constellées d'anglicismes : on n'échappe pas à sa langue maternelle. Et c'est bien de cela qu'il s'agit : cet anglais qu'il déteste, c'est la langue que parle sa mère, qu'elle veut parler (car, émigrée juive d'Europe de l'Est, elle veut oublier ses origines et s'intégrer linguistiquement) et qu'elle veut le forcer à parler. Wolfson fait donc, dans le langage, et en sens inverse, le voyage que ses parents ont fait dans leur jeunesse : il retourne aux origines. Son rapport avec sa mère est bien sûr profondément ambigu. Le second livre de Wolfson, Ma mère, musicienne, est morte..., est un chant d'amour à sa mère, morte d'un cancer quelques années après la rédaction du premier livre : mais il est lui aussi écrit en français. Enfin, cette langue maternelle est une langue corporelle : les mots pénètrent les corps et les blessent ; ils sortent par la bouche et entrent par l'oreille ; ils sont l'antidote des aliments dont Wolfson essaie de se passer. Avec Wolfson devient explicite l'intuition centrale des fous littéraires : que la langue est matière, qu'elle vient du corps et agit sur les corps ; et qu'elle fait violence au locuteur. Plutôt que dictionnaire ou grammaire, la langue est cri.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Jacques LECERCLE : professeur de langue et littératures anglaises à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Autres références
-
ARTAUD ANTONIN (1896-1948)
- Écrit par Paule THÉVENIN
- 3 393 mots
- 1 média
...écrit alors à Rivière non tant pour défendre leur facture que pour tenter de faire comprendre pourquoi il « propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Je souffre, écrit-il, d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. » Et il tient d'autant plus à ce que soit reconnue... -
BLAVIER ANDRÉ (1922-2001)
- Écrit par Jean-Didier WAGNEUR
- 658 mots
Né le 23 octobre 1922 à Hodimont (Belgique), André Blavier commence à se passionner pour les « fous littéraires » alors qu'il est jeune bibliothécaire à Verviers. Il va rassembler ce qui deviendra une des plus belles bibliothèques consacrées non seulement à ce thème, mais aussi au surréalisme et...
-
BURROUGHS WILLIAM (1914-1997)
- Écrit par Gérard-Georges LEMAIRE
- 1 918 mots
- 1 média
Un thème, l'exploration de la drogue, et un procédé formel, le cut-up, suffisent généralement à caractériser ce qui ne recouvre en réalité qu'une partie de l'œuvre de W. S. Burroughs. Du Festin nu aux Cités de la nuit écarlate, en passant par la Révolution électronique...
-
CAMPANA DINO (1885-1932)
- Écrit par Jean-Charles VEGLIANTE
- 1 107 mots
Dino Campana est né le 20 août 1885 à Marradi, entre Florence et Ravenne. Enfant turbulent et brutal – en particulier avec sa mère –, fugueur, emprisonné une première fois à dix-huit ans, puis périodiquement admis dans divers hôpitaux psychiatriques entre deux voyages ou vagabondages et des études...
Voir aussi