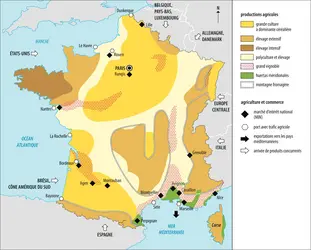FRANCE (Le territoire et les hommes) Espace et société
| Capitale | Paris |
| Langue officielle | Français |
| Population |
68 287 487 habitants
(2023) |
| Superficie |
543 940 km²
|
Article modifié le
Les grandes dynamiques territoriales
La métropolisation du territoire
Si l’urbanisation du territoire ralentit, sa métropolisation s’accélère. Ce mot désigne à la fois le processus qui conduit à l’émergence des métropoles et le résultat de ce processus. Il s’agit d’une transformation qualitative de l’urbain que la géographe Cynthia Ghorra-Gobin interprète comme une traduction locale de la mondialisation.
La métropole est une ville particulière, qui possède des caractéristiques démographiques, fonctionnelles et spatiales originales qui la distinguent des capitales régionales traditionnelles. La métropole, comme la capitale, domine un réseau urbain national ou régional. Mais ce nœud décisionnel a pour spécificité de concentrer à un degré inédit les hommes, les richesses et certaines fonctions de commandement économique, politique, intellectuel ou culturel, dont le rayonnement dépasse largement l’aire d’influence traditionnelle d’une ville ou d’une capitale. Ces fonctions métropolitaines se distinguent des services « banals » à la population, tels que les établissements scolaires, les hôpitaux, les services administratifs, les commerces, etc. qui fondent la hiérarchie urbaine classique. La métropole polarise en effet des activités dites de « tertiaire supérieur » : administration et encadrement de niveau national, européen et mondial, direction des sièges sociaux des très grandes entreprises, services financiers et bancaires, culture, recherche et développement d’envergure internationale, activités touchant à la production et la diffusion de l’information. Elle se distingue aussi par la densité et la qualité de ses infrastructures logistiques, qu’il s’agisse de réseaux de transport ou de télécommunication. Les métropoles sont enfin des lieux de production à forte valeur ajoutée, associant innovation et haute technologie, avec une concentration importante de firmes de dimension internationale et multinationale.
Le poids démographique n’est donc qu’un critère secondaire dans le rayonnement d’une métropole, même si celle-ci s’appuie généralement sur une région urbaine dense et même si la concentration de la population et de l’emploi augmente avec la taille de l’agglomération. Toulon, Dijon et Grenoble ont par exemple une population voisine, mais Grenoble est plus engagée dans le processus de métropolisation que Dijon, qui reste une capitale régionale, et surtout Toulon, qui ne possède pas de fonctions métropolitaines. C’est donc avant tout la polarisation, la spécialisation et la diversité des fonctions qui permettent aux territoires de s’intégrer à des systèmes de villes européennes et mondiales, ce qui définit une métropole. Dans ce cadre, seule l’agglomération parisienne peut revendiquer aujourd’hui le statut de ville globale, c’est-à-dire l’appartenance au système de villes qui commandent l’économie mondialisée, car elle possède l’ensemble des fonctions métropolitaines. Les autres métropoles prétendent à un rayonnement européen (Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse). Elles ne possèdent qu’une partie des fonctions de commandement métropolitain : Lyon par exemple ne dispose pas de la fonction financière, Toulouse est très spécialisée dans la recherche et le développement, etc. Les métropoles de Montpellier ou de Nice regardent également vers la Méditerranée, la technopole de Grenoble vers l’arc alpin.
La métropolisation est un processus cumulatif et sélectif. Elle privilégie les agglomérations les mieux dotées. À l’échelle nationale, elle ne bouleverse pas fondamentalement les hiérarchies urbaines. En revanche, elle modifie les organisations spatiales aux échelles infrarégionale et infra-urbaine. Il existe en effet une spécialisation des territoires au sein de l’agglomération métropolitaine qui se traduit par une restructuration spatiale du marché du travail. Au schéma centre-périphérie traditionnel se superpose une organisation polycentrique dans laquelle s’articulent des centralités principales et des centralités secondaires. Le gradient centre-périphérie joue toutefois puisque les fonctions de fabrication sont par exemple rejetées en périphérie. Cette organisation apparaît de façon très nette dans l’agglomération parisienne : quartiers d’affaires du Triangle d’or et de la Défense, pôles logistiques de Roissy et d’Orly, pôle de recherche et développement du Quartier latin, du plateau de Saclay, de Paris-Est et de Paris-Ouest, etc. Mais on la retrouve aussi dans des métropoles de rayonnement moindre. À Nantes par exemple, on observe une dissociation entre le centre-ville, dévolu aux fonctions urbaines classiques (commerce, services municipaux, etc.) et d’une part le nouveau quartier d’affaires, Euronantes, autour de la gare TGV, d’autre part le quartier Île de Nantes, issu d’une opération de renouvellement urbain sur les friches industrielles des anciens chantiers navals, qui polarise les activités de création et l’économie de la connaissance autour d’un « cluster créatif ».
Ces opérations d’aménagement ont permis à Nantes de dépasser le niveau d'une capitale régionale classique et ont contribué à transformer celle que la presse surnommait volontiers la « belle endormie » dans les années 1990 en une métropole fortement attractive et dynamique. L’exemple nantais montre que les trajectoires métropolitaines des grandes villes françaises ne sont pas linéaires. Elles dépendent beaucoup du projet urbain mis en place par les acteurs locaux, qui peuvent en quelques années changer le rayonnement et l’attractivité de la ville. Lille est ainsi l’exemple archétypal de la reconversion d’une ville industrielle en crise en une métropole européenne qui associe les fonctions de production, d’innovation (recherche et développement) et de création (fonctions culturelles). Cette reconversion a été portée par les acteurs locaux qui, dès les années 1980, ont milité pour l’arrivée du TGV européen et ont développé le quartier d’Euralille, autour de la nouvelle gare.
Pour répondre à cette dynamique territoriale et l’encourager, le législateur a intégré la métropolisation à l’acte III de la décentralisation. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi Maptam) promulguée le 27 janvier 2014 a ainsi créé un nouveau statut afin de « permettre aux agglomérations de plus de 400 000 habitants d’exercer pleinement leur rôle en matière de développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville ». La réforme vise à reconnaître la place des agglomérations de plus de 400 000 habitants, à leur donner davantage de visibilité pour favoriser leur attractivité dans la compétition mondiale et à conforter leur rôle d’acteur économique majeur au sein des nouvelles grandes régions créées parallèlement par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015. Après l’accession de sept autres villes à ce nouveau statut, la France compte désormais treize régions métropolitaines et vingt-deux métropoles. S’ajoutent cinq départements et régions d’outre-mer (DROM) et des territoires aux statuts divers.
Le renouveau de la ruralité
Urbanisation, périurbanisation et métropolisation ont remis en question la traditionnelle distinction entre urbain et rural. Certains géographes, comme Jacques Lévy, considèrent en effet que l’urbanisation se traduit par une diffusion des modes de vie et des pratiques citadines de sorte que l’opposition ville/campagne, qui a longtemps structuré le territoire national, a vécu. La campagne serait avant tout un « stock de formes héritées » et ne serait plus que la « dimension spatiale de la mémoire de la ruralité ». L’INSEE a d’ailleurs fait disparaître en 2010 la catégorie « espace à dominante rurale » de ses statistiques, provoquant de nombreux débats dans la communauté scientifique. Selon ce nouveau zonage, 77,5 p. 100 de la population française est urbaine et plus de 95 p. 100 de la population française vit « sous l’influence des villes », ce qui accrédite la thèse du « tout et tous urbains ».
Cette lecture du territoire national est cependant très critiquée, car elle ne prend pas en compte la diversité des espaces sous dépendance de l’urbain. La première critique porte précisément sur l’approche statistique du rural. Dans les typologies de l’INSEE, 20 p. 100 des communes de métropole restent des communes rurales et trois quarts des communes appartenant à des espaces très peu denses sont éloignées de l’influence des villes. Ces espaces et leurs habitants ont ainsi des liens très distendus à l’urbain, ce qui interroge l’affirmation selon laquelle l’urbanité est généralisée et remet en question la disparition de la catégorie statistique « d’espace à dominante rurale ». La seconde critique s’appuie sur le renouveau démographique des territoires de faible et très faible densité. La revitalisation de ces espaces s’accompagne d’une évolution des modes de vie et des pratiques. Si la nourriture, les vêtements, le confort des logements, l’hygiène, les rythmes de travail, les pratiques de consommation se sont alignés sur ceux des villes, les conditions de vie des populations rurales ne sont pas réductibles à celles des populations citadines. La ruralité n’est plus synonyme depuis longtemps de société paysanne et, même si certains territoires sont encore victimes de représentations négatives et répulsives, le « rural profond » est désormais gage d’authenticité et de qualité de vie. Les nouveaux habitants et les acteurs de ces territoires réinventent plus largement une ruralité positive, choisie. Celle-ci pense parfois en opposition à l’urbain mais cherche surtout à se définir de façon autonome et non plus en relation systématique à la ville.
La ruralité contemporaine se marque d’abord par un éloignement physique. La distance à la ville est synonyme de distance aux services banals, qu’il s’agisse de services administratifs (tribunaux, caisses d’allocations familiales ou d’assurance maladie, agences pour l’emploi, etc.), d’éducation (primaire, collège, lycée et, a fortiori, enseignement supérieur) ou de santé (urgences, médecin, pharmacie, maternité). Les trois quarts des communes très peu denses sont par exemple situées à plus de 10 minutes en voiture des services quotidiens contre 20 p. 100 pour les communes peu denses. Cet éloignement n’est pas toujours compensé par l’accès à Internet. Au contraire, de nombreux territoires ruraux souffrent de la « fracture numérique », à l’heure où les procédures administratives sont de plus en plus dématérialisées. La question de l’accessibilité des équipements et des services est un facteur de fragilisation des territoires. Dans la Creuse par exemple, la forte proportion des agriculteurs et des retraités, conjuguée à l’installation de ménages à faibles revenus hors des espaces périurbains, explique un taux de pauvreté nettement plus élevé que la moyenne nationale. Les dépenses occasionnées par l’éloignement sont un facteur de paupérisation supplémentaire. Elles pénalisent les personnes âgées et isolées, et entravent l’accès à l’emploi, la scolarisation ou la culture pour les actifs. Toutefois, si la distance peut être un facteur de marginalisation, la ruralité offre aussi souvent davantage de proximité entre les habitants. Se créent alors des formes de sociabilité originales, avec des valeurs et des modes de régulation sociale différents de ceux de la ville.
Dans les communes peu denses et très peu denses, la part de la surface urbanisée et artificialisée est très faible. Les espaces « naturels », notamment les forêts, y occupent des superficies importantes (plus de 40 p. 100 en moyenne). Certes, la « nature » résulte des activités humaines passées et présentes. Les milieux et les paysages ont été profondément transformés par l’action pluriséculaire des sociétés paysannes. Pour autant, l’environnement biophysique reste différent des territoires urbains, en raison de la prédominance du végétal et du minéral. De même, malgré le recul de l’agriculture et le caractère multifonctionnel des territoires, la part des surfaces agricoles y est très importante (les deux tiers en moyenne). La prédominance des espaces « naturels » et agricoles peut être valorisée par les habitants qui rejettent la ville et les nuisances qu’elles représentent. Elle peut même devenir une ressource pour les territoires : si l’on reprend l’exemple du Limousin, les parcs naturels régionaux (PNR) de Millevaches et Périgord-Limousin se sont développés autour de la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, à l’écart des grands centres urbains. Dans les Cévennes et les Causses, le paysage relique des terrasses et des drailles a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comme un témoignage des agricultures méditerranéennes. Cette reconnaissance internationale d’un « paysage culturel » s’appuie sur le renouveau contemporain de l'agropastoralisme et alimente la revitalisation du territoire. On retrouve ces initiatives sur l’ensemble du territoire national.
Au-delà des aspects matériel, fonctionnel et paysager, la ruralité est enfin un mode particulier d’habiter qui, comme le décrit le géographe et sociologue Bernard Kayser, « n’est ni le contraire de l’urbanité, ni son prolongement, ni la dégradation de son état ancien, ni sa résurgence » mais bien une forme singulière de rapport à l’espace, qui se marque par l’inscription forte dans le « local », voire une « familiarité des lieux ». L’espace rural reçoit ainsi une définition empirique et subjective de la part de ses habitants, pour qui il fait sens. Habiter un espace rural devient pour les individus un marqueur identitaire.
La ruralité française reste finalement protéiforme. Il existe des gradients de ruralité comme il existe des gradients d’urbanité. Entre le rural urbanisé des campagnes périurbaines des grandes villes, le rural agricole des grands espaces productifs et le rural isolé, fragile, marqué par la déprise démographique et économique se décline une multitude de situations. Dans ce contexte, chaque territoire a sa propre trajectoire de développement, en fonction des activités en présence et de la capacité des acteurs locaux à construire un développement endogène.
Augmentation des inégalités, fragmentation des territoires
Si les politiques d’aménagement du territoire menées en France à partir des années 1960 ont globalement réduit les inégalités territoriales à petite échelle (région, département, bassin d’emploi), on constate en revanche une augmentation des disparités à des échelles plus grandes, qui se marquent nettement dans les indicateurs socio-économiques. Ces inégalités structurent aujourd’hui fortement les territoires.
À l’échelle nationale, le taux de pauvreté est le plus élevé dans le Nord et le Sud-Est (ex-Nord-Pas-de-Calais, Corse, ex-Languedoc-Roussillon), ainsi qu’en Seine-Saint-Denis. Les départements et régions d’outre-mer connaissent des retards de développement importants par rapport à la métropole. Mayotte, la Guyane, La Réunion et la Martinique sont les départements les plus pauvres de France. À l’échelle des DROM, les sociétés sont aussi plus inégalitaires qu’en métropole.
À une échelle plus fine, la pauvreté est d’abord un fait urbain puisque plus des deux tiers de la population pauvre résidaient en 2013 dans une grande aire urbaine, celle de Paris concentrant à elle seule 20 p. 100 du total. Les disparités se creusent surtout entre les métropoles, qui concentrent les richesses, et le reste du territoire. La pauvreté est en moyenne plus forte dans les communes-centres des grandes aires urbaines, mais elle atteint aussi des niveaux très élevés dans certaines communes rurales isolées. La pauvreté dans l’espace rural est en réalité mal documentée, car peu étudiée et rendue invisible par les catégories statistiques. Les recherches sur le sujet font pourtant état d’une forte précarité, avec des dispositifs d’accompagnement inadaptés et des problèmes de mobilité qui, combinés aux effets de la distance, compliquent l’accès aux prestations sociales de solidarité.
Au sein des aires urbaines, les disparités sont très importantes. Dans l’aire urbaine parisienne, l’écart de revenu médian entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, départements voisins, est par exemple de 50 p. 100. Dans les Hauts-de-Seine, les 10 p. 100 les plus riches gagnent cinq fois plus que les 10 p. 100 les plus pauvres. Et les inégalités se reproduisent entre les communes et, au sein des communes, entre certains quartiers. Ainsi, Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) compte plusieurs grands ensembles ; les revenus varient du simple au triple entre les quartiers du centre de la zone urbaine sensible (ZUS) et ceux des quartiers situés aux limites du périmètre.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Magali REGHEZZA : maître de conférences, habilitée à diriger des recherches
Classification
Médias
Voir aussi
- DENSITÉ DE POPULATION
- EUROPE, géographie et géologie
- NATALITÉ
- AGRAIRES STRUCTURES
- PAUVRETÉ
- TGV, France
- MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
- ROUBAIX
- AGRICOLES EXPLOITATIONS
- TRANSPORTS EN COMMUN
- MIGRATIONS ALTERNANTES ou PENDULAIRES
- CAMPAGNES ou ESPACES RURAUX
- FRANCE, géographie humaine et économique
- TERTIAIRE SECTEUR
- SIDÉRURGIQUE INDUSTRIE
- URBANISATION
- TEXTILES INDUSTRIES
- EXODE RURAL
- ESPÉRANCE DE VIE
- FRANCE, économie
- FERMAGE
- AUTOMOBILE INDUSTRIE
- LOZÈRE, France
- VIANDE
- GÉOGRAPHIE HUMAINE
- PAC (Politique agricole commune)
- SECTEUR INDUSTRIEL
- SECTEUR AGRICOLE
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
- INNOVATION TECHNOLOGIQUE
- VIEILLISSEMENT, démographie
- AOC (appellation d'origine contrôlée)
- DÉSINDUSTRIALISATION
- DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE
- CENTRE ET PÉRIPHÉRIE
- FRACTURE NUMÉRIQUE
- INVESTISSEMENT PRODUCTIF
- TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- TOURISME RURAL